
Japon vue sur la carte du Monde.

Japon vue sur la carte du Monde.

Tenue de Samouraï au Château de Matsumoto.
*Bienvenue au Japon.*
Mélange de traditions et de modernité
" Ecole Polytechnique "
Du 26 Septembre au 08 Octobre 2018.
13 Jours / 10 Nuits.
Le Japon oscille entre le passé et le futur sans jamais coller au présent.
Les rumeurs les plus folles courent sur les dangers de la modernité, mais mieux vaut aller au Japon sans idées trop préconçues, car il reste certainement le seul pays du monde technologiquement avancé à être demeuré isolé pendant presque trois siècles.
Au pays du Soleil-Levant, les contraires loin de s'opposer, cohabitent dans l'harmonie.
Et si le voyageur, intrigué et curieux d'un Japon hors des sentiers battus, pouvait imiter Nicolas Bouvier traversant le pays en sifflotant, il découvrirait un art de vivre encore imprégné des grands rythmes solaires et des mythes sensibles.
Votre Itinéraire :
Jour 01 : PARIS - OSAKA.
Jour 02 : OSAKA - HIMEJI
Jour 03 : H I M E J I / K Y O T O
Jour 04 : KYOTO / NARA / KYOTO.
Jour 05 : KYOTO.
Jour 06 : KYOTO / MONT KOYA.
Jour 07 : MONT KOYA / TOBA.
Jour 08 : TOBA / TAKAYAMA.
Jour 09 : TAKAYAMA / MATSUMOTO / HAKONE.
Jour 10 : HAKONE / KAMAKURA / TOKYO.
Jour 11 : TOKYO.
Jour 12 : TOKYO / PARIS.
Jour 13 : PARIS.

Borne KM Montelimar Tokio 1.
CIRCUIT AU JAPON DU 26 Septembre AU 8 Octobre 2018.
Tout d'abord et compte tenu des intempéries survenues ces derniers jours nous savons que l'aéroport d'Osaka sera ouvert dès le 11/09 et nos deux réceptifs avec qui nous échangeons régulièrement ne sont pas inquiets.
Par ailleurs en cas de danger le ministère de l'intérieur nous avisera.
Il y a 7 heures de décalage. Lorsqu'il est 12H en France, il est 19H au Japon.
Le changement d'heure pour l'hiver aura lieu après notre retour en France.
Penser à faire une photocopie de votre passeport.
Le poids du bagage en soute est de 23kg et pour le bagage en cabine c'est environ 5 kg mais c'est surtout la taille de celui-ci qui est déterminante.
Sur votre étiquette bagage pas d'adresse personnelle mais indiquer votre nom et votre numéro de portable ainsi que le nom et adresse du premier hôtel au Japon.
Les boissons ne sont pas comprises sauf le thé à table qui semble gratuit mais à vérifier.
Les habitants sont charmants et très disponibles.
Dans les hôtels ne pas hésiter à demander des cartes de la ville et celle de l'hôtel.
Nous aurons le même guide accompagnateur durant tout le circuit.
Prévoir un sac de vêtements de change pour les nuits au ryokan et au monastère.
POUR TOUTE PERSONNE AYANT UN REGIME PARTICULIER MERCI D'INFORMER TIME TOURS en la personne d'Alisson au plus vite pour faire le nécessaire pour l'avion et les repas au Japon.
Le japon est une destination à la mode depuis qelques années et du coup les prix ont un peu baissé.
Les services chers sont :
-les taxis dont les tarif sont identique à paris, prendre plutôt le tramway, le bus ou le métro;
-les restaurants français mais les autres restaurants locaux sont plutôt plus accessibles que prévus;
-le vin est cher, compter 20 à 25 euros la bouteille, la bière est au même prix qu'en Europe, le saké est bon marché ;
-une bouteille deau doit valoir dans les 2 euros les 75cl.
Les petits déjeuners sont de type américain : café « jus de chaussette », pas de beurre, confiture pas certain.
Nous arriverons par Osaka et repartirons depuis Tokyo ce qui nous évitera des kilomètres.
Pour info il y a 2 vols Air France par jour de Tokyo et ce sont des vols directs.
Trajet Paris vers Osaka, nous décollerons à 14h de Roissy (Ch D G) et arriverons à Osaka à 8h40 (avec le décalage).
Le Rendez-Vous sera donc à 11h à CDG Roissy.
Trajet Tokyo vers Paris, le retour nous amènera à 4h40 du matin à CDG Roissy.
Le Japon est une destination sécure, le métro est super propre et les sorties se font sans pb.
On trouve beaucoup d'information pour se diriger si besoin.
Une seule langue le japonais et un peu d'anglais. De toutes façons nous sommes sur un circuit où tout est organisé et notre guide est parfaitement bilingue. Les guides sont parfois d'humeur réservée et il faut donc les mettre en confiance pour qu'ils se « lâchent ».
Météo : températures : Osaka de 13 à 22° et à Tokyo de 19 à 21° Celsius. Il est prudent d'avoir une petite laine à Tokyo et en altitude.
Globalement pas de pb de santé (prévoir tout de même des médicaments pour la tourista), du change vêtements.
Les déplacements se font en métro et en car.
Prévoir de bonnes chaussures de marche faciles à oter et à semelles plutôt anti-dérapantes en raison de pavés glissants.
Pour la nuit en chambre japonaise il y aura des serviettes.
Enfin il y a souvent des toilettes un peu partout.
Conseils vestimentaires : maillot de bain, petite laine, Kaway par précaution, chaussures pratiques qui ne glissent pas car il y a beaucoup de pavés.
Selon les temples on nous demandera d'ôter nos chaussures et aussi parfois dans les maisons traditionnelles (prévoir des chaussettes jetables).
Santé : tourista possible mais nourriture fraîche et saine, des moustiques mais pas de paludisme.
Eau du robinet on évitera mais on peut se laver les dents avec et pour boire utiliser l'eau capsullée ou bouillie.
La nourriture est très fraiche et pas trop épicée.
Notre réceptif est français et est particulièrement attentif à la nourriture.
Prise électrique : très souvent on utilise des prises américaines avec 2 fiches plates ; wifi partout sauf dans le monastère !!
Monnaie forte le Yen, à changer sur place ; il y a des distributeurs partout. 1 euro = 125 yen environ.
Les cartes master et visa sont utilisables à partir d'un certain montant ; pour les petits commerces on préférera les yen.
Services : : pas de pourboire ni pour le guide ni pour le chauffeur. On prévoit un pourboire s'il y a service spécifique rendu. Le pourboire ne fait pas partie de la culture japonaise.
Si on veut faire un cadeau à un japonais, penser alors à une BD dont ils sont très friands.
Le circuit : les soirées sont tranquilles car les départs sont matinaux et pour bien profiter des journées il ne faut pas se coucher trop tard !
A Kyoto il y a quelques animations, c'est aussi la ville où vivent les geyshas par contre Tokyo elle, est diaboliquement animée.
A notre arrivée comme nous serons un peu fatigués nous aurons une journée cool ; visite d'Osaka puis direction Imeji pour être sur place dès le lendemain matin.
Les 29 et 30 nous serons sur Kyoto : ballades à pieds et visites en partant de l'hôtel. Parcours assez vallonné. Ici beaucoup de peintures (tableaux...) à acheter ; beaucoup de curiosités, marchés avec petits poissons vivants (plat local), petits cours d'eau. Des ballades en bus et à pieds, des jardins japonais très raffinés et plein de contacts possibles.
1er Octobre : mont Koya – journée zen et nuit au monastère.
2 Octobre : Toba est un peu excentré sur la côte de l'océan pacifique, parc national de + de 52000 hectares (perles de culture roses), journée mystique...
3 Octobre : direction Takayama petite ville à la campagne avec des maisons très typiques ; l'accueil y est chaleureux et cette journée sera sous le signe de l'authenticité. Prévoir un bagage à main pour le lendemain avec une nuit au Ryokan.
4 Octobre : Hakoné – nuit en Ryokan et bains chauds (30 à 40°) ; journée zen. Les japonais se baignent nus dans les eaux chaudes !!
5 Octobre : direction Tokyo avec vue sur le mont Fuji et croisière sur le lac Ashi (prévoir une petite laine. Tokyo est une ville très animée avec des quartiers très différents les uns des autres. On y découvrira les avancées en informatique et électronique ainsi que des vêtements parfois extravagants.
Cadeaux à ramener : kimono bien sûr, thé, tissus, éventails, porcelaine, vases type Ming...
En ce qui concerne les trajets Aller et Retour entre l'Ecole Polytechnique et l'aéroport de Roissy (CDG), il sera assuré par car SAVAC pour la somme de 26E par personne (A et R). Vous inscrire en envoyant un courriel à Annie.

Carte du Monde et encart Japon.
Le Japon est un grand archipel, composé de plus de 3.000 îles et îlots, et très étendu en latitude.
En fait Hokkaido, la plus septentrionale des îles principales, touche le 45e parallèle nord (la même latitude que Lyon).
Tokyo est située sur le 36e parallèle (la même latitude que Malte, ou le Sud de l'Espagne).
Tandis que l'île méridionale de Kyushu touche les 31 degrés nord (la latitude du nord de l'Égypte).
Mais les petites îles du sud (îles Ryukyu, Daito et Ogasawara ou Bonin) arrivent jusqu'à des latitudes tropicales (les îles Yaeyama, les plus méridionales des Ryukyu, se trouvent juste au nord du tropique du Cancer).

Japon Carte Itineraire.

Japon Carte Préfectures.
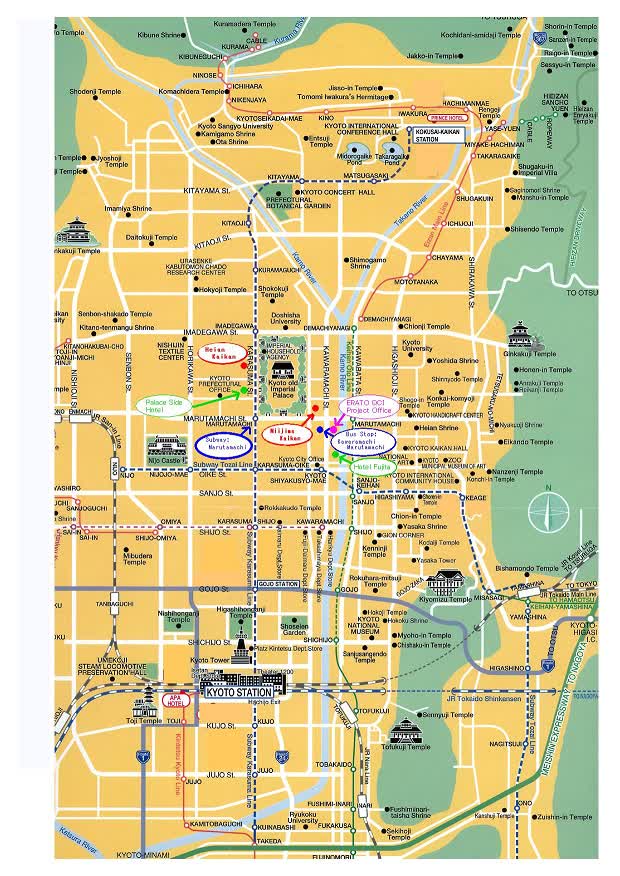
Kyoto Plan 1.

Kyoto Plan (Jap-Eng).

Plan de Tokyo.

Plan de Tokyo (Jap-Eng).

Tokyo Tower et au loin le Mont Fuji.
Le circuit du voyage
Le déroulement du circuit est donné à titre indicatif. Le programme est susceptible de modification en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, Jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des routes, etc... Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeur.

Japon Carte Itineraire.
Avion-Vol-vers-japon-Fr

Avion en plein ciel avec vue 600 km du Japon .
Jour 1 : Mercredi 26 Septembre 2018.
PARIS ( OSAKA.
Rendez-vous à l'école Polytechnique pour prendre le bus Savac à 9H15.
Rendez-vous des participants 11H00 à l'aéroport Paris-Roissy (CGD) avec notre représentant TIME TOURS.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
14H30 envol à destination d'Osaka.
Avion Boeing 787.
Temps de vol estimé de 11H00.
Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : Jeudi 27 Septembre 2018.
OSAKA / HIMEJI.
Petit déjeuner à bord de l'avion.
Arrivée 8H40 à l'aéroport d'Osaka et accueil par Nicolas, notre guide francophone.
Après les formalités de police et douane, nous changeons nos Euro en Yen avec un tau pour 1 Euro = 125 Yen.
9H40 nous rejoignons notre autocar "Joy Full" et ici au Japon il faut en principe mettre les ceintures de sécurité ! .
Notre guide franco-japonais se présente donc né de père français et de mère japonaise. Né en France à Nancy puis à l'âge de 2 ans vient vivre au Japon. Fait à l'école française ses études jusqu'en 4ième puis continue ses études avec le système japonais. Après ses études, il a travaillé pour Michelin au Japon mais aussi en France. Maintenant il est interprète et guide francophone.
Il nous présente Chris, notre conducteur de car qui se révèlera serviable, efficace et fort sympathique.
Enfin Nicolas nous donne quelques consignes en cas de tremblements de terre et typhons...
Géographiquement en latitude, Osaka se trouve au niveau de Rabat au Nord-Ouest du Maroc.
Osaka, troisième ville du Japon, est aussi et surtout la cité des affaires par excellence.
Elle attire et intrigue également de par sa population. En effet, les habitants y sont extrêmement gentils et curieux, ce qui vous changera des personnes que vous rencontrerez à Tokyo, qui seront peut être un peu plus excentriques. Ils se distinguent également par une langue, un dialecte qui leur est propre, l'Osaka Ben. C'est une forme du Kansai Ben, la langue qui se parle dans toute la région de Kyoto, Osaka et Kobe.
Enfin il est important de noter qu'Osaka est également réputé pour sa cuisine ce qui illustre d'ailleurs leur devise assez explicite : " A Osaka, mange jusqu'à ce que tu tombes ! "
Tour de ville d'Osaka.
Visite de l'extérieur du Château d'Osaka, le point focal de la ville. Datant de 1583 et reconstruit dans les années 30, il surplombe la ville sur une colline et témoigne de la grandeur passée de la ville.
Repas Japonais le midi, plusieurs plats prévus dans une mallette.
Départ pour HIMEJI. (120 KM, environ 2h).
Nous faisons quelques flashs de sommeil avant la visite du château de Himeji.
Le plus grand des douze châteaux féodaux du Japon est la seule et unique forteresse du japon d'origine. Le donjon principal était utilisé par les seigneurs lors des sièges ou des manoeuvres.
6 étages avec des escaliers assez raides à gravir surtout en chaussettes ! A la descente les escaliers toujours difficiles sont pourvus de bandes anti-dérapantes mais quelques poutres gênent notre progression car il nous faut les éviter en baissant la tête.
Nota : le nombre de toits ne reflète pas exactement le nombre d'étages du château et ceci afin de tromper un envahisseur éventuel !
17H15, installation à l'hôtel.
19H00, dîner YAKITORI dans un restaurant local (repas japonais). Au menu : brochette de poulet (chair, peaux ou foie) trempé dans de la sauce sucrée ou du sel. Il existe aussi une variante de brochettes composées de légumes, de champignons et de volailles. Nous sommes assis sur le sol avec les jambes dans une fosse sous la table... Nous y goutons aussi notre première bière locale pression au prix de 250 Yen ce qui fait environ 1,50 Euro (le patron nous a fait un prix de groupe !).
Nuit à l'hôtel.
Himeji Castle Granvrio Hotel (4*).

Katana de Samouraï.
Jour 3 : Vendredi 28 Septembre 2018.
HIMEJI / BIZEN/ KYOTO.
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel prévu à partir de 6H45 (mélange de Japonais et Européens en ce qui concerne les ingrédients).
Départ prévu à 8H00.
Arrêt et visite d'une fabrique de sabre : le film ne démarrant pas, nous commençons par la salle d'exposition de sabres et autre armes blanches puis cette fois visionnage de la vidéo en japonais avec sous-titrage en français.
Au Japon, suivant le besoin on utilisait différents types de sabres de longueurs et de formes différentes (CF info pratique).
Dans la commune de Bizen, qui est plus connu pour ses poteries, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Okayama, il y a également une forge où l'on fabrique d'authentiques sabres japonais, les mêmes qui sont largement utilisés dans les films de samouraïs et plus récemment remis au goût du Jour dans des films comme Kill Bill.
Dans cette fabrique on peut suivre pas à pas la conception de ces objets. En assistant à quelques mètres à toutes les étapes que sont la transformation du minerai en une lame sans défaut, la gravure, le polissage, la fabrication de l'étui ou du manche...
ROUTE en autocar pour Kyoto Arashiyama (140km, environ 3h00 de route comprenant une pause technique)
Durant ce trajet, Nicolas nous fait un petit cours sur la langue nippone (Ecritures, Prononciations)...
Déjeuner.
Découverte et balade dans la Bambouseraie d'Arashiyama, son fleuve l'Hozu Gawa et le pont Togetsu Kyo :
Kyoto se classe sans nul doute, avec les " Fushimi Inari Taisha " ou encore le " Ginkaku-ji ", comme l'une de ses plus fameuses images d'Epinal du Japon. Sa popularité est telle qu'elle dépasse allègrement les frontières du Japon ; ainsi, on la retrouve fréquemment sur des listes des plus beaux endroits sur Terre.
Et pour cause, si cette bambouseraie n'est certainement pas la seule dans la région de Kyoto, elle reste probablement la plus grande et sa balade offre une magnifique échappée. Le seul chemin d'ouest est tracé entre les arbres s'étend sur environ 500 mètres de long, et offre une vue sur la relative étroitesse des lieux.
Au Japon, le bambou peut être considéré comme un symbole de force ; il permettrait de repousser les mauvais esprits. Cela explique probablement pourquoi la bambouseraie d'Arashiyama est encerclée par les entrées du Tenryu-ji d'un côté, et de la villa Okochi-Sanso de l'autre.
Arrivée à l'hôtel.
Dîner à 19H00 dans un restaurant près de la gare de Kyoto.
Après le repas découverte individuelle de l'environnement urbain comme la gare de Kyoto, son architecture, ses escaliers, ses décoration...
Nuit à l'hôtel où nous passerons 3 soirs. .
DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO-EKIMAE (4*).

Geisha dans le quartier de Gion de Kyoto.
Jour 4 : Samedi 29 Septembre 2018.
6H30, petit-déjeuner buffet au 2ième étage de l'hôtel.
Météo : aujourd'hui c'est notre premier jour accompagné de pluie mais un typhon semble menacer le Japon et Nicolas nous donne des explications à ce sujet.
7H30, départ pour NARA, au coeur de la civilisation japonaise.
Fondée en 710 sur la plaine de Yamato Nara alors baptisé Heijo-Kyo (citadelle de la paix), cette cité ancienne est entourée de collines boisées, de temples ceints de parc et de quelques-uns des plus anciens bâtiments de bois du pays.
Visite du site de NARA, qui regroupe plusieurs monuments inscrits au Patrimoine mondial par l'UNESCO.
Dans un parc avec plus de 600 hectares, les daims en liberté gambadent et vivent en totale harmonie avec les visiteurs. On peut pour 150 Yen acheter puis donner des galettes de riz à manger à ces animaux.
Visite des temples et sanctuaires de ce parc.
Le Temple HORYUJI, le plus ancien temple du Japon (7ème siècle) et certains de ses bâtiments comme l'admirable pavillon des rêves sont les plus anciennes constructions du monde. L'architecture (bois, tuiles) de ce temple dégage une telle harmonie que l'on se sent immédiatement envahi par une émotion artistique et une sensation de paix intense.
Kasuga Taisha Shrine, ce sanctuaire est décoré de plus de 3000 lanternes en pierre, peint en vermillon très vif qui tranche sur la verdure environnante, il possède un trésor constitué principalement d'armes et de masque anciens ;
KOFUKU-JI, dont la pagode à 5 étages est devenue un symbole de Nara ;
Déjeuner en cours d'excursion.
Visite du TODAI-JI, abritant une colossale statue en bronze doré de Bouddha debout qui a atteint l'éveil, il possède plusieurs mains car il peut faire plusieurs choses à la fois et dont la tête est auréolée des 11 émotions humaines.
15H30 retour à Kyoto avec notre autocar (1 heure de trajet environ).
Découverte individuelle en temps libre du marché de Nishiki, Ce marché situé en plein centre de Kyoto qui est un véritable festival pour les yeux.
Toute la cuisine japonaise s'y expose. Non seulement vous y trouverez toutes sortes de légumes, de fruits, de poissons, de viandes... mais également toute une panoplie d'ustensiles japonais par exemple de belles lames, une grande spécialité japonaise. Les lames japonaises ont la réputation de bien couper, car la tradition veut que l'on tranche habilement tête et membres de ses ennemis d'un beau coup net. Là il ne s'agit que de poissons, mais le niveau d'exigence est le même.
Ensuite après 2,3 kilomètres de marche à pieds, nous rejoignons le quartier historique de "Gion", que nous visiterons durant notre temps libre afin de découvrir ses ruelles pleines de charme et de maisons traditionnelles, parfois lieu de résidence des "Geishas"...
Le mot geisha s’écrit à l'aide de deux kanjis qui signifient art et personne. Le terme évoque une femme qui pratique les arts : danse, chant, conversation. Ce ne sont pas des prostituées, mais des femmes de compagnie recherchées pour leur culture.
Les Geishas dans le quartier Gion de Kyoto, sont plus connues sous le vocable local de Geiko. Tandis que le terme Geisha signifie "Artiste" ou "Ppersonne des Arts", Geiko signifie plus particulièrement "Enfant des Arts" ou "Femme d'Art".
Avec un peu de chance on peut croiser sortant d'une maison de thé et traversant une ruelle sur ses sandales de bois, une "Maiko" (apprentie) ou une Geisha. Le passage du statut de Maiko à Geisha (Geiko à Kyoto) s'appelle "Erikae". Les maisons où exercent les Geishas se nomment "Hanabeya".
Le quartier historique de Gion a la particularité d'un mélange de traditionnel et de modernisme fusionnant en totale harmonie. Lieu idéal pour découvrir les arts traditionnels, les restaurants de style ancien, à la décoration d'un goût exquis renforçant l'atmosphère raffinée du quartier.
Dommage car aujourd'hui nous sommes accompagnés par quelques épisodes pluvieux...
Nous reprenons le car pour aller dîner dans un restaurant.
Promenade pédestre et digestive pour rejoindre notre hôtel.
DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO-EKIMAE (4*).

Jardin Zen de Ryoanji.
Jour 5 : Dimanche 30 Septembre 2018.
KYOTO.
6H30, petit déjeuner à l'hôtel.
Météo : température entre 18 et 28 degré Celsius, l'information du jour c'est une alerte par message sur les réseaux de téléphonie mobile avertissant de la présence imminente d'un typhon arrivant en fin d'après-midi sur la ville de Kyoto...
7H30, La journée débute par la visite du temple de KIYOMIZU DERA qui est dédié à la déesse Kannon aux onze têtes dont la statue n'est exposée qu'une fois tous les trente-trois ans, ce temple est surtout connu pour sa terrasse sur pilotis. Il fut fondé en 798 par le prêtre Sakanoue Tamuramaro, mais les bâtiments actuels furent bâtis en 1633.
Retour libre vers le car en admirant au passage les 3 chutes d'eau de l'entrée/Sortie du Temple et possibles achats dans les boutiques du site.
9H45 retour au car pour se rendre et visiter le Temple KINKAKUJI : blotti dans un beau cadre romantique, le pavillon d'or suffit à sa seule évocation à enflammer les imaginations. Construit en 1393 pour servir de lieu de méditation à Yoshimitsu, puis converti en temple à la mort du Shogun, il doit son nom de pavillon d'or aux feuilles d'or fin plaquées sur ses toitures et se reflétant dans l'eau.
Kyoto est entouré de montagnes et il existe des écritures sculptées sur les flancs qui par des torches, seron illuminées tous les 16 août à la fin de 3 jours de fêtes bouddhistes pour faciliter la remontée au ciel de l'âme des ancêtres...
Durant le trajet notre guide reçoit une alerte Typhon sur son téléphone mobile.
Ensuite à 11H35 découverte de l'incroyable concept du jardin zen du temple de RYOANJI. Ce chef d'oeuvre incontournable, jardin de sable et de pierre, d'une beauté remarquable, est l'un des plus purs achèvements de l'esthétique Zen. Ses quinze rochers ont donné lieu à de multiples interprétations, certains chercheurs y voient une tigresse et ses petits, d'autres des dragons... Les pierres sont disposées de telle sorte qu'on ne peut en voir plus de quatorze à la fois. Toutes sont entourées de sable soigneusement ratissé quotidiennement par les prêtres du temple, ce jardin Zen est un exemple de pureté et a été conçu pour la méditation...
Déjeuner japonais dans un restaurant local.
Retour à l'hôtel et le reste de l'après-midi est libre.
Nous visitons le quartier mais nous ne pouvons pénétrer dans un temple qui ferme en raison de la prévision météo, et donc nous retournons dans un magasin dont un étage est dédié à tout ce qui touche la photographie : Appareils en démonstration, Clef USB, Cartes SD et divers accessoires...
18H45, le groupe se reforme au niveau du "Lobby" de l'hôtel pour dîner non loin de la gare de Kyoto mais nous devons emprunter un passage souterrain en raison d'une pluie intense et d'un fort vent annonçant le typhon et idem pour le retour !
Nuit à l'hôtel.
DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO-EKIMAE (4*).
Jour 6 : Lundi 01 Octobre 2018.
KYOTO / MONT KOYA.
6H30, petit déjeuner à l'hôtel.
On doit se munir d'un sac de voyage pour 1 nuit car les valises ne seront pas disponibles pour la nuit au monastère. Pas besoin de maillots de bain car pas nécessaires dans la pratique japonaise, bains en commun mais hommes et femmes sont séparés...
En fait au monastère pas d'accès autorisé aux valises munies de roulettes, c'est pour cette raison qu'elles restent cette nuit dans notre car.
Ce matin il fait beau et heureusement cette nuit, le typhon n'a fait que nous effleurer !
8H30, nous parcourons environ 200 mètres avec valise et baluchon pour reprendre le car .
Nous allons d'abord visiter à KYOTO l'impressionnant château de NIJO mais hélas seulement la partie habitation.
On note un astucieux dispositif de tiges métalliques placées de telle sorte qu'elles tintent lorsque l'on marche sur certaines parties du plancher et donc préviennent d'une intrusion surtout nocturne !
L'hiver dans ces habitations, on ne se chauffait qu'avec des braseros portatifs d'où un danger permanent d'incendie...
Ce château est un impressionnant édifice datant de 1603. Plusieurs shoguns y ont résidé jusqu'à l'abdication du dernier d'entre eux en 1867. Il devint alors le siège impérial. Par la suite, on y installa la préfecture de Kyoto. Depuis 1893, le château appartient à la ville et se visite comme un monument historique.
Ce château marque le début et la fin de la période "Edo" et des "Samouraïs".
Petit déplacement en car pour rejoindre le temple Kodaiji afin d'être initié à la "Cérémonie du Thé".
Départ vers le sud de Kyoto, pour Koyasan en autocar (80 km, environ 2h de trajet comprenant un arrêt technique).
Durant ce trajet Nicolas notre guide nous fera une introduction à la notion de religion à la japonaise...
Ici on se plait à dire que l'on nait "Shinto", vit en "Confucéen", se marie "Chrétien" et que l'on meurt "Bouddhiste" !
14H00, déjeuner dans un restaurant.
Koyasan est une petite ville campagnarde au japon, mais le plus grand site monastique du bouddhisme ésotérique shingon. Il n'a de cesse d'influencer le monde religieux, en tant que centre prestigieux de dévotion pendant mille ans. À Koyasan les moines se consacrent aux pratiques religieuses dans les 117 temples, le Temple principal est le Kongobu-ji.
Selon la légende, le moine Kukai a découvert ce site grâce un guide de Dieux-shinto local. L'ouverture de Koya remonte à 816 quand le moine Kukai fut permis par l'empereur de l'époque de fonder un monastère religieux de bouddhisme ésotérique shingon. Et le premier temple Kongobu-ji fut inauguré au sommet du mont isolé de la cour impériale Heian-Kyo (AuJourd'hui Kyoto). Dès lors le sanctuaire Koyasan a débuté dans l'histoire du japon et sa région entière forme un champ spirituel.
Le sanctuaire bouddhiste Koyasan s'avère être une opposition avec la ville citadine. Jusqu'à 1872 époque de Meiji, cette région avait maintenu un champ de cloître permis seulement pour hommes.
Depuis inscrit au Patrimoine Mondial en juillet 2004 en tant que les sites sacrés et les chemins de pèlerinage dans les montagnes de Kii, ce site gagne beaucoup de voyageurs étrangers.
Découverte du KOYASAN :
15H00, visite du site de Koyasan, le premier temple d'Okunoin.
A 900 mètres d'altitude, au sommet du mont Koya, situé dans le quasi-parc national de Koya-Ryujin, se trouve le temple Kongobu-ji, fondé en 816 par le moine Kukai (également connu sous le nom de Kobo-Daishi) et devenu le temple principal du bouddhisme Shingon, branche ésotérique du bouddhisme japonais. Depuis, 120 temples et monastères ont été installés sur la montagne, en faisant un centre religieux de premier plan. Certains d'entre eux proposent un hébergement aux pèlerins et aux visiteurs, ou des repas végétariens, ou également la possibilité de s'initier à la pratique de zazen, la méditation zen. Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Allée menant au temple Okuno-in.
L'accès au temple se fait par une marche de 2km, soit 40mn, par une allée pavée traversant une forêt de cèdres plusieurs fois centenaires entre lesquels se trouvent plus de 200 000 tombes, dont certaines plus que millénaires, des mémoriaux et des statues de personnages historiques. On peut y reconnaître des noms importants de l'histoire japonaise comme Toyotomi Hideyoshi ou Oda Nobunaga. (15 mn à pied de l'arrêt de bus Ichinohashi-guchi).
Okuno-in, c'est là que se trouve le mausolée de Kukai. Au-delà du pont Gobyo-bashi, il est interdit de prendre des photos, de boire, manger ou fumer. La traversée du pont doit se faire tête baissée et mains réunies en prière car la croyance veut que Kukai attende et reçoive les visiteurs au bout du pont. Le mausolée se trouve derrière le temple des lanternes illuminé par la lueur de 20 000 lanternes suspendues.
Le shodô (littéralement la " voie de l'écriture ") est une calligraphie japonaise qui trouve son origine en Chine, là où sont nés les kanji. On peut comparer évidemment le shodô à la calligraphie chinoise, mais il s'en démarque par l'utilisation au Japon de deux systèmes d'écriture : les kanji et les kana, des phonogrammes dérivés de kanji inventés par les Japonais vers le IXe siècle. Les travaux calligraphiques y sont autant estimés que les oeuvres de la peinture. Mais n'oublions pas que cet art possède aussi un sens philosophique le plus souvent influencé par le bouddhisme zen.
Arrivée et installation au monastère avec 2H de temps libre pour visiter les alentours.
Il était prévu un cours de calligraphie " SHODO " que nous n'avons pas eu... Dans notre chambre juste un modèle à recopier sans autre conseil !
Diner végétarien avec mise à disposition de chaises pour celles et ceux qui ne peuvent manger en position assis sur les talons.
Bain chaud (proche de 40° Celsius), Possibilité pour celles et ceux qui le souhaite.
Nuit dans un temple Monastère où on vit l'expérience d'une nuit à la japonaise, c'est-à-dire dans un futon et sur un tatami.

Mont-Koya Monastere Hojo-In Vue Chambre avec Futon.
Jour 7 : Mardi 02 Octobre 2018.
MONT KOYA / TOBA (170 Km).
7H00, petit-déjeuner vegetalien.
6H30, il est possible d'assister à la Cérémonie rituelle bouddhiste (prière) au lever du soleil.
7H45, départ en car pour d'abord récupérer Jacqueline et Jacques qui ne pouvant dormir à la japonaise sont dans un hôtel.
Ensuite nous partons pour 1 heure de visite pédestre du cimetière local avec les tombes dans une forêt de cèdres du Japon. De plus il est le seul à comporter des tombes d'entreprises comme Nissan (le constructeur automobile), Kirim la fabrique de bière, une entreprise de fabrication spatiale dont le monument est une fusée ou encore les tombes d'un club de photographes amateurs...
Puis c'est parti pour 4 heures d'autocar avec pause afin de se diriger vers TOBA, un retour à l'authentique...
Une allée de boutiques s'offre à nos regards avant d'aller déjeuner mais nous les visiterons pour digérer !
Dans cette ville une statue de chat offre la bienvenue aux visiteurs et la prospérité aux commerçants ! En effet à l'entrée de chaque boutique une statuette de chat à la patte qui bouge est chargé d'accueillir le chalant...
Puis visite du temple de " ISE JINGU ", le sanctuaire le plus vénéré du Japon. Les édifices sont refaits à l'identique tous les 20 ans car ils sont en bois. Avant de détruire un monument il est refait sur la parcelle de terrain adjacente, ce qui prend environ une année.
Découverte de la magnifique région de ISE SHIMA. Le Parc National d'Ise Shima (52 036 hectares) est le plus visité du japon, avec ceux de Hakone-Izu et de Nikko. Sa côte déchiquetée, centre de la culture perlière nippone, offre un contraste frappant avec les montagnes couvertes d'arbres à feuilles persistantes et peuplées à l'intérieur de singes, de sangliers et d'écureuils volants. Cette région aux côtes découpées fut le berceau, avec Toba, de la perle de culture. Les deux sanctuaires d'Ise (Naiku et Geku) sont les sanctuaires les plus vénérables du Japon.
Demeure des esprits des empereurs du Japon, le grand sanctuaire d'Ise est le site Shintoïste le plus vénéré, son bâtiment intérieur est dédié à Amaterasu, déesse du soleil dont il est censé abriter le miroir, trésor impérial sacré.
15H50, reprise du car pour la visite de l'entreprise MIKIMOTO inventeur de la perle de culture sur "PEARL ISLAND".
D'abord visite du musée de la perle puis démonstration de la plongée huîtrière par 2 femmes et enfin petit tour de la boutique...
La perle de culture, présente sous toutes ses formes, a tout envahi à Toba. Vous emporterez sans doute avec vous la perle de Toba...
18H30, autocar pour se rendre à notre hôtel.
19H00, arrivée et installation à l'hôtel.
Dîner buffet au 3ième étage, restaurant Shiki de l'hôtel "RESORTS ISE-SHIMA" (3*).
Jour 8 : Mercredi 03 Octobre 2018.
TOBA / TAKAYAMA.
6H30, petit déjeuner à l'hôtel (3ième étage, restaurant Shiki).
Dommage de ne pas avoir eu le temps de profiter du bord de mer, mais le circuit continue !
8H00 départ en autocar pour Takayama (trajet de 4 à 5 heures avec 2 arrêts techniques).
Durant le trajet routier, Nicolas nous parle diaporamas et films à l'appui, des sports populaires au Japon : Sumo, Judo, Aïkido, Baseball...
Après une pause technique, nous reprenons la route et Nicolas nous intéresse à l'Origami (art traditionnel japonais du papier plié). Il s'agit pour nous en partant d'une feuille de papier de créer une grue, l'oiseau emblème du Japon signe de longévité.
Sur cette route des Alpes Japonaises, nous visiterons d'abord les villages historiques de Shirakawa-g Met Gokayama qui sont inscrits au Patrimoine mondial de l'humanité.
13H00, déjeuner de gastronomie japonaise.
Juste après le repas, sans reprendre notre autocar, visite de la maison typique de gassho-zukuria Shirakawago, Shirakaw le village de la rivière blanche et le village de Gokayama ou la montagne aux 5 parties sont surtout connus pour leurs maisons typiques de style architectural appelé gassho-zukuri, ou construction aux paumes des mains jointes qui désigne les maisons au toit de chaume, très pentu afin de supporter les chutes de neige très abondantes de cette région montagneuse.
Pour aller à Gokayama le deuxième village, quelques minutes de car puis un peu de marche à pied avec l'emprunt d'un asscenseur qui permet de descendre de plus de 20 mètres, puis à gauche et droite d'un tunnel les quelques maisons traditionnelles construites en bois avec toit typique dit de chaume mais fait avec des couches superposées de morceaux de petits bambous, de roseaux...
17H15, reprise de l'autocar, avec un trajet prévu de 1H15.
Notre but du soir "Takayama", petite ville dans la montagne qui par ses anciennes maisons de bois, ses boutiques d'artisanat, ses antiquaires, ses galeries de peintures et ses brasseries de saké conserve un charme d'antan.
Traversée par les eaux vives de la Miya gawa et entourée de sommets protecteurs, Takayama, ancienne place fortifiée située pratiquement au centre du Japon dans la préfecture de Gifu, se niche dans une belle vallée.
Appelée la " petite Kyoto des Alpes " japonaises car ses rues sont tracées en damier à l'image de l'ancienne capitale impériale, elle fut édifiée au XVIe siècle par le clan Kanamori.
Les artisans charpentiers de cette province étaient réputés pour leur habileté. Leur savoir-faire se retrouve dans les plus beaux édifices bouddhiques et demeures seigneuriales érigés dans les capitales de Nara et de Kyoto.
18H10 arrivée à l'hôtel et nous devons faire vite pour à 19H00 déjeuner dans un restaurant local proche, le "Salute" avec menu de gastronomie italienne, (salade, soupe,jambon, frites, pizza, spaghetti et dessert).
Nuit à l'hôtel de Takayama : Best Western Hotel (3*).
Jour 9 : Jeudi 04 Octobre 2018.
TAKAYAMA / MATSUMOTO / HAKONE.
7H00 petit déjeuner à l'hôtel au niveau 1, restaurant "Bijou" avec buffets japonais et continental.
8H00 nous prenons le car pour aller déambuler dans une rue typique et commerçante de Takayama puis visiter une brasserie de Saké Funasaka Shuzo et en prime dégustation de cett alcool de riz fermenté en tonneaux de cèdre du japon. Dommage qu'il soit très tôt ! Si son tau d'alcool est de 15 pour cent, la qualité du saké est liée au reste de riz (en pourcentage) après son polissage.
Départ en autocar pour Matsumoto (55km, 2h00 environ avec une escale technique !).
Durant ce trajet Nicolas nous fait un topo sur nos différences culturelles, le rite des cadeaux, le bon usage des baguettes, le comportement à table (bruits...), l'horaire des repas. Il est aussi de bon ton de connaître l'âge de son interlocuteur pour adapter son niveau de politesse ainsi que son groupe sanguin pour une compatibilité des caractères (ici la personnalité y puise qualités et défauts) !
12H, arrivée à Matsumoto où nous déjeunons dans un restaurant français "Au crieur du vin".
Tour de ville, visite du Château de Matsumoto dont les escaliers en bois sont très raides, la plus forte pente est de 62 degré !
Le château de Matsumoto est à l'instar des châteaux de Himeji, de Hikone et de Inuyama, classé monument historique au patrimoine culturel national. Edifié dans les années 1593-1594, il est le plus ancien château comportant un donjon de 5 niveaux, 6 étages au Japon. Il est caractéristique de l'époque Sengoku et son allure à la fois imposante et distinguée est très appréciée des habitants qui l'appellent familièrement " le corbeau noir ".
Promenade dans Nawate dori, petite rue où se trouvait la frontière du site du château, l'ancienne bordure de la rivière Metoba et la douve du château, jusqu'au début de l'ère Meiji (1868-1912).
La fosse d'eau à côté de Nawate a été remblayée entre 1878 et 1882, Yohashira Jinja (Sanctuaire Shinto de Yohashira) a été construit en 1878 dès le remblai.
L'avènement de Yohashira Jinja a rendu la voie en rue très animée comme une allée à l'accès au sanctuaire, avec beaucoup de petits commerces. La rue piétonne de Nawate est encore maintenant bordée de beaucoup de petits magasins, abritant des pâtisseries japonaises, des sandwicheries, des fruitiers, des fleuristes, des boulangeries etc. En se promenant dans la rue, vous trouverez des objets artistiques liés à la grenouille, Kaeru en japonais ; la grenouille est devenue le symbole de cette rue depuis 1972. La Nawate célèbre la grenouille. C'est donc l'une des rues les plus célèbres à Matsumoto.
16H, départ en autocar pour HAKONE (trajet d'environ 3H30).
19H30, installation dans votre Ryokan notre arrivée est situé au niveau 5 et les chambres sont à des étages supérieurs.
20H00, au niveau 3 dîner sur place en tenue locale (yukata), photographies du groupe, et restauration typiquement japonaise.
Hotel Okuyumoto (Ryokan), auberge traditionnelle.
Une expérience à ne pas manquer : hébergement simple typiquement japonais, nuit sur futon au sol (pas de lit occidental), vous pourrez profiter des bains thermaux chauds, environ 40° Celsius, sur place au Ryokan.
Jour 10 : Vendredi 05 Octobre 2018.
HAKONE / KAMAKURA / TOKYO.
7H00, petit déjeuner à l'hôtel (niveau 5 du Ryokan avec buffets japonais et continental. .
8H00, visite de Hakone :
Hakone, est connu pour ses sources chaudes. La ville est perchée dans la très belle région montagneuse où se trouve le Parc National de Fuji-Hakone-Izu et à Owakudani, surnommé la Grande Vallée Bouillante, où jets de vapeur d'eau et de souffre jaillissent de crevasses dissimulées dans la roche.
Le Lac Ashinoko offre une vue imprenable sur le Mont Fuji. Le Mont Fuji, culminant à 3 776 mètres d'altitude, est le plus haut sommet du Japon, mais est également le premier symbole du pays.
9H00, après la traversée d'une boutique, il faut emprunter un escalier descendant vers le quai afin d'embarquer pour une mini-croisière (20 minutes environ) sur le lac Ashi qui possède un joli "Tojii" (porte de sanctuaire où l'on vénère un dieu en forme de dragon à 9 têtes). Ce tojii semble flotter sur l'eau du lac.
C'est un lac d'altitude 700 mètres dans le cratère d'Hakone dans la préfecture de Kanagawa au Japon. Le lac de 21 km de circonférence, se situe au sein d'un volcan le "Hakone", qui s'est formé il y a environ 3000 ans à la suite d'une explosion phréatique qui fit s'effondrer une partie du mont Kami, creusant les gorges de la rivière Haya-kawa et le lac Ashi.
Malheureusement le temps n'est pas de la partie et brume ou brouillard ne permettent pas d'apercevoir le mont Fuji.
Nous quittons le navire au deuxième arrêt afin d'emprunter le téléphérique qui devrait nous permettre de découvrir la région et faciliter l'ascension du MONT HAKONE Au loin vous pourrez voir Owakudani qui est un ancien cratère où se produisent encore des phénomènes volcaniques : sources d'eau chaude, fumerolles, etc...
Au sommet du téléphérique (Altitude 1300 m), nous traversons une boutique puis une petite marche vivifiante en plein air nous amène à ce qui par temps clair est un joli point de vue sur le Mont Fuji. En bref nous n'avons rien vu à cause de la météo !
10H45, continuation en autocar vers KAMAKURA (65km environ 2h00).
Pour meubler et égayer ce trajet, Nicolas nous parle des jeux traditionnels ou actuellement à la mode au Japon. Citons le Bilboquet japonais, les sumo-toupies, les autres modèles de toupies, les casse-tête, l'origami (pliage de papier), jeux électroniques et informatiques...
KAMAKURA est située au bord de l'Océan Pacifique, sur la Péninsule de Miura.
C'est une petite ville côtière, émaillée de temples à l'atmosphère feutrée. De la présence du gouvernement féodal qui y prit ses quartiers en 1192, elle garde auJourd'hui un héritage historique de toute première importance. Les 5 grands temples célèbres font ici doucement glisser le promeneur vers le 12e siècle, en pleine période de Kamakura.
Déjeuner de spécialités japonaises dans un restaurant.
Visite en premier du Grand Bouddha ou " Daibutsu " qui est une statue géante en bronze faite de 8 parties, haute de 11,40 mètres de haut et de 122 tonnes qui médite en position du lotus, sous la voûte céleste. Il est fait de plaques de bronze assemblées sur une structure creuse et il est possible de pénétrer dans le monument. Il fut achevé en 1252 grâce à Minamoto Yorimoto pour rivaliser avec le Bouddha de Nara qui était alors plus imposant.
On continue par le sanctuaire de Tsurugaoka. Le " Hongu " ou édifice principal du sanctuaire s'ouvre sur une vue magnifique de la ville de Kamakura.
Le Sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu est le symbole de la vieille capitale. Le sanctuaire a été fondé par Minamoto Yoritoshi, ancêtre du shogun Minamoto Yorimoto l'instaurateur du gouvernement féodal de Kamakura qui régna sur le Japon de 1192 à 1333. Les environs du sanctuaire regorgent de lieux d'intérêts : le trésor, les jardins avec des étangs et les restes d'un arbre ginko gigantesque dont on disait qu'il était vieux de 1000ans, avant qu'il ne soit frappé par la foudre le 10mars 2010. Il faut gravir 61 marches de pierre pour accéder au bâtiment principal du sanctuaire.
Cette fois, c'est la pluie qui a gaché la visite et les prises de vues !
15H45, retour au car pour se diriger vers Tokyo où les embouteillages nous accueillent ! .
Arrivée à l'hôtel vers 18H15.
19H30, dîner dans un restaurant du niveau 1 de l'hôtel (Rez de Chaussée).
Nuit à l'hôtel.
DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU (4*).

Tokyo Tour Sky Tree de 634m.
Jour 11 : Samedi 06 Octobre 2018.
TOKYO.
Météo : aujourd'hui la température débute le matin à 18° Celsius avec nuages et montera jusqu'à 28° Celsius avec soleil en après-midi.
6H30, petit déjeuner au 25ième étage de l'hôtel, buffets japonais et continental.
9H00, départ en autocar pour la visite de Tokyo.
A l'Est du centre de Tokyo, nous pourrons admirer "Sky Tree", la nouvelle tour de Tokyo haute de 634 mètres dont la partie supérieure est réservée aux services techniques de télécommunications, radio et télévision (antennes...).
Dans le quartier du temple ASAKUSA, nous parcourons une allée marchande délimitée à chaque extrémité par une lanterne pesant environ 700 kg, puis à 10H00 et quelques boutiques, visite de ce temple sanctuaire qui aurait été fondé au VIIème siècle par trois pêcheurs.
Asakusa était le nom d'un petit village, sur la rive ouest de la rivière Sumida, qui se développa autour du temple Sensô pendant l'ère Edo (1603-1867).
AuJourd'hui Asakusa est le quartier le plus populaire de Tokyo car il a conservé l'atmosphère de la cité d'Edo d'antan. N'oubliez surtout pas d'aller caresser la tête du Bouddha BOTOKESAN NADI à la recherche d'une guérison ou de bons augures.
Reprise du car qui nous dépose pour une balade dans le quartier Akihabara qui est l'un des quartiers les plus connus de la capitale japonaise. Il est particulièrement populaire auprès de la population geek et on l'appelle d'ailleurs la "ville électrique". C'est l'un des quartiers de Tokyo les plus visités par les touristes étrangers, en particulier les jeunes, et pour cause, il s'agit du quartier électronique qui fait le bonheur des Otaku.
Un temps libre nous est accordé dans ce quartier très vibrant et sonore (Salons de jeux vidéo etKaraoké), afin de faire quelques achats par exemple d'accessoires photo-video ou de "Manga" (bandes dessinées, figurines, déguisements) !
12H15, direction pause déjeuner japonais dans de petits boxes avec fosse pour les jambes, table basse et barbecue de table pour cuire la viande.
13H15, reprise de l'autocar afin de découvrir Tokyo de manière originale : en effectuant une croisière Nord-Sud sur la rivière Sumida, qui traverse Tokyo ! Durant 40 minutes, vous aurez un panorama unique sur la ville et pourrez observer tous les buildings qui font de Tokyo une ville incomparable ! En tout, la rivière Sumida s'étire sur 27 kilomètres et est traversée par 26 ponts qui ont tous une architecture différente. Préparez votre appareil photo pour des prises de vue grandioses sur la ville et sa baie.
Avant de reprendre le car nous traversons un petit jardin.
Puis découverte extérieure du Tokyo Imperial Pa lace. C'est la résidence principale de l'Empereur du Japon. Il est situé dans un parc dans le quartier Chiyoda et est constitué de plusieurs bâtiments : le palais Kykden, la résidence privée de la famille impériale, un musée et les bureaux administratifs. Il est construit sur l'ancien site du château Edo. On peut admirer une très belle statue équestre d'un Samouraï vivant entre le 12ième et le 13ième siècle. .
16H, reprise du car pour aller découvrir le quartier de SHINJUKU et le complexe des BUREAUX METROPOLITAINS du gouvernement de Tokyo, plus simplement la " Mairie " de la ville même si ses fonctions vont au-delà de la cité... Le bâtiment, commencé en avril 1988 et achevé en décembre 1990, formé de deux tours jumelles de 48 étages, était le plus haut de la ville (244m) jusqu'en 2006. Il a été conçu par l'architecte Kenzo Tange inspiré par les tours de Notre-Dame de Paris, et l'accès aux deux tours est libre et gratuit. Au 45ième étage, l'observatoire, à 202m, permet de découvrir de très belles vues d'ensemble de l'est de Tokyo et aussi le sud-ouest, vers le Mont Fuji que nous ne verrons pas aujourd'hui ! Le bâtiment se compose d'un complexe de trois structures.
Nous pourrons ainsi admirer le centre de Tokyo avec ses buildings dont la Sky Tree de 634 mètres mais aussi au loin un peu de la banlieue de cette mégalopole.
Pour monter, nous prenons l'ascenseur au niveau 1 (RDC) mais lorsque nous redescendons, la sortie se fait au niveau 2 et ainsi les flux des visiteurs ne se croisent pas.
Dîner dans un restaurant tenu par un Sumo retraité dont la spécialité est "La marmite du Sumo". Table basse, jambes dans la fosse et tous les plats servis en même temps. Dommage que ce restaurant soit d'ambiance très bruyante (Japonais en sortie détente et passage sonore du métro au-dessus de nos têtes).
Nuit à l'hôtel.
DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU (4*).

Tokyo Tower en Metal Rouge de 333m.
Jour 12 : Dimanche 07 Octobre 2018.
TOKYO / PARIS.
6H30, petit déjeuner à l'étage 25 de l'hôtel.
9H00, continuation de la visite de la ville de Tokyo.
Visite du Musée National de Tokyo : immensément riche en témoignages de l'histoire japonaise avec des sculptures, peintures, calligraphies, costumes et tissus anciens, armures, céramiques, objets en bois laqué.
Visite de la galerie des trésors du Horyu-ji. C'est l'un des quatre bâtiments principaux de ce vaste Musée National. Cette galerie abrite 319 pièces du trésor du temple d'Horyuji, pour la plupart du 8ème ou du 9ème siècle, données à la famille impériale japonaise en 1878. La famille impériale a ouvert ce trésor au public à la fin du 19ème siècle. -fermé le lundi.
Il nous reste un peu de temps libre pour visiter le célèbre parc Ueno, situé en face du musée et qui comprend entre autre un zoo 'couple de Panda et bébé), la célèbre allée des cerisiers, un sanctuaire et un batiment de l'architecte Le Corbusier (musée de l'Art Occidental).
12H, reprise du car pour se rendre au restaurant et faire un déjeuner avec expérience culinaire japonaise :
Watami, le chef nous fait un cours de sushis avec dégustation dans son restaurant. Nous revêtons pour la circonstance une toque, une blouse ainsi que des gants afin de suivre d'abord le découpage du poisson cru puis nous fabriquons nos propres sushis avec du riz et une petite tranche de poisson cru (saumon, thons...). En fin de repas, un diplôme nous est remis...
Après-midi libre, le car nous dépose avenue Omote-Sando (Champs Elysées de Tokyo pour une découverte personnelle de la ville qui nous paraît grouillante d'une population remarquablement disciplinée dans le déplacement piéton.
Il y a 14 lignes de métro à Tokyo.
19H45, l'autocar nous reprends là où il nous avait déposé c'est à dire avenue Omote-Sando (Champs Elysées de Tokyo) pour un trajet de 30 minutes vers l'aéroport "Haneda" de Tokyo.
Nous offrons de bonnes bouteilles de Saké à notre sympathique conducteur de car et à notre guide Nicolas très efficace dans ce séjour. Ce dernier nous aidera dans nos formalités d'enregistrement.
23H, envol à destination de Paris.
Prestations à bord.
Jour 13 : Lundi 08 Octobre 2018.
PARIS.
Arrivée à Paris à 4H dumatin (heure locale) après environ 12H de vol dans un Boeing 777-300 dont le nombre de toilettes était insuffisant !
Fin de nos services.

Borne KM Montelimar Tokio 2.
Ambassades.
1. Ambassade du Japon à Paris, France :
7, avenue Hoche
75008 Paris France
Téléphone : (+33) 1 48.88.62.00
Fax : (+33) 1 42.27.50.81
Email : consul@ps.mofa.go.jp
et
Email : info-fr@ps.mofa.go.jp
Site Web : http://www.fr.emb-japan.go.jp
http://www.fr.emb-japan.go.jp/
Chef de mission : Mr Masato Kitera, Ambassadeur.
2. Ambassade de France à Tokyo, Japon :
4-11-44, Minami-Azabu
Minato-Ku
Tokyo, 106
Japon
Téléphone : (+81) (3) 5798-6000
Fax : (+81) (3) 5798-6206
Site Web : https://jp.ambafrance.org
https://jp.ambafrance.org/
Chef de mission : Mr Thierry Dana, Ambassadeur.
Architecture au Japon.
-Style T'ang :
Il s'agit d'une volonté de symétrie des bâtiments. Les Japonais l'ont particulièrement développée pendant la période Heian. Les sanctuaires Heian et le Byodo-in en sont les répliques.
-Style Shinden (Shinden zukuri) :
Pendant la période Heian, c'est le style ouvert qui permet la circulation des flux dans les demeures aristocratiques. Il n'en reste plus d'exemple authentique.
-Style Shoin (Shoin zukuri) :
C'est une version plus élaborée et plus épurée du style shinden. On l'appelle aussi sukiya.
-Style Soan:
Le style Soan met en valeur les principes de la cérémonie du thé et une espèce d'espace à la fois magique et vide où règnent la précision et l'asymétrie.
-Matériaux et principes de construction :
La plupart des matériaux de construction sont d'origine végétale. Pour de grosses oeuvres, le matériau le plus utilisé pour les édifices traditionnels ou les maisons, est le bois de résineux : pin, sapin, cyprès, cèdre. Les feuillus (châtaignier, noisetier, chêne) sont utilisés pour les meubles. Les remplissages des panneaux coulissants sont constitués de feuilles de mûrier. Enfin, le bambou sert pour les lattis de bois, qu'on enduit ensuite d'un mélange d'argile, de sable et de paille hachée, pour réaliser les murs de la maison. Parfois, on a recours à de la chaux hydratée à partir de coquilles d'huîtres. Les tatamis sont constitués de paille de riz battue et pressée, recouverte d'une natte d'herbe tissée. La dimension du tatami est fixée dans l'espace par deux colonnes, le ken, soit en moyenne 1,86 m x 0,93 m.
Deux tatamis constituent un carré d'une surface d'un tsubo soit 3,46 m². Le travail du bois a entraîné l'innovation de la technique de l'ossature. Les murs ne sont pas porteurs et servent à distribuer l'espace en fonction des besoins. Les panneaux sont coulissants ou carrément amovibles. À partir de l'époque Muromachi, on voit apparaître une standardisation qui non seulement va modifier la conception de l'espace, mais aussi lui donner le fondement même de son esthétique et de son originalité. Il s'agit du tatami qui, de dimension à peu près semblable dans tout le Japon, va permettre la modulation de l'espace. On construit sur pilotis, généralement sur une terrasse préalablement préparée. Le bâtiment est horizontal pour s'immiscer dans la nature et permettre, grâce à l'usage des panneaux coulissants et des coursives, un rapport dedans-dehors, et surtout la captation et la diffusion de la lumière. Cette distribution met en valeur les matériaux naturels, les expose aux intempéries et leur accorde une patine pure. Si l'architecture japonaise a emprunté largement au système chinois par l'adoption des principes de toiture, elle s'en est détournée dans la mesure où elle a abandonné la rigueur des éléments de la géomancie chinoise.
C'est vraisemblablement le syncrétisme shinto-bouddhique qui permet aux Japonais de s'évader et de créer leur propre architecture. Toute la subtilité japonaise se concentrera sur le refus du monumental et un équilibre particulier entre les espaces et les volumes.
-Constructions postérieures :
Les transformations ultérieures utilisent une dissymétrie de la section transversale afin d'aménager un espace à des fins rituelles pour les fidèles. On aménage alors une structure indépendante de la structure primitive pour dégager un nouvel espace devant l'image sainte. Pour conserver la construction symétrique du toit, on eut recours à deux innovations.
Un double système de poutres. Les poutres inférieures reposent sur des colonnes qui sont à présent libres de ne pas se conformer à une symétrie par rapport à l'axe longitudinal. Plus haut, les poutres sont supportées par des poteaux qui reposent sur les poutres inférieures disposées sans tenir compte de la position des colonnes.
La liaison entre les colonnes repose sur la taille des poutres et des poteaux jusqu'à l'ajustement de ceux-ci. De même, on utilise cette méthode empirique pour la façon des corbeaux calés qui soutiennent les avant-toits. Pour mener à bien ces charpentes tri-directionnelles, il fallait renforcer les colonnes. Les poutres joignent les colonnes dans les deux directions. Si les pannes sont soutenues par des poteaux régulièrement espacés, les trames de points d'appui sont libres. Par un système qui fait appel à trois solives déployées sur la longueur du bâtiment et par des poutres qui relient les colonnes dans les deux directions, la charpente japonaise s'affranchit de la charpente chinoise.
Plus tard, les procédés d'assemblage permirent de mettre au point des encorbellements par gestion de corbeaux et de cales et ainsi de construire d'une manière juste et rationnelle les angles des toits. Les dimensions des sanctuaires, des temples et des maisons obéissent aux mêmes lois : le kendont. La dimension locale varie entre 1,80 m et 1,90 m. L'espace intérieur est calculé en ken au carré qui, si on applique le tatami à 1,85 m, fait 3,45 m² environ. Le bois est pratiquement toujours laissé naturel, ce qui lui permet de se patiner avec les intempéries et de résister aux changements de température et à l'humidité. D'ailleurs, les Japonais utilisent le jeu du bois à des fins positives : ils fendent les piliers afin qu'en gonflant ceux-ci ne se déforment pas et puissent épouser les mouvements du sol lors des tremblements de terre.
-Architecture résidentielle
La codification des éléments architecturaux s'intensifie à partir de l'époque Nara, puis de l'époque Heian (Kyoto). Elle prend le nom de Shinden ou Shinden-zukuri.
La résidence, réservée aux grandes familles nobles, comprend un bâtiment principal (shinden) entouré sur trois côtés de bâtiments annexes (taï no ya) reliés au bâtiment principal par des coursives ou des corridors.
Devant la résidence se trouve un étang avec des îlots réunis un à un par des ponts. Toutes ces constructions obéissent à la géomancie chinoise, et les ruisseaux d'eau pure qui alimentent l'étang doivent être orientés selon un axe immuable nord-ouest sud-est. Les planchers de ces bâtiments sont en bois et les murs sont constitués de vantaux (shitomido) qu'on place ou déplace à volonté selon les saisons. La superficie totale de ces aménagements pouvait atteindre un hectare ou plus. En plus des bâtiments principaux, il y avait des pavillons reliés par des galeries couvertes et des postes de garde.
L'ensemble était entièrement clos et percé de plusieurs portes disposées aux points cardinaux, dont celle du sud faisait office de porte principale. Ces résidences ont aujourd'hui totalement disparu. Il ne nous en reste que des témoignages sur les rouleaux (emakimono) qui datent de l'époque Heian. Sur ces rouleaux enluminés, dessins et textes s'alternent. À l'époque Kamakura se développe un style particulier pour les résidences de samouraïs, dans le style des auberges de campagne avec un bâtiment principal situé sur un terrain clos.
De part et d'autre, se trouvent des appentis pour la cuisine et les chevaux. Derrière s'étend un jardin dont le style reprend les grandes lignes du style shinden, mais qui, peu à peu, s'inspire des jardins Zen favorables à la contemplation et la méditation.
-Style shoin-zukuri :
À partir de l'époque Muromachi, des modifications d'une grande importance surviennent : l'apparition du tokonoma comme alcôve symbolique et la standardisation des tatamis. Apparaît également l'architecture si caractéristique des maisons de thé (sukiya). Le style shoin-zukuri, d'inspiration chinoise, s'applique aux résidences aristocratiques de la fin du XVIe siècle.
Le plan carré est orienté nord sud avec l'entrée principale au sud. La porte (chu-mon) ouvre sur le bâtiment principal par une véranda qui entoure cette construction. Autrefois, le volume du pavillon central était divisé par des paravents.
À présent, il est divisé en plusieurs pièces par des panneaux coulissants. À la place des portes suspendues en bois, sont installés les shoji (panneaux coulissants en bois léger quadrillé et dont les vides sont recouverts de papier blanc translucide afin de tamiser la lumière et de provoquer un effet de contre-jour), protégés des éléments par des volets réticulés en bambou fin. Les tatamis recouvrent les planchers.
-Architecture bouddhique :
C'est à la Corée que le Japon emprunte les différents éléments de l'architecture des temples. D'abord, un pavillon où sont installées les images et les sculptures pieuses, le kondo, puis un pavillon à destination didactique, le kodo, réservé à l'enseignement des religieux et aux sermons, une pagode, et généralement des quartiers monastiques qui font figure d'enceinte.
Le plus vieux temple bouddhique japonais est le Horyu-ji, à Ikaruga, près de Nara. Il représente aujourd'hui la plus vieille structure en bois du monde. Les Japonais changent l'axe primitif nord-sud sino-coréen, tout en gardant leur système de construction.
Par la suite, que ce soit pour la construction du Toshodaïji ou du Todaïji, une scrupuleuse orthodoxie est respectée dans l'agencement des bâtiments par rapport à l'axe sino-coréen. C'est pour établir les édifices des sectes Tendaï et Shingon que l'architecture va s'affranchir de ses modèles : utilisation des courbes de niveau dans les montagnes, nouveaux axes de symétrie et nouvelles perspectives. Avec la nouvelle capitale (Kyoto), et le développement du culte d'Amida, plusieurs temples sont orientés vers l'est pour faire face au paradis de l'ouest. Les styles de construction des temples bouddhiques relèvent de trois tendances : le wa-yo (japonais), le kara-yo (chinois) et enfin le tenjiku-yo.
Le style wa-yo concerne plutôt la période Kamakura : pente faible des toitures et solives alignées horizontalement, fenêtres carrées et utilisation des étais pour consolider la fixation des poutres entre les piliers.
Pendant les périodes Kamakura et Muromachi, le plan des temples évolue vers une dissymétrie organisée autour d'une volonté de souligner la pratique liturgique des nouvelles sectes bouddhiques. Cette dissymétrie, marquée par l'espacement des colonnes, laisse entrevoir une autre architecture qui allait tirer parti de la structure du toit et des effets dus à l'empilage des consoles standardisées. En 1199, les Japonais construisent le nandaimon du Todaï-ji. Les supports des encorbellements traversent les piliers principaux, les solives supportant les auvents sont utilisées en éventail pour répartir les forces, et les dés des entablements sont tous de même taille. Cette standardisation devient habituelle pendant l'époque Kamakura. Ce style dépouillé et rapide de construction prend le nom de tenjiku-yo.
Quant au kara-yo, ou style chinois, il est utilisé surtout dans l'édification des temples Zen en combinaison avec le style wa-yo. Les angles des toits sont plus accentués, les solives également utilisées en éventail, et les poutres reliant les piliers adoptent la forme ebi-koryo, ou « écrevisse ». On galbe la partie lintale des fenêtres.
-Architecture shinto :
Les premiers fondements de son architecture naissent pendant la période Yayoi avec la construction d'un certain type de grenier. On enfonce les piliers profondément, les toitures sont à double pente, et les cloisons faites de planches juxtaposées. Ce style d'architecture employé pour les kura (greniers) sera transformé plus tard en procédé azekura-zukuri afin de bâtir de grands sanctuaires, comme Ise et Izumo.
Par la suite, onze styles différents marquent une progression dans la maîtrise de l'espace, fortement influencés par les procédés de construction bouddhiques.
Les styles Taisha pour le sanctuaire d'Izumo, avec une entrée sur le côté accessible par un escalier.
Le style Shimmei, avec une entrée sur un des grands côtés comme à Ise.
Le style Otori, avec l'entrée dans le pignon de face.
Les styles Kasuga et Nagare avec des toits et auvents au-dessus de l'entrée du pignon et toits incurvés.
Le style Hachiman, qui accole deux salles reliées par leurs toits incurvés avec une gouttière commune.
Le style Gongen, qui prend toute sa force au XVIIe siècle et dont le représentant le plus prestigieux reste le sanctuaire d'Iyeasu Tokugawa, le Toshogu, à Nikko.
-Le wabi et le sabi :
Le sabi est une esthétique qui fut développée durant la période Muromachi. C'est le concept de rigueur et de sobriété qui s'impose par rapport au paraître ou à l'exubérance : ce qui importe est l'essence des choses et non leur apparence. Cette exigence esthétique se retrouve dans la cérémonie du thé (cha-no-yu) et dans l'architecture des pavillons de thé (chashitsu).
Les ustensiles utilisés doivent également répondre à cette exigence. On peut souligner le sentiment de résignation dans le concept de sabi. Dès le XIIe siècle, il est développé en littérature et en poésie. C'est le poète Basho qui le porte à son apogée. Le wabi désigne le détachement, une espèce de langueur ou peut-être même une pointe de mélancolie. Ce sentiment, comme le sabi, fut développé à l'ère de Kamakura et perdura comme une composante esthétique. Il s'approche de la rusticité, mais fait appel à un mouvement de solitude et de simplicité. Il doit tendre vers la beauté pure et désintéressée des choses.
Ces deux concepts, sabi et wabi, sont rejoints par le yugen, qui est la tentative de recouvrir les choses d'une délicate pellicule de mystère et de beauté. Ce mystère peut également osciller entre la tristesse et la mélancolie. C'est dans le No, à partir du XVe siècle, que l'on travaille à ce sentiment de suggestion plus qu'à sa description.
Les écrivains du XVIe siècle l'ont mis en valeur par des touches allusives qui caressent l'essence des choses. Il est davantage un concept harmonique que la délicatesse d'une chose. Dans l'art de la peinture, on retrouve également, avec le yojo, cet esprit suggestif. On parle également du shibui, un raffinement qui se cache derrière une apparente banalité. En littérature, le shibui, le wabi et le sabi sont appelés également heitammi, lorsqu'on est arrivé à vaincre toute chose inutile ou tout maniérisme.

Tokyo Tour Skytree 634m.
Architecture Futuriste.
Déja en 1958 à Tokyo on a sur le modèle "Tour Eiffel" édifié la "Tokyo Tower" haute de 333m, mais aujourd'hui de nombreux "gratte-ciel sont présents au coeur des grandes villes japonaises comme à Tokyo, Kyoto, Osaka...
Tous ces bâtiments observent des normes anti-sismiques rigoureuses et sont également prévues afin de résister aux nombreux typhons de cette région.
La "Skytree" (Tokyo Sukaitsuri) est une tour destinée à la radiodiffusion du Japon et est située à Tokyo dans l'arrondissement Sumida.
Haute de 634 mètres, elle devient, le jour de son inauguration en 2012, la deuxième plus haute structure autoportante du monde.
Sa construction débute le 14 Juillet 2008 et s'achève le 29 Février 2012 avec une ouverture oficielle le 22 Mai de la même année.
Son coût s'élève à 65 milliards de yen soit 550 millions d'euro.
Son architecture est de style néo-futuriste à structure en acier qui sélève à 634 mètres en comprenant son antenne de radiodiffusion. La hauteur du toit est de 495 mètres et celle du dernier étage de 451,20 m.
Elle comporte 32 étages au-dessus du sol et 3 au-dessous et possède 13 ascenseurs.
Elle abrite des activités de Radiodiffusion, de Communication, d'observation, mais aussi des restaurants.
*Circulation Automobile.
Le problème majeur dans les villes, outre les embouteillages, reste la difficulté à se garer (quasiment aucune place le long des trottoirs).
Pour le code de la route, il faut savoir que les automobilistes roulent à gauche. La vitesse est limitée à 80 km/h sur les autoroutes, 40 km/h sur les autres routes.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire y compris pour les passagers d'un autocar !
Le tau d'alcoolémie est ici 0...
Voyager en voiture coûte assez cher. Le litre d'essence avoisine les 150 ¥, et les péages sur les autoroutes reviennent environ à 25 ¥ par kilomètre (tarifs en2017).
Le moteur Diésel est souvent interdit dans les grandes villes et le plus souvent il faut recourir aux voitures à moteur hybride.
Formalités de permis de conduir :
Un permis de conduire international issu d'un permis français n'est pas valable au Japon, car les gouvernements français et japonais n'ont pas signé la même convention.
Pour les voyageurs possédant un permis français et restant moins d'un an au Japon, le permis français n'est valable que s'il est accompagné d'une traduction.
Pour cela, il faut se rendre auprès de l'ambassade de France à Tokyo, du consulat de France à Osaka (frais de 20 € environ et délai approximatif d'une journée), ou contacter la Japan Automobile Federation :
+81 357 300 111
Site : http:// www.jaf.or.jp/e
Les permis internationaux issus de permis des pays qui ont signé la convention de Genève (Suisse, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Luxembourg, Monaco, Algérie, Tunisie, Maroc et Haïti) sont valables.
Monnaie.
La monnaie japonaise est le yen (JPY ou ¥).
On trouve des pièces de 1, 5, 10, 50, 100 et 500 ¥ et des billets de 1 000 ¥, (2 000 ¥ assez rares), 5 000 ¥ et 10 000 ¥.
Taux de change :
Environ 1 € = 130 ¥ (juillet 2017).
Moyens de paiement :
Payer en espèces est le moyen le plus courant pour régler ses achats puisque les Japonais n'utilisent pas de chéquiers et se servent beaucoup moins des cartes bancaires que ne le font les Européens ou les Nord-Américains. Les chèques de voyage sont acceptés dans les banques et d'une façon générale dans les hôtels, bureaux de poste et magasins importants des villes principales. Les cartes de crédit internationales comme American Express, Visa, MasterCard et Diners sont acceptées dans les grands magasins et les grands hôtels. En revanche, dans les petits et moyens hôtels, les ryokans (auberges japonaises) et la plupart des restaurants, les cartes de crédit ne sont pas toujours acceptées. D'autre part, il existe peu de distributeurs automatiques qui délivrent directement des yens au moyen d'une carte de crédit internationale. La Citibank est sans aucun doute la plus utilisée par les touristes, mais vous pouvez vous rendre sans problème dans les bureaux de poste ou les magasins 7-Eleven. Les banques ferment généralement à 17h, mais dans certaines on peut encore utiliser les distributeurs automatiques assez tard dans la nuit, mais pas avec une carte de crédit internationale permettant les retraits d'argent.
S'il n'est pas suffisant, pensez à relever le plafond de retrait de votre carte bleue avant votre départ car sur place la majorité des transactions se fait en espèces.
Conseil :
Il est judicieux d'emmener des liquidités ou de changer en France des Euro en Yen car sur place tout retrait bancaire occasionnera des frais importants.

Haiku gravure sur pierre.
Art et Artisanat au Japon.
Parmi les nombreuses disciplines artistiques pratiquées au Japon, citons :
La Calligraphie, la Céramique, le Cinéma, la Danse, l'Art Floral et des Jardins, la Gastronomie, l'Art de la Laque, la Littérature et Poèmes (Haïku), la Musique, la Peinture et les Estampes, la Sculpture, le Théâtre (No, Kabuki)...
La forme poétique du "Haïku" comporte 3 vers composés successivement de 5 syllabes, puis 7 et enfin 5 pour le dernier.
Voici la traduction possible de l'un des plus célèbres haïkus japonais, écrit par le premier des quatre maîtres classiques, "Basho" :
" Un vieil étang, une grenouille qui plonge, le bruit de l'eau. " '''
Un haÏku est un petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. Il ne se contente pas de décrire les choses, il nécessite le détachement de l'auteur. Il traduit le plus souvent une sensation. Il est comme une sorte d'instantané. Cela traduit une émotion, un sentiment passager, le haïku ne se travaille pas, il est rapide et concis. Il n'exclut cependant pas l'humour mais incite à la réflexion.
Un auteur français, Jacques Arnold écrit :
" Jasons : Dieu merci, ça sent si bon sa forêt, la soupe au persil. " '''
Dans un autre style plus moderne, alliant l'écrit et le dessin, le "Manga" bande dessinée japonaise est très apprécié.
Si vous souhaitez par exemple trouver le célèbre "Dragon Ball" on peut se référer au site internet :
http://glenatmanga.com

Avion en plein ciel avec vue 600 km du Japon .
Transports Aériens.
VOS HORAIRES DE VOLS AIR FRANCE (à titre indicatif).
1. Trajet Aller :
Vol Air France : AF292 Avion type Boeing 787-900.
PARIS (France) / OSAKA (Japon).
-Aéroport de Roissy (CDG) : 13H35
-Osaka Kansai International Airport : 09H15 arrivée le lendemain.
2. Trajet Retour :
Vol Air France : AF293 Avion type Boeing 777-300ER.
TOKYO (Japon) / PARIS (France).
Tokyo aéroport Haneda : 22h15
Paris (Roissy CDG) : 04h00 Heure locale, Arrivée le lendemain c'est à dire le lundi 08 Octobre 2018.
Anecdote :
Le voyage Paris Tokyo a été inauguré par Air France, au départ du Bourget en 1933 donc il y a 85 ans et d'Orly le 04 décembre 1952.
Bagages.
Avion : sur les vols Air France à destination du Japon, le poids du bagage en soute est de 23kg et pour le bagage en cabine c'est environ 5 kg mais c'est surtout la taille de celui-ci qui est déterminante.
Sur votre étiquette bagage pas d'adresse personnelle mais indiquer votre nom et votre numéro de portable ainsi que le nom et adresse du premier hôtel au Japon.
Boire au Japon.
-Eau :
Normalement l'eau du robinet au Japon est potable mais en tout cas pas de risque si on veut se laver les dents avec...
Si on ne dispose que de défenses digestives, immunitaires, alimentaires faibles, on peut boire de l'eau bouillie ou de l'eau minérale.
-Bière (biiru) :
La bière est apparue au Japon à la fin du XIXe siècle. Depuis, elle est devenue la boisson la plus populaire du pays. Elle accompagne parfois les repas les plus délicats, plutôt que le saké.
Les marques de bières japonaises les plus connues sont Kirin, Asahi, Sapporo, Yebisu et Suntory, mais on en compte d'autres dans certaines localités. Les canettes valent 250 ¥ dans les distributeurs, et 500 ¥ environ dans les restaurants.
-Saké (nihon shu) :
En japonais, le saké est appelé nihon shu. Rien à voir avec les digestifs qu'il est possible de boire dans un restaurant asiatique en Europe. Ce n'est pas un alcool fort, mais un vin de riz fermenté à 17°. Il existe plus de 2 500 variétés de nihon shu.
Le plus pur et le plus rare s'appelle junmaishu (saké préparé avec du riz pur Yamanishiki), le plus commun sanbaizoshu, et entre les deux, le honjozoshu (qui ne contient pas plus de 25 % d'alcool ajouté).
En plus des grandes marques nationales, des milliers de petits producteurs qui fabriquent leur propre nihon shu (jizake), tentent de se faire une place sur le marché. Le nihon shu est soit karakuchi (sec) ou amakuchi (doux). Il peut se consommer chaud (atsukan) ou froid (reishu).
-Shochu :
Alcool à 30° qui se boit avec de l'eau chaude (oyu-wari) ou avec du soda et du citron (chuhai ou chu-hi).
-Whisky :
Le Japon en quelques années est devenu l'un des plus grands producteur au monde avec deux groupes importants, Suntory et Nikka. Climat tempéré, pureté de l'eau, présence de tourbières, notamment sur l'île d'Hokkaido, les whiskies japonais sont de plus élaborés de façon plus traditionnelle qu'en Écosse. Enfin le whisky de grain est toujours élaboré à partir de maïs, alors qu'en Écosse il a été remplacé par le blé. Le Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013 a été élu meilleur whisky au monde en 2014 ! La cuvée 1980 atteint les 7 000 € !
-Les différents thés :
Il existe différentes variétés de thés japonais.
-Le sen cha est le thé vert le plus connu. Sa qualité et son prix sont très variables. Ses feuilles foncées doivent être infusées dans l'eau bouillante.
-Le ban cha est un thé sen cha de qualité inférieure. Ses feuilles, grandes et claires, sont infusées dans l'eau plutôt tiède.
-Hoji cha est un ban cha au goût fumé.
-L'ama cha a un goût sucré. On le boit lors du hana matsuri (fête des fleurs), au mois d'avril.
-Le genmaicha est un thé fait à partir de riz complet.
-Le matcha est le célèbre thé vert et amer utilisé lors de la cérémonie du thé. La poudre est battue avec un petit fouet jusqu'à obtenir de la mousse à la surface.
-Le gyokuro est considéré comme le meilleur thé vert du Japon. Les feuilles sont plus foncées que celles du sen cha et son arôme est plus fort. Le thé doit être infusé dans une eau refroidie à 50° ou 60 °C environ. Lorsque des clients s'installent dans un restaurant, le personnel sert soit de l'eau, soit du thé (chaud ou froid). Il est toujours possible d'en redemander par la suite. Rien n'oblige le client à commander une autre boisson.
Bonsai-Art

Art du Bonsaï exemples.
Le Bonsaï au Japon.
Un bonsaï ou plus rarement bonzaï est un arbre miniaturisé (ou arbuste), cultivé dans un pot, dont la forme évoque celle des arbres matures dans la nature.
Le mot Bonsaï signifie littéralement "plantes en pot" et s'adresse à de petits arbustes de diverses variétés.
Le bonsaï est un art traditionnel japonais originaire de Chine, dérivé de l'art du penjing, et ce mot n’est en réalité apparu qu’en 1818 pour différencier la pratique de son ancêtre chinois.
Désignant l’art de représenter des paysages en miniature, le penjing est importé sur l’archipel au VIe siècle par des étudiants bouddhistes japonais en retour de Chine.
Sous influence du bouddhisme zen, ces représentations réduites de la nature vont alors faire le bonheur des érudits qui érigent les premiers jardins zen du pays. Soucieux de posséder eux aussi le monde à leurs pieds, la noblesse s’empare du phénomène au XIVe siècle et se prend d’engouement pour des modèles de plus en plus petits.
Il faudra attendre l’époque Edo (1603-1868) pour voir le phénomène toucher d’autres classes sociales.
Des pratiques similaires existent dans d'autres cultures, notamment au Vietnam et en Corée.
Cet arbre est miniaturisé par différentes techniques (taille des branches et racines, gestion des apports nutritifs...) et sa forme est modelée par d'autres techniques (ligature), afin d'en faire une œuvre d'art esthétique ressemblant à l'arbre dans la nature.
Introduits pendant l'ère Heian, les premières représentations nippones de bonsaïs apparaissent au cours de l'ère Kumakura.
Véritable discipline artistique, la taille de ces arbustes, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est en réalité issue d’un savoir-faire millénaire que les Japonais ont su s’approprier au fil des siècles jusqu’à en faire un élément notable de leur propre culture.
Calendrier.
Actuellement, le système de dates en japonais est très lié au calendrier grégorien, même si la numération des années peut différer de celle en vigueur en Occident. On écrit d'abord l'année, ensuite le mois et enfin le jour (sens de la norme ISO 8601). Par exemple le 16 février 2003 peut s'écrire 2003-2-16.
" nen " signifie " année ", " gatsu " signifie " mois " et enfin " nichi " (dont sa prononciation dépend du chiffre qui le précède), signifie " jour ".
Préalablement à l'introduction du calendrier grégorien, en 1873, le calendrier de référence était basé sur le calendrier chinois.
Même si les Japonais utilisent couramment les dates du calendrier grégorien, il subsiste quand même une petite originalité. Ils utilisent bien les semaines de sept jours et les douze mois du calendrier grégorien, mais pour le décompte des années il existe en plus des années du calendrier grégorien un autre décompte en fonction des dates de règne des empereurs. Ces dates sont utilisées dans tous les documents officiels. Dans ce cas, l'année est précédée du nom de l'ère impériale (règne). Par exemple l'année 2002 du calendrier grégorien correspond à l'année 14 de l'ère " Heisei " ( 14 ).
Les nombres s'écrivent principalement en chiffres arabes, même dans le cas du décompte des années japonaises. Les nombres en " kanji " (caractères d'origine chinoise) étant plutôt réservés aux documents calligraphiés, et parfois dans les menus des restaurants au Japon.
Les décennies se disent " nendai " en suffixe à l'année. Les siècles se disent " seiki ".
Pour les dates avant notre ère, il suffit d'ajouter " kigenzen " ( ), devant une date, une décennie ou un siècle.
Le compte calendaire d'ère " Jomon " est un autre système d'années historique au Japon. Il place le début de l'ère courante à 10 000 av. J.-C.
Exemple : le : 5 décembre 1994 se dit sen-kyuhyaku-kuju-yon-nen ju-ni-gatsu itsuka.
À compter de 1876, le mois de janvier a été officiellement considéré comme étant le premier mois de l'année. Toutefois, ce calendrier posait des problèmes de cohérence temporelle pour certaines fêtes traditionnelles, puisque les avançant de 3 à 7 semaines par rapport à leur initiale. Pour diminuer ce décalage, le Japon a inventé des mesures de compromis, en fixant de nouveaux moyens pour déterminer les dates de fête : Tsuki-okure ("Délai d'un mois") et Chureki ("Calendrier éclectique"), permettant de décaler les fêtes d'un mois plein par rapport à leur date transposée en calendrier grégorien. Le nouvel an est le seul qui a échappé à ce décalage, et il se fête le premier janvier.
Le jour du calendrier est très important dans la vie japonaise.
Il faut savoir que les Japonais font extrêmement attention aux jours du calendrier. Outre les jours comme le calendrier occidental, le calendrier japonais est divisé en cycles répétitifs de 6 jours qui correspondent chacun à un jour plus ou moins bon. Par ordre de félicité : Taian (grande sécurité) est le meilleur jour, celui qui sera prioritaire pour fêter un grand événement, Tomobiki et Sensho sont des bons jours, Senpu, Chakko, Butsumetsu sont des mauvais jours. Par conséquent, étant donné que le mariage se célèbre le plus souvent le week-end et qu'il est préférable de choisir un bon jour (de préférence Taian), et que celui-ci n'apparaît qu'une fois tous les 6 jours, il est difficile de réserver son sanctuaire en s'y prenant tardivement.

Calligraphie Tenue du Pinceau dans un Cours Shodo.
Calligraphie Shodo.
La calligraphie, étymologiquement l’art de bien former les caractères d’écritures, se dit en japonais "Shodo" c'est à dire la voie de l’écrit .
Il s’agit de l’art de bien former les caractères d’écriture (kanji ou kana) avec un pinceau calligraphique et l’encre noire. C’est un art de la belle écriture.
Il y a trois styles d’écriture : le style régulier Kai-sho qui vise à ne pas ‘casser’ le modèle (les règles de tracé des caractères) ; le style ‘écriture demi-cursive’ Gyô-sho qui ‘casse’ un peu le modèle ; et le style ‘écriture cursive’ Sô-sho qui ne respecte pas les règles de tracé des caractères.
Dans l’art de la calligraphie, on regarde l’harmonie créée par l’ensemble des caractères, la façon d’utiliser le pinceau, les nuances créées par l’encre, ainsi que la signification que donnent les caractères.
La tradition de la calligraphie a été inventée et a été développée en Chine, et est venue au Japon à l’époque de Nara (710-794).
Pour retrouver tous les signes nécessaires à l'écriture du japonais, il faut connaître trois systèmes : le kanji (caractères empruntés au chinois), le katakana et l'hiragana. Ces deux derniers ne sont autres que des alphabets syllabaires. L'écrit comme la lecture se fait de haut en bas, de droite à gauche et de la dernière page vers la première.

3 Ecritures en Japonais.
La calligraphie a aussi amené des outils (pinceau calligraphique et encre noire) et la technique de la papeterie. Savoir écrire avec un pinceau et l’encre était une éducation indispensable pour la classe de samouraï et l’aristocrate, plus tard il est devenu essentiel pour les autres classes sociales.
Les outils minimums qui doivent être utilisés pour l’art de Shodô sont appelés ‘les 4 trésors du lettré’, ou Bunbô-shihô. Ces trésors sont : la pierre à encre, le pinceau, l’encre noire et le papier. Si vous utilisez le bâton d’encre, il vous faut encore de l’eau.
En plus de ces instruments de calligraphie, il faut connaître tout un art des règles de tracé des caractères ainsi que la position du corps.
Les gestes de base sont : tout d’abord versez un peu d’eau dans la pierre à encre, puis y frottez le bâton d’encre pour obtenir l’encre noire. Puis imbibez de l’encre le pinceau. Lorsque vous tenez le pinceau, placez le pouce, l’index, puis le majeur au milieu d’un pinceau. Il faut tenir le pinceau plus à la verticale que lorsque vous écrivez avec un stylo.
Lorsque vous écrivez, tenez-vous droit, et appuyez la main gauche sur le papier. Comme les caractères (kanji et kana) sont créés pour être écrits à la main droite, il faut utiliser celle-ci pour les écrire.
Les cours de calligraphie au Japon, sont obligatoires en primaire et au collège.
Parmi les premiers témoignages de kanji au Japon, on trouve des poteries avec des caractères incisés dans la panse, le plus ancien exemplaire datant de la fin du Ve siècle. Comme les Japonais n'avaient pas de système d'écriture, ils ont cherché à utiliser les caractères chinois non pas seulement pour écrire le chinois, mais aussi leur propre langue.
Jusqu'à nos jours, sur le plan lexical, les kanji sont ainsi encore essentiellement utilisés, non pour noter des prononciations, mais pour noter des sens.
Climat du Japon.
Difficile de décrire un climat propre au Japon. Il n'en existe pas un type, mais plusieurs.
Il faut dire que l'archipel ne compte pas loin de 7 000 îles et îlots, répartis dans un rayon de 3 800 km.
Il est donc logique de rencontrer des climats variés, sans oublier les variations dues à la montagne à certains endroits.
Il faudra donc compter sur un climat boréal au nord et sur un climat tropical au sud, le centre du Japon étant lui plus tempéré. Les quatre saisons sont bien marquées pour cette dernière zone.
Zone tempérée oblige, Tokyo bénéficie d'un climat relativement doux et agréable tout au long de l'année. Les saisons sont bien marquées, même s'il est très rare qu'il neige dans la capitale nippone. Par contre, les étés sont chauds. Il n'est pas rare de connaître une fin de mois de juillet au-dessus de 30 °C. Et souvent, cette saison est accompagnée de typhons. L'air y est très humide. À noter également la saison des pluies qui intervient généralement de la mi-juin à la mi-juillet.
Le printemps et l'automne sont les hautes saisons touristiques au Japon, surtout pour ce qui est de la visite des temples ou des monts sacrés. Pour éviter les plus fortes affluences, il peut donc être utile de planifier son voyage fin novembre-début décembre, fin février-début mars, ou fin mai et juin. La Golden Week (fin avril-début mai), le O-bon (mi-août) et le O-shogatsu (du 29 décembre au 3 janvier) sont des périodes à éviter pour la recherche d'hébergement.
Le Japon et le décalage horaire.
Le Japon débute sa journée avant la France !
Quand il est midi à Paris il est 20h au Japon en hiver et 19h en été.
Soit + 8h en hiver et +7h en été.
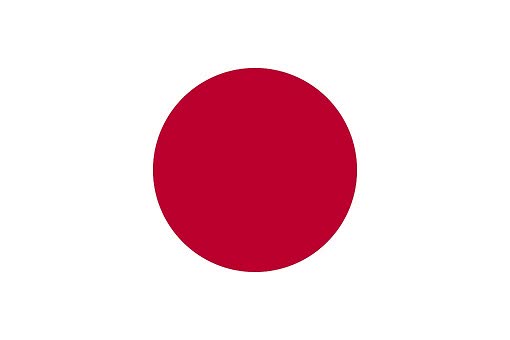
Le Drapeau du Japon.
Drapeau du Japon.
Le drapeau Nisshoki est le drapeau national depuis la Loi relative aux drapeau et hymne nationaux, promulguée et effective depuis le 13 août 1999 même si son Adoption date du 27 février 1870.
Le drapeau du Japon est un drapeau blanc avec un grand disque rouge en son centre (représentant le soleil, plus précisément la déesse Shinto du Soleil Amaterasu).
Il est à la fois, le drapeau civil, le drapeau d'État, le pavillon marchand et le pavillon d'État du Japon.
Il est connu sous le nom de hi no maru no hata, « drapeau au disque solaire »), ou plus officiellement sous le nom de Nisshoki (étendard japonais).
Le rapport entre la hauteur et la largeur du drapeau est de 2/3, et le diamètre du disque est trois cinquièmes de la hauteur du drapeau.
Education.
-En famille :
Mitsugo no tamashi, hyaku made, ou « L'âme des trois premières années dure jusqu'à 100 ans » ... Ce dicton est dans la conscience de tous les Japonais. Ces derniers pensent que les jeux sont faits entre la naissance et la troisième année. Pendant cette période, et d'ailleurs presque jusqu'à l'école primaire, les enfants ne sont soumis à aucun interdit ou règle sévère. Ils sont soignés plus qu'éduqués.
Ils doivent prendre plaisir à vivre. On essaie de faire en sorte, comme disent les Japonais, qu'il n'y ait pas de « trou » dans le coeur de l'enfant, que le lien affectif et physique comme son éloignement (émancipation des enfants) suive un processus bien rempli. Les petits enfants boivent tous au sein maternel, le biberon est traditionnellement peu répandu, mais se développe. Les Japonais dorment avec leurs petits dans le même futon.
-À la maison :
on apprend surtout aux enfants comment se tenir en société pour faire plaisir aux autres ou pour ne pas les gêner, et le relais est pris par l'école, ce qui donne une société paisible et agréable (mais en réalité de moins en moins selon les critères japonais).
-A la naissance :
Désormais, surtout dans les villes, les choses relatives à l'accouchement se passent comme en Europe, mais de plus en plus de femmes refusent d'accoucher dans un hôpital. Ces Japonaises optent pour d'autres formes plus naturelles, gardant l'hôpital comme bouée de secours en cas de force majeure.
Traditionnellement, un enfant qui vient de naître a un an. Il a passé dix mois dans le ventre de sa maman puisque la grossesse est estimée à 40 semaines à compter de l'apparition des dernières règles.
Si l'enfant est né en décembre 2012 par exemple, il aura 1 an ce jour-là, et on n'attendra pas décembre 2013 pour dire qu'il a deux ans, il aura deux ans dès le 1er janvier qui suit sa naissance ! Donc autrefois, tous les Japonais prenaient un an de plus chaque 1er janvier (système appelé kazoedoshi). Par conséquent un enfant né le 31 décembre, avait déjà deux ans le 1er janvier ! Aujourd'hui, la plupart des Japonais ont adopté le système occidental et fêtent les anniversaires.
-L'adoption :
Il est à noter qu'au Japon, l'adoption est encore une coutume très répandue. Un homme n'ayant pas d'enfant adoptera son élève ou le fils d'un de ses amis, ou le fils d'un de ses employés. L'adoption la plus courante est celle du gendre par le beau-père qui n'a pas eu de fils.
-Le bébé :
il est porté traditionnellement sur le dos avec un harnais ou attaché par une bande de tissu. Un certain nombre de fêtes égaiera les premières années de l'enfant jusqu'au célèbre Jusan-mairi, fête qu'on observe plus particulièrement à Kyoto. Les parents et l'enfant se rendent pour ses 13 ans, le 13 mars ou le 13 avril, au sanctuaire.
-L'école :
L'orientation du MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) répond au souci national de la globalisation. À l'ère de la mondialisation, on craint que le côté « co-harmonisateur » propre au tempérament des Japonais ne leur permette pas de bien communiquer sur la scène internationale.
À l'école primaire, les cours s'arrêtent à 14h ou 15h. L'Éducation nationale y prodigue un enseignement de base sur des manuels peu étoffés. Pour faire réussir leurs enfants aux examens, la plupart des Japonais sont attirés par les juku (petites écoles d'appoint) qui occupent les enfants l'après-midi ou dans la soirée.
Les universités d'État sont quasiment gratuites ou très bon marché alors qu'une université privée revient à un million de yens par an au minimum.
-L'enfance :
L'enfant japonais entre rapidement à l'école. Il lui faudra d'abord apprendre à vivre en communauté. Entre 2 et 6 ans, il va soit au jardin d'enfant yochi-en ou au jardin éducatif hoiku-en. Le premier appartient au MEXT et le second au MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare).
Avec des instituteurs, il apprend à chanter et danser, puis à découper et plier. On l'initie à l'origami (technique de pliage), puis à développer des activités de groupe, ce qui n'est pas foncièrement différent d'une maternelle française.
Les crèches d'État sont moins chères, mais peu nombreuses. Des critères de sélection filtrent les candidates. Pour une Japonaise qui travaille, la crèche d'État est une dépense acceptable en fonction du revenu qu'elle pourra tirer de son travail, ce qui n'est plus le cas des crèches privées (entre 15 000 ¥ et 20 000 ¥ par mois pour les crèches d'État contre 60 000 ¥ environ pour les privées).
Après l'école maternelle, l'enfant entre à l'école primaire (shogakko) où il passera six ans. Il devra apprendre progressivement les 1 945 caractères et les 152 signes des syllabaires hiragana et katakana, ce qui n'est pas une torture contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le japonais est une langue très intuitive. La calligraphie et la l'utilisation du soroban (boulier, pour calculer) lui sont également enseignées. Un enseignement pour lui expliquer le fonctionnement d'internet lui est également dispensé. Des cours sont aussi donnés pour apprendre à écrire le romaji (les caractères romains).
Il faut toujours se déchausser pour entrer dans une classe et on enfile des espadrilles simples de couleur blanche (les uwabaki). Au début de chaque semaine, un thème est choisi et travaillé, creusé et mis en valeur. Le nettoyage est assuré par les élèves.
Les cours durent 50 minutes et 10 minutes sont consacrées à la pause. La semaine se déroule du lundi au vendredi. Les élèves déjeunent sur place, dans leurs classes ou dans des réfectoires.
L'année scolaire commence en avril et s'interrompt vers le 20 juillet. Les vacances durent jusqu'à la fin du mois d'août. Petite coutume japonaise, pendant cette « longue » période de plus de quarante jours, les écoliers qui ont le courage de se lever tôt vont participer à la gymnastique du matin à la radio, avec les gens du quartier ou du village (rajio taiso vers 6h30 !). Ils se font mettre un cachet chaque jour sur le livret et à la fin, ils peuvent recevoir une récompense. De septembre à la fin décembre, l'école reprend sans interruption. Les vacances d'hiver durent une quinzaine de jours. L'école reprend alors vers le 6 ou 7 janvier pour s'achever fin mars.
-L'adolescence :
À la fin de l'école primaire, l'enfant entre au lycée pour trois ans, ce qui le mène à 15 ans, âge jusqu'où l'école est obligatoire. À ce niveau, les études supérieures dureront encore trois ans avant l'université. Il faudra, pour y être admis, passer un concours d'entrée et travailler quatre ans de plus pour passer le premier diplôme.
À l'âge de 12 ans, l'apprentissage de l'anglais commence, mais la plupart des professeurs sont Japonais. Chaque lycée (chugakko) encourage la formation de clubs dirigés par les élèves et encadrés par les professeurs : langues étrangères (anglais) ou musique, botanique, art martial.
Au terme des neuf ans d'études, il faut passer un concours d'entrée pour être admis au lycée de cycle secondaire (kotogakko). Les lycées sont publics ou privés. Un nouveau costume est alors revêtu. Il faut désormais se préparer pour le certificat d'études secondaires.
La fin du lycée est sanctionnée par un diplôme simple, qui n'a pas la valeur de notre baccalauréat. Un examen d'entrée sélectionne les étudiants à l'université. Pendant ces trois années, le lycéen développera les matières qu'il lui faudra approfondir à l'université.
À la fin de ses études secondaires, le jeune Japonais ne sait pas parler de langue étrangère malgré les six ans d'apprentissage assidu qui auront été nécessaires, non pour parler, mais pour écrire et répondre à des QCM que l'on retrouvera tout au long du cursus universitaire.
L'étudiant :
Le nouvel étudiant fait partie des 2 800 000 étudiants répartis dans les 450 universités privées ou publiques. Les universités d'État sont beaucoup moins onéreuses que les universités privées (de 950 à 1 600 € par mois), mais le concours d'entrée est extrêmement sélectif.
Les étudiants habitent chez leurs parents, ou dans des pensions ou autres logements bon marché payés par les parents quand l'université est éloignée de la maison familiale. Devenus subitement libres, les jeunes sont happés par l'univers de la grande ville.
Durant leurs études, ils font souvent de petits travaux (arubaito, d'Arbeit en allemand) et peuvent glisser vers des formes de revenus inconnues des parents.
La vie universitaire est également l'occasion d'adhérer à des clubs ou associations diverses, qui deviendront plus tard le foyer des rencontres professionnelles à l'instar des grandes écoles européennes ou nord-américaines. Une fois sorti diplômé d'une université d'État ou privée, toutes deux en relation directe avec les grandes entreprises, l'étudiant devra chercher un travail.
-Education par une activité collective :
Il faut souligner un autre aspect de l'éducation souvent oublié. La plupart des Japonais adultes pratiquent une activité le week-end, poursuivant un but de formation de l'individu. Pour certains, ce sera simplement le fitness club ou le jogging, pour d'autres les arts martiaux, la cérémonie du thé, la lecture des textes anciens, les cours d'anglais ou de musique ou le gate-ball (sorte de croquet) pour les personnes âgées. **
Electricité au Japon.
Les prises sont de type américain comportant 2 lames plates et parallèles.
Le voltage est de 100 Volts avec une fréquence de 50 ou 60 Hertz.
tsurunomai

Grue du Japon - tsurunomai.
Faune du Japon.
La faune ressemble beaucoup à celle de la Chine et de la Corée, à cause des anciennes migrations qui ont eu lieu lorsque le Japon était encore rattaché au reste du continent asiatique. Cependant, certaines espèces du Japon sont uniques, comme la salamandre géante japonaise et le macaque japonais.
Du nord au sud, peuvent encore être aperçus quelques spécimens d'ours bruns, de phoques, de morses, de lions de mer, de belettes, d'hermines, de visons, d'aigles de mer, de guillemots, de cormorans huppés, de cygnes, de grues (tsuru), de canards sauvages, d'ours à collier de poils blancs, de cerfs, de sangliers, de loups, de renards, de fouines, de blaireaux (tanuki), de habu (grand serpent venimeux), de cigales (semi), de cancrelats (gokiburi), de hototogisu (sorte de rossignol), de zosterops, de colombes et de faucons.
Si beaucoup de ces animaux sont en voie de disparition, en revanche, un grand nombre d'oiseaux (geais) et de gibiers à plumes comme les faisans et les rapaces (aigles et faucons) sont encore communs.
A signaler que la Grue du Japon (tsuru) est l'emblème du Japon et symbolise la longévité et la tradition.
Flore du Japon.
La forêt occupe 68 % de l'archipel. On doit ce taux élevé au fait qu'elle couvre les montagnes et qu'elle fournit le matériau de base des constructions traditionnelles. On pourrait sommairement diviser le Japon en quatre zones botaniques. Il faut cependant garder à l'esprit que la multitude des microclimats et l'interpénétration des tendances entre les zones influencées par les vents venant de la mer du Japon et de celles soumises à l'influence du Pacifique impliquent une grande diversité climatique et une grande variété florale.
-Zone septentrionale aux influences arctiques :
Cette zone couvre les espaces montagneux de l'île de Hokkaido et le nord de Honshu. On y verra surtout des conifères comme les Todomatsu et les Shirabe, mais également des feuillus comme les Kamba et les Miyama-manakamado.
Cette zone septentrionale botanique couvre le nord de Honshu et le sud de Hokkaido. On y rencontrera des arbres à feuilles caduques comme les bunas et, bien sûr, des conifères : le Hinoki et le Hiba, ainsi que les Sawakurumi et les Harunire.
-Zone centrale :
Cette zone s'étend sur la plus grande partie du Japon, car elle couvre le centre et le sud de Honshu, ainsi que l'île de Shikoku et le nord du Kyushu. On y trouve de nombreuses variétés botaniques et des forêts tempérées aux arbres à feuilles persistantes (Shii, Sakaki, Tsubaki, Kashiwa), mais également différentes variétés de pins (Kuromatsu, Sugi, Hinoki, Kunugi et Konara).
-Zone méridionale :
C'est la zone qui couvre, grosso modo, le sud du Kyushu et les îles Rykyu. Le climat oscille ici entre les influences chaudes et les zones tropicales. On y trouvera donc des arbres toujours verts, mais également des cocotiers, bananiers, camphriers, citronniers : Kusunoki et Tachibana.
D'une manière générale, la flore du Japon accueille les essences suivantes : pin, sapin, bambou, cryptomeria géant (sugi), gingko (arbre aux 40 écus), arbre à laque (urushi), camphrier (kusunoki), santal blanc, chêne dentelé, prunier (ume), daphné, cerisier (sakura), glycine, azalée, pivoine, iris, camélia, lotus, chrysanthème.
Fêtes au Japon.
Les Japonais ne prennent généralement que peu de congés. En revanche, le pays possède le plus grand nombre de jours fériés, 15, et une incalculable quantité de jours de fête. La plupart sont issus de rites et de croyances religieuses bouddhistes et shintoïstes.
Nous avons sélectionné les festivités les plus importantes en fonction des régions.
Formalités.
Les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour se rendre au Japon dans le cadre d'un voyage touristique.
Vous pouvez séjourner jusqu'à 90 jours sur le territoire japonais sans autre document justificatif que votre passeport.
En 2018, tous les types de passeport sont acceptés, qu'ils soient biométriques ou non.
Pour les ressortissants français les Passeport doivent être encore valable au moins 6 mois après la date de retour.
Fournir à Time Tours une photocopie du passeport au plus tard 45 Jours avant le départ.
Art Culinaire.
La cuisine japonaise est l'une des plus riches et des plus raffinées au monde.
Elle est marquée par des traditions bouddhistes végétariennes. Sa grande diversité en fait également une référence internationale.
L'art culinaire japonais se caractérise par sa simplicité, son naturel et son raffinement. Si on ne vient généralement pas au Japon la première fois pour sa gastronomie, on y retourne souvent pour y déguster des mets introuvables ailleurs, comme le fugu (poisson globe), le kame-no-té (crustacé en forme de patte de tortue), l'umibudo (algue appelée caviar vert ou raisin de la mer). Des produits que l'on consomme à la source.
Les saveurs sont nombreuses et classées en cinq catégories : salée, sucrée, amère, acide et unami, terme japonais qui pourrait se traduire par « goût savoureux ».
La cuisine japonaise se détermine également par plusieurs modes de cuisson. Sauté, grillé, frit, mijoté, à la plancha, au barbecue et bien évidemment cru.
Les gammes de prix varient du très bon marché au grand luxe, en fonction des produits, de la qualité des restaurants et du succès des chefs, traduisant l'immense importance que les Japonais accordent à leur cuisine.
Hôtels du voyage.
1. Himeji :
Himeji Castle Granvrio Hotel (4*).
210 Sanzaemon Borinishinomachi, Himeji-shi, Hyogo Prefecture.
Tel : 079-284-3311
2. Kyoto (3 nuits) :
DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO-EKIMAE (4*).
707-2 Karasuma-dori shishijo-sagaru, HIGASHISHIOKOJI-CHO, KYOTO.
Tel : 075-344-3055
3. Mont Koya :
Hojo-in (Monastère).
156 KOUYASAN, KOUYA-CHO, ITO-GUN, WAKAYAMA.
Tel : 0736-56-2431
4. Shima :
HOTEL & RESORTS ISE-SHIMA (3*).
939-6 KASATORI, ISOBECHO MATOYA, SHIMA-SHI, MIE PREFECTURE.
Tel : 0599-55-2111
5. Takayama :
Takayama Best Western Hotel (3*).
6-6, HANASATO-MACHI, TAKAYAMA-SHI, GIFU PREFECTURE.
Tel : 0577-37-2000
6. Hakone :
Hotel Okuyumoto (Ryokan), auberge traditionnelle.
97 YUMOTO CHAYA, HAKONE-MACHI, ASHIGARA-SHIMOGUN, KANAGAWA PREFECTURE.
Tel : 0460-85-8800
7. Tokyo (2 nuits) :
DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU (4*).
1-6-1 YOKOAMI, SUMIDA-KU, TOKYO.
Tel : 03-5611-5211
Jardins et fleurs au Japon.
-Jardin de style shinden :
Jardin avec lac, pavillons de pêche et de printemps pour le seul plaisir des divertissements de l'aristocratie. Il n'en reste que peu d'authentiques exemples.
-Jardin de paradis :
Le style des jardins de la fin de la période Heian et de celle de Kamakura. Le pavillon représente le palais d'Amida et le lac, l'océan de l'Ouest.
-Jardin Zen :
Ce sont des jardins dessinés pour la pratique de la méditation. Les premiers styles mettent l'accent sur le terrain et les rochers proprement dits. Puis les jardins secs (karesansui) offrent une plus grande détermination en choisissant les rochers et le gravier comme des représentations de l'encre de la calligraphie, comme si le jardin était une description mentale de la méditation. Il s'agit généralement d'un jardin prisonnier d'un rectangle fermé par un mur sur trois côtés, le quatrième donnant sur une véranda.
-Jardin de thé (roji) :
Il s'agit plutôt de l'aménagement du chemin qui mène au pavillon de thé, le roji.
-Art des jardins :
L'art des jardins reste l'une des techniques les plus étonnantes de la sensibilité esthétique japonaise. Bien qu'importé de la Chine via la Corée, certainement en même temps que le bouddhisme et l'écriture chinoise, l'art des jardins a évolué au cours des siècles. En aucun cas, il ne s'agit d'un jardin comme il peut être conçu en Europe. C'est plutôt le fruit d'une perception de la (pré-) nature.
Il s'agit d'une mise à l'échelle de la nature environnante, ou d'un monde religieux où flotterait l'harmonie des choses. Cette technique se développe durant la période Heian mais à part quelques vestiges, dont le célèbre Joruri-ji à Nara, le Byodo-in à Uji près de Kyoto, ou encore le Motsu-ji à Hiraizumi, le style shinden et les jardins du paradis amidiste n'ont pas vraiment survécu au temps. Les plans du jardin s'intègrent au plan de masse et aux demeures construites dans l'environnement immédiat. Un certain nombre de lois, comme la présence d'un étang et des collines artificielles, doit être respecté, le tout correspondant à une miniaturisation de la nature. Le bâtiment principal est orienté vers le sud, et entre celui-ci et le jardin se trouve un espace dégagé et situé au sud de la propriété, planté de pruniers, de cerisiers, de mûriers, de saules, d'érables et de pins devant vraisemblablement impliquer un symbolisme des saisons. Le jardin, selon les règles de la géomancie chinoise (ommyodo), doit être traversé par un ruisseau qui coule du nord-ouest au sud-est. Il alimente en eau pure un petit étang dans lequel sont immergés quelques rochers reliés par des ponts en bois ou en pierre. Il prend alors une valeur poétique, puisque sur ses bords sont construits des pavillons de contemplation ou de pêche. La surface calme et virtuelle de l'eau permet la réflexion de la lune comme si elle venait de l'intérieur. Ces différents pavillons sont reliés au bâtiment principal par des corridors (tai no ya). Les seules images qui soient parvenues à atteindre le XXIe siècle, sont dessinées sur des emakimono. Tout est codifié : le nombre, l'implantation des pierres, leur éventuel axe de symétrie, et surtout les formes dégagées comme représentations bénéfiques ou maléfiques de l'espace.
C'est à partir de l'époque Kamakura et durant la période Muromachi que l'art du jardin se modifia au contact de la philosophie Zen. Le jardin devient un lieu de méditation. L'exemple du jardin du Saiho-ji à Kyoto, créé au XIVe siècle par Kokushi Muso (1276-1351), est révélateur. On assiste à une sorte de renversement vertical symbolique. Le bas du jardin est composé d'arbres, de mousses, d'un étang et d'un pavillon, alors que le haut, le monde éthéré de la méditation, est représenté par un jardin sec. C'est à l'époque Muromachi que le jardin va prendre toute son ampleur.
L'architecture est épurée avec les constructions du Kinkaku-ji, du Ginkaku-ji et du Daitoku-ji. La vision du jardin est rendue plus mobile, ce qui paraît être un paradoxe, que relève l'enseignement du Zen. C'est en multipliant les points de vue, les koan (énigmes du Zen), que le satori peut être atteint. Au cours de la période Momoyama, s'affrontent deux types de jardins. Les premiers, aristocratiques, sont conçus comme symbole du pouvoir. Ils trahissent l'ambition, la force et l'abondance. Les seconds, au contraire, mobilisent une esthétique du détachement, et permettent d'envisager une esthétique bâtie sur la rareté et la justesse du geste.
Le jardin de Katsura inaugure une nouvelle conception, il devient un jardin conçu selon une progression de la découverte des essences et des sensations. Il devient jardin de promenade. Les participants marchent le long de plusieurs sentiers et découvrent, au hasard des pavillons, des nouveaux points d'observation ou des impressions. L'architecture moderne fait largement appel aux conceptions de l'art du jardin. Compte tenu de la raréfaction de l'espace, les petits jardins trouvent tout naturellement leur place dans le gigantisme urbain, tout particulièrement à Tokyo.
L'ikebana, ou l'art de l'arrangement floral, est certainement d'origine bouddhique. Il est également appelé le ka-do, ou « voie des fleurs ». Son essor date de la période Muromachi (1333-1573), mais l'art d'offrir des fleurs aux divinités remonte aux cultes indiens. Lors du développement du bouddhisme au Japon, les fleurs faisaient déjà l'objet d'une pratique rituelle, mais c'est l'épanouissement du bouddhisme Zen qui a soumis l'ikebana aux codes stricts des maîtres de thé. Pendant la période Muromachi, les maîtres de thé créent des écoles pour codifier cet art et le soumettre à une discipline esthétique. Il s'agit de mettre en harmonie la simplicité et la rusticité des supports (vases et plats) avec la nature profonde des matériaux et des textures. Si dans le tokonoma (petite alcôve), un vase accueille un ikebana savamment disposé, on évitera de mettre en valeur sur le mur de l'alcôve un rouleau représentant des fleurs. L'une des écoles les plus anciennes fut celle de l'ikenobo, dont il est dit qu'elle remonte au VIIe siècle, lorsque le moine Ono no Imoko revint de Chine. La fondation d'un véritable art codé date de 1462, date à laquelle Sengy aurait fondé le style rikka. Il s'agit de faire renaître l'élan vital des fleurs en les arrangeant et suivant un plan triangulaire qui permette aux tiges de longueur inégale, toujours en nombre impair, de garder un rythme qui rappelle ou évoque la nature. La plus haute représente le ciel, celle du milieu symbolise l'humain, tandis que la plus basse incarne la terre. La symétrie et le croisement de branches ne sont pas tolérés. Dans le style rikka, cinq ou sept branches, dont le sommet garde un nom différent selon sa position spatiale, sont choisies. Le sommet (ryo) se nomme shin à droite et yo à gauche. Les autres tiges prendront le nom de colline à droite ou de vallée à gauche. Des systèmes de proportions mettent en harmonie la hauteur des tiges, celle du vase et le diamètre du plat. La branche rikka s'impose dès le XVe siècle, mais de nombreuses écoles rivalisent par la suite. Ainsi le nage-ire s'impose-t-il pour la cérémonie du thé au XVIe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des styles fleurissent dans le monde flottant, plus directement bourgeois, et se soumettent aux nouveaux codes esthétiques de l'urbanité naissante. Ainsi le style shoka, qui séduit tout particulièrement les marchands, ou style chonin, prend son essor à Kyoto comme à Edo. La technique, une paire de ciseaux à lames courtes munie de longues poignées, un couteau et parfois une scie pour les branchages. Les pique-fleurs, qui permettent de fixer les tiges et d'animer la pureté des lignes, sont utilisés. Durant l'ère Meiji, un nouveau style, le moribana, créé par Unshin Ohara, fait appel à la technique des fleurs jonchées sur des plats, en utilisant des fleurs venant de pays étrangers qui permettent ainsi un plus grand jeu de couleurs. Naissent alors les écoles Teshigahara et Sogetsu, et l'essor des styles dits libres. Plus de 3 000 écoles d'arrangement floral sont recensées, et cet art s'exporte dans tous les pays du monde.

3 Ecritures en Japonais.
Langue au Japon.
La langue du Japon est le japonais, et est considérablement pleine de sous-entendus. Son apprentissage est très compliqué, et l'utilisation d'applications de traduction automatique mène à des situations parfois cocasses...
Au Japon, 124 millions de Japonais parlent... japonais. Les deux millions restant, issus de l'immigration, tentent de s'y mettre, avec plus ou moins de succès.
En dehors du japonais, le coréen, le mandarin, le portugais et l'anglais, sont les langues courantes entendues, même si elles restent marginales.
Quelques dialectes sont pratiqués par des personnes, essentiellement originaires d'autres parties de l'archipel.
Le japonais s'est développé, entre autre, sur et autour des dialectes de la région du Kansaï (Kyoto, ancienne capitale). A partir du XVIIe siècle, elle s'est construite autour du dialecte principal de la région du Kanto, et donc de celui pratiqué à Tokyo. Le poids politique de plus en plus important d'Edo a permis l'influence de ce dialecte dans le japonais tel qu'il est pratiqué aujourd'hui.
Pour retrouver tous les signes nécessaires à l'écriture du japonais, il faut connaître trois systèmes : le kanji (caractères empruntés au chinois), le katakana et l'hiragana. Ces deux derniers ne sont autres que des alphabets syllabaires.
Comme pour le chinois, le japonais s'écrit traditionnellement de haut en bas et de droite à gauche, sans espace entre les mots. Ce type de mise en forme se nomme le tategaki.
L'écriture japonaise daterait de 400 av. J.-C. Influencée par des caractères chinois, elle ne fut complétée qu'à partir du VIIIe et XIXe siècle, avec la création du katakana par Kibi-no-mabi, et de l'hiragana, inventé par le saint bouddhiste, Kobô-daïshi.
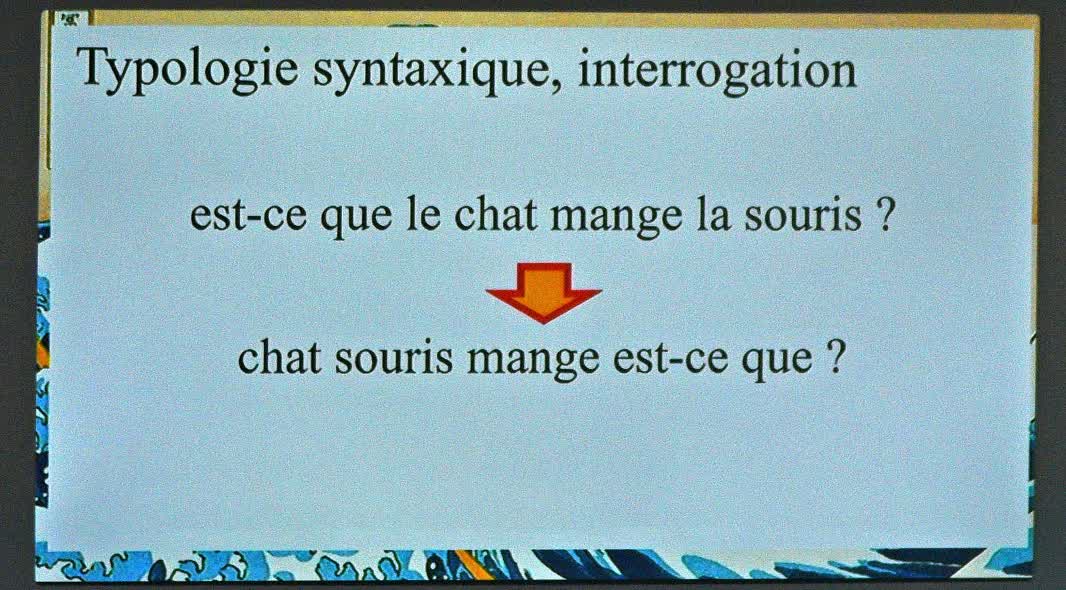
Le Chat Mange la Souris.

Le Chat n'a pas Faim.
Lexique au Japon.
Petite liste de mots japonais de base.
On ne pourra que vous conseiller d'apprendre quelques rudiments avant de partir.
À savoir : pour la prononciation, on ne prononce pas le « u » à la fin des mots ou alors avec un léger « ou ».
1. La politesse en japonais :
arigato = merci
douzo = je vous en prie
hajimemashite = enchanté
ohayo goazimasu = bonjour (le matin)
konnichi wa = bonjour
konbanwa = bonsoir
sayonara = au revoir
ogenki desu ka= comment allez vous ?
oyasumi nasai=bonne nuit
itadakimasu = bon appétit !
gochisoosama deshita = c'était délicieux
mata aimashou = a bientôt
mata ashita = a demain
sumimasen = pardon
gomen nasai = je suis désolée
onegaishimasu = s'il vous plait
shitsurei shimasu = veuillez m'excuser
2. Quelques chiffres en japonais :
Ichi = 1
Ni = 2
san = 3
yon=4
go =5
roku = 6
nana/shichi = 7
hachi = 8
kyu = 9
ju = 10
hyaku= 100
sen = 1000
3. Le corps en japonais :
hara= ventre
hiza= genou
kata = épaule
koshi = hanche
kote= poignet
kubi = cou
mune= poitrine
tai = le corps
Te= main
ude= bras
4. Quelques phrases utiles en japonais :
Damare = silence
haï = oui
iie = non
où sont les toilettes = to i ré wa doko desu ka ?
anata= toi
moshi moshi = allo
Où est la gare = Eki wa doko desu ka ?
gauche = hidari ni
droite= migi ni
michi ni mayotte imasu = je suis perdu
imaïchido = encore une fois
Zenzen wakaranai = je ne comprend rien
nanji desu ka = quelle heure est il ?
mae= avant
owari = fin
sho = début
watashi wa furansu jin desu = je suis français
Dupont to mooshimasu = je m'appelle Monsieur dupont
Watashi wa florence desu = Je suis florence
Nihon go o hanashimasen = je ne parle pas japonais
nihon go ga wakarimasen = je ne comprend pas le japonais
furansugo ga dekimasuka = parlez vous français ?
koko desu = c'est ici
arimassen = je n'en ai pas
moi = watashi
kore wa nan desu ka ? = qu'est ce que c'est ?
denwa = téléphone
5. La santé en japonais :
Kibun ga warui = je ne me sens pas bien
byoki desu = je suis malade
koko ga itai desu = j'ai mal ici
atama ga itai = j'ai mal à la tete
onaka ga itai = j'ai mal au ventre
ha ga itai = j'ai mal aux dents
isha o yonde kudasai = pouvez vous appeler un docteur
kusuri = médicament
6. Le calendrier en japonais :
getsu-yobi = lundi
ka-yobi = mardi
sui-yobi = mercredi
moku-yobi = jeudi
kin-yobi = vendredi
do-yobi = samedi
nichi-yobi = dimanche
kino = hier
ashita= demain
kyou = aujourd'hui
7. Les couleurs en japonais :
seki = rouge
sei = bleu
kiiro = jaune
koku = noir
ryoku = vert
murasaki = violet
chairo = marron
haiiro = gris
orenji = orange
pinku = rose
shiro = blanc
8. La gastronomie en japonais :
supun= cuillère
kampaï = santé
nomu = boire
mizu = eau
o naka ga suita = j ai faim
nodo ga kawaita = j ai soif
jusu= jus de fruit
yasai = légume
taberu = manger
tamago = oeuf (vous voyez maintenant le rapport avec le tamagoshi ?)
pan = pain
sakana = poisson
ringo = pomme
kome= riz cru
gohan = riz cuit
kocha = thé noir
ocha= thé vert
niku = viande
ashi = baguettes

Plan du Metro de Tokyo.
Métro de Tokyo.
Le métro de Tokyo est entré en service le 30 décembre 1927.
Actuellement la longueur du réseau est de 304 km, il compte 13 lignes pour 285 stations.
Les numéros de station se composent d’une lettre représentant la ligne et d’un nombre pour la station.
Sur les plans d’itinéraire de métro, le numéro de station est indiqué en fonction de la ligne et la lettre de l’alphabet représente le nom de la ligne.
La couleur du cercle entourant le numéro représente également la ligne et vous permet de retrouver plus facilement votre station.
Moustiques.
Les moustiques sont plus ou moins présents selon la saison et les zones géographiques mais il n'y a pas de paludisme au Japon.
Art Musical.
Les instruments de musique anciens sont nombreux : la longue cithare couchée à cinq cordes (koto), la flûte sphérique en pierre (okarina), le tambour à caisse cylindrique (tsuzumi), la cloche et la crécelle (suzu) et la cloche de bronze (nuride).
Du VIIe au Xe siècle, un stade d'organisation supérieur de la société est instauré et contrôlé par un gouvernement qui établit des liens avec ses voisins géants. La musique en est influencée. À l'époque Asuka (592-628) est introduit le bouddhisme associé aux danses rituelles avec masques (gagaku). Véhicule de la transmission d'une sagesse, la musique est reine. L'empereur Mommu (697-707) crée un ministère de la Musique, Gagaku-ryo. L'acculturation se poursuit à l'époque Nara (710-793). Par la musique chinoise de la dynastie T'ang, les musiques de l'Inde, de la Perse, de l'Asie centrale pénètrent le Japon.
On appelait Gagaku, la musique rituelle chinoise liée au confucianisme. Elle assimile vite la musique japonaise liée au shinto. La musique Gagaku est pratiquée à la cour et dans les temples. Les 75 instruments qui sont utilisés lors de la cérémonie pour l'érection de la statue colossale de Bouddha (752) dans le temple Todaï-ji sont conservés dans le trésor impérial du Sho-so-in, à Nara : six sortes de cithares, trois sortes de luths, harpes angulaires, flûtes droites, flûtes traversières, flûtes de Pan, deux sortes d'orgues de poche, deux sortes de tambourins sabliers et des carillons de gong.
Cette musique gagne la faveur des aristocrates et des fonctionnaires par l'introduction de la psalmodie bouddhiste shomyo, originaire de l'Inde. C'est dans le shomyo, chant et liturgie bouddhiques, que se constitue une unité fondamentale, la cellule mélodique.
Ces différents emprunts ont conduit la musique japonaise à une simplification et une harmonisation. Il existe deux modes : le majeur (sempo) et le mineur (insempo). La musique du Gagaku utilise six intervalles et suit la gamme pentatonique chinoise.
Pendant la période Heian, la culture musicale joue un rôle aussi important que la calligraphie et la poésie. A la flûte répond le koto féminin. La période Kamakura voit alors se développer l'art du biwa (luth) en même temps que les chants bouddhiques, renforcés par le développement des sectes Shingon et Tendaï.
Au haut Moyen Âge (XIe-XVIe siècle) s'épanouirent des musiques dites rustiques (Dengaku, composée principalement de musique et de danse) et dites éparses (Sangaku, beaucoup plus ludique avec farces, imitations, effets hallucinatoires, marionnettes).
La vraie musique japonaise doit attendre l'époque Edo pour prendre toute sa dimension, avec l'arrivée du shamisen (instrument à cordes pincées) en 1562. Une certaine unité des instruments se développe avec le koto, la harpe horizontale, le luth biwa et la flûte de bambou shakuhachi, d'origine chinoise. Tandis que se développent les musiques de koto dites sokyoku dans le Kyushu, dans le Kansaï s'épanouissaient les chants accompagnés du shamisen ou ji-uta qui va suivre la prodigieuse aventure du kabuki. Celui-ci prend peu à peu le pas sur le théâtre de marionnettes bunraku (ningyo joruri) et lui emprunte sa musique, désormais composée d'un corps de shamisen et de tambours.
Ces shamisens ont sans doute été imposés par la dimension de la scène et le volume de la salle. Le jeu instrumental a accentué le caractère binaire du rythme.
Tous les genres musicaux de l'époque moderne ont conservé les tempi élastiques de l'époque médiévale.
La musique actuelle comme à Tokyo, retrouve tous les styles occidentaux qui trouvent leur traduction au pays du Soleil Levant. Rap, rock, pop, variété...

La Grue en Origami.
Origami.
L'Origami est l'art du pliage du papier. C'est l'un des plus anciens arts populaires, au VIe siècle, en Chine. Il daterait de la dynastie des Han de l'Ouest (-202 – 9) et aurait été apporté au Japon par des moines bouddhistes via Koguryo (pays recouvrant les actuelles Corées).
Il se serait rapidement développé vers 1200 au sein des rituels bouddhistes, où il aurait eu rapidement un grand succès.
C'est ensuite dans l'art du "bushi" que se seraient développées la découpe et la création de fleurs en origami utilisées comme marques d'amitié.
Cette technique date probablement, au Japon, de l'ère Edo (1603–1867). L'origami japonais a certainement ses origines dans les cérémonies où le papier ainsi plié permettait de décorer les tables (le plus souvent les cruches de saké). Le plus ancien usage religieux de l'origami connu à ce jour est le katashiro, représentation d'une divinité, utilisé pendant les cérémonies shinto du temple de Ise.
Un des origamis les plus populaires est la grue en papier. Cet oiseau est un animal emblématique du Japon et représente longévité et tradition.
une légende dit : Quiconque plie mille grues de papier en une année, verra son vœu exaucé (santé, longévité, amour, bonheur). La guirlande des 1 000 grues est devenue un symbole mondial de paix et on peut en voir dans les temples ou jardins de prières (notamment à Tokyo et Hiroshima).
La feuille d'origami est en général de forme carrée 15 ou 20 cm de côté (mais ce n'est pas toujours le cas). Les différentes formes sont obtenues par pliages successifs, et il ne faut en principe pas découper la feuille.
L'origami peut s'inspirer de figures géométriques mais également de formes simples comme un chapeau ou un avion en papier, ou parfois plus complexes comme une représentation de la Tour Eiffel, une gazelle...
C'est un art qui nécessite peu de matériel si ce n’est un bon papier adapté et de qualité.
Le papier doit garder le pli, il faut donc oubliez les papiers mous qui ne marquent pas ou trop cassant (calque).
Toutefois pour débuter en origami, vous avez certainement chez vous du papier qui convient comme des cahiers de brouillons qui ont des pages très fines, du papier Kraft, du papier cadeau ou du papier de soie.
En matière de papier, le grammage détermine toujours la qualité du rendu final. Pour de l’origami, vous pouvez viser un papier de 70 grammes car au-dessus il peut être difficile à plier.
Remarque : dans les transports en commun, on peut s'amuser à utiliser les tickets de métro !
On peut utiliser le papier blanc, de couleur ou à motifs mais le top est le Washi : un papier japonais traditionnel à la fois léger, souple et solide.

Vue Satellite du Palais Imperial de Tokyo.
Palais Impérial.
Il est situé dans l'arrondissement de "Chiyoda", en plein centre de la capitale japonaise et est toujours cerné par ses douves d'origine, reste du fameux château d'Edo, autrefois demeure des "Shoguns" (seigneurs) de l'époque "Tokugawa".
Ce complexe de superficie 3,41 km2, abrite la résidence "Kokyo" de l'Empereur ainsi que plusieurs parcs dont seuls certains sont ouverts au public. Même les visites guidées ne donnent pas accès à l'intérieur des bâtiments mais permettent seulement une promenade dans certaines parties du parc !
Actuellement, le tour du palais sert de piste aux nombreux joggers qui profitent de cinq kilomètres entre buildings et nature, et ce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le méga carrefour de Shibuya à Tokyo.
Comportement du Piéton au Japon.
Le piéton japonais est très discipliné, il traverse au niveau des passages protégés, il marche à gauche sur le trottoir et ne zigzag pas !
Dans les grandes villes, les feux tricolores sont souvent munis d'indicateurs sonores bien audibles malgré l'intense circulation.
Si vous allez à Tokyo le méga carrefour de Shibuya est incontournable ! Sa réputation de carrefour piéton le plus fréquenté au monde n’est plus à faire, plus de cent mille Japonais le traversent chaque jour. Il possède de nombreux croisements de routes et passages piétons très empruntés dont un en diagonale.
Les chiffres ont de quoi impressionner. Les feux de signalisation ont un cycle de 2 minutes. 10 voies de circulation, pour 5 passages cloutés. Aux heures de pointe, pas moins de 2 500 personnes traversent le carrefour par cycle.
Les japonais sont très vigilants mais il est amusant lorsque la pluie est de la partie, de voir les trésors d’ingénierie déployés par les passants pour esquiver les autres parapluies !
Matériel Photo.
Le Japon est LE pays de la photo. Les boutiques spécialisées sont de véritables cavernes d'Ali Baba pour les amateurs, qui peuvent prendre en main le matériel le plus performant. Toutes les grandes marques sont japonaises, comme Nikon, Canon, Sony, et les accessoires sont innombrables. Les prix sont généralement intéressants, en particulier pour les accessoires et le matériel d'occasion.
La Poste.
Les boîtes aux lettres sont de couleur rouge et de forme Carrée ou cylindrique. Les bureaux de poste centraux sont fermés le dimanche et les jours fériés, ouverts de 9h à 19h en semaine et de 9h à 15h le samedi.
Les bureaux locaux sont ouverts de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Il vous faudra relever la tête et repérer les " T " rouges avec une barre supplémentaire inscrite sur fond blanc.
Les tarifs des timbres à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord sont les suivants :
110 ¥ pour les lettres jusqu'à 25 g, 70 ¥ pour les cartes postales et 90 ¥ pour les aérogrammes.
Vous pouvez aussi en acheter dans les hôtels.
Nota : la carte postale vaut entre 100 et 200 Yen (donc autour de 1 à 1.50 Euro).
En ce qui concerne la poste restante (kyoku dome yubin), mieux vaut aller dans les grands bureaux de poste. Le courrier y est conservé un mois avant d'être retourné à l'expéditeur.
Poids et Mesures au Japon.
Le Japon possède depuis l'ère Meiji deux systèmes de poids et mesures. L'un est traditionnel, l'autre est métrique. Il est possible de rencontrer des petits particularismes locaux mais dans l'ensemble ces deux systèmes se rencontrent dans tout l'archipel.
A partir de 1886, le Japon commença à introduire le système métrique qui fut rendu obligatoire en 1959.
Voici quelques équivalences entre le système traditionnel Japonais et le système métrique.
1. Unités de longueur :
Bu = 0,003 m
Sun = 10 Bu = 0,030 m
Shaku = 10 Sun = 0,303 m
Ken, Hiro = 6 Shaku = 1,818 m
Chô = 60 Ken = 109,09 m
Kairi = 1 852 m
Ri = 36 Chô 3 927 m
2. Unités de Masse :
Bu = 0,375 g
Momme = 10 Bu = 3,750 g
Kin = 160 Momme = 600 g
Kan, Kamme = 1 000 Momme = 3 750 g
3. Unités de Capacité :
Shaku = 0,0180 l
Gô = 10 Shaku = 0,1803 l
Shô = 10 Gô = 1,8039 l
To = 10 Shô = 18,039 l
Koku = 10 To = 180,39 l
4. Unités de surface :
Tsubo, Bu = 1 ken2 = 3,306 m2
Se = 30 tsubo = 99,175 m2
Tan = 10 se = 990 m2
Chô, Chôbu = 10 tan 9 900 m2
Pourboires...
Il n'y a pas de pourboire au Japon et ceci peut être considéré comme une impolitesse !
De même le marchandage n'est pas de mise au pays du soleil levant excepté dans les marchés aux puces...
Les prix sont souvent indiqués Hors taxe et TTC dans les boutiques. Toutefois une détaxe est possible mais après avoir scellé votre paquet et payé le prix on peut vous emmener à un comptoir qui vous remboursera la taxe à la consommation actuellement de 8 pour cent...
Proverbes et Dictons
1.
" Le brouillard ne peut se dissiper avec un éventail. "
2.
" La pierre précieuse, non taillée, ne brille pas. "
3.
" Le jour idéal pour réaliser une chose, c'est le jour où on a décidé de la faire. "
4.
" L'idiot est celui qui cherche des poissons dans les arbres. "
5.
" Réussir sans un travail assidu est aussi peu probable que de récolter là ou l'on n'a pas semé. "
6.
" Constater par soi-même est préférable que cent ouï-dire. "
7.
" La vie de chacun est inscrite sur les lignes de son visage. "
8.
" Les dieux brillent sur le front du juste. "
9.
" Qui ne peut vivre dans l'honneur doit mourir dans l'honneur. "
10.
" Nourrissez un ingrat pendant trois semaines, il vous oubliera en trois jours. "
11.
" Il faut payer suivant son rang. "
12.
" Jugez d'une chose comme un aveugle d'un éléphant. "
13.
" En cherchant le vieux, on apprend du neuf. "
14.
" De tout un peu, et jamais trop de tout. "
15.
" Pour arriver à s'aimer, il faut avant tout se comprendre. "
16.
" Le sourire est la source du bonheur et de la fortune. "
17.
" Face à un ivrogne, les murs eux-mêmes s'écartent. "
18.
" J'entends, j'oublie ; je vois, je retiens ; je fais, je comprends. "
19.
" Un rat aux abois peut mordre un chat. "
20.
" Le vouloir rend possible l'impossible. "
21.
" Qui redescend d'une montagne de joyaux les mains vides mérite de mendier sa vie. "
22.
" Même la pensée d'une fourmi peut toucher le ciel. "
Religion au Japon.
-Pour pénétrer dans un temple, le visiteur doit laisser ses chaussures à l'extérieur.
Les Japonais s'amusent à dire qu'ils naissent shinto, vivent en confucéens, se marient chrétiens et meurent bouddhistes. Cette attitude montre en tout cas que les sentiments de ferveur religieuse, de foi ou de « communion avec un Moi profond » ne font pas partie du vécu religieux habituel du peuple.
-Le shinto et les sanctuaires jinja :
Officiellement vieux de vingt-cinq siècles, le shinto ou shintoïsme, est la religion indigène des Japonais, par opposition au bouddhisme, venu de Chine et de Corée. Il consiste dans le culte de la notion de Kami (voir plus loin). La mythologie du shinto fut retranscrite dans le Kojiki (recueil des choses anciennes) en 712 sur ordre de l'empereur et ensuite dans le Nihon shoki en 720. La lecture de ces deux ouvrages révèle une mythologie riche et imagée. Mais avant d'entrer dans le manège des divinités du culte, il est important de comprendre ce que Kami signifie pour le Japonais moyen qui ne connaît pas la mythologie.
Chose curieuse, le shinto est la seule religion du monde qui n'ait pas de Coran, de Bible ou autre Talmud, qui ne possède aucun précepte écrit, et où les sanctuaires n'ont pas de statues à l'image d'une divinité. Pourtant, tout Japonais a la perception intuitive de Kami, souvent appelé amicalement et honorifiquement « Kami-sama » dans la vie de tous les jours. Soutenue par aucun écrit, ni par une quelconque représentation, quelle est cette perception de « Kami (-sama) » ?
Devant (ou derrière) les manifestations naturelles, par exemple une rivière, un arbre, la colère, le ciel, la mort, la beauté, le rayon de soleil, le plaisir, le vent ou l'amour (mélange ici volontaire des choses dites matérielles et spirituelles car la différence existe moins dans la conscience nippone), le Japonais perçoit deux choses : l'événement, c'est-à-dire le phénomène en soi, et l'état d'une force qui fait que l'événement a lieu.
C'est la sensation du rapport entre « A -ce qui fait que ça existe » et « B -la manifestation de A » devant lequel s'instaure un sentiment de respect, de gratitude, le sentiment que l'être humain est peu de chose et redevable. Pour exprimer cette perception et le sentiment qui en découle, les Japonais utilisent le mot Kami. Une certaine résonance qui fait dire « ça vient de quelque part ».
Il est donc difficile de parler de divinités, de dieu (x), d'esprits ou de chamanisme. Il vaut mieux garder en tête le mot Kami ou Kami-sama et la perception qu'il recouvre.
Et comme le shinto n'implique aucun baptême, communion, interdiction, punition, connaissance écrite ou préceptes, il n'y a que la force du lieu qui compte, le sanctuaire. On ne parle jamais de mythologie dans un sanctuaire shinto, et il n'y a pas de messe le dimanche.
Le danger pour un Occidental dans sa compréhension du shinto (comme du Japon), vient de sa faculté à ramener des choses simples à des concepts beaucoup plus élaborés qui lui sont familiers : le chamanisme, les esprits, l'âme des choses, l'inhibition, le symbolisme phallique, l'animisme... Ces images nées des capacités cérébrales de chacun, vraies ou fausses, dépassent de mille lieues la « kami-ceptivité », soit la sensation simple et entière d'un état de manifestation naturelle.
-Le bouddhisme et les temples :
L'année 552 est la date d'introduction officielle du bouddhisme au Japon, année au cours de laquelle le roi du Paekche, en Corée, envoie une lettre à l'empereur Kimmei, du Yamato (Japon), en lui demandant de l'aider à contenir les visées expansionnistes de son voisin, le souverain de Silla. Cette lettre lui explique aussi les mérites du bouddhisme et est accompagnée d'une magnifique sculpture de Bouddha en or et en cuivre, et de plusieurs volumes de textes bouddhiques. À cette époque, Yamato compte une colonie en Corée, le Minama. Il est probable que le bouddhisme avait déjà fait son apparition depuis plusieurs décennies, au gré des échanges commerciaux et politiques.
En 562, les Japonais sont obligés d'abandonner leurs fiefs de Corée et emmènent avec eux bon nombre d'artistes et de religieux coréens qui fuient la guerre.
Le bouddhisme, entre ainsi dans l'Empire d'une manière officielle, mais va bientôt se heurter à l'opposition des shinto. Seule la noblesse se convertit avec quelques clans qui redoublent de rivalité avec les clans shinto. Le bouddhisme est non seulement une religion, mais aussi une série de principes de pensée et de gouvernement qui permettent de trouver des solutions politiques aux problèmes soulevés dans le Yamato.
Deux clans s'opposent radicalement : le clan bouddhique mené par les Soga et le clan shinto représenté par les Nakatomi : bukkyo contre shinto. En 587, le clan Bukkyo réussit à évincer le clan shinto et gagne la confiance de la cour impériale et de la noblesse. Le régent Shotoku Taishi parvient à imposer le bouddhisme comme religion officielle et renoue avec la Chine et la Corée.
Les Japonais penchent de plus en plus vers un syncrétisme, mélange des voies shinto et bouddhique, mais au début du VIIIe siècle, l'établissement de six sectes différentes à Nara engendre une divergence doctrinale. Six textes sont écrits : le sanron-shu, le kusha-shu, le hosso-shu, le jojitsu-shu, le kegon-shu et enfin le ritsu-shu. Pendant ce temps, la colossale statue de bronze du Daibutsu à Nara dans le temple Todaiji, est érigée.
Cent cinquante ans plus tard, l'empereur, soucieux de s'affranchir des six sectes de Nara qui ont pris un poids politique important, envoie des missions en Chine afin qu'on ramène des doctrines nouvelles. En 805, le moine Saicho revient du mont Tendai et fonde son monastère sur les pentes du mont Hiei, la secte Tendai. En 806, Kukai rapporte les enseignements de la secte Shingon et s'établit sur les pentes du Koya-san.
Ces deux sectes ésotériques ont l'intelligence de mêler adroitement les pratiques bouddhistes et les rites shinto afin de pénétrer plus facilement les couches populaires. Des synthèses en sont faites. Elles permettent aux fidèles d'atteindre leur but par la seule adoration des divinités et des pratiques plus simples.
C'est le temps de l'amidisme (Amida est la représentation de Bouddha qui amène les âmes au paradis). Soutenu par ce qui devient le jodo, ou vénération d'Amida « de la terre pure » dans une future vie, le bouddhisme ne s'éloigne pas de la secte Tendai, mais la seule invocation vocale du nembutsu assure au fidèle son entrée au paradis, c'est-à-dire que le but n'est plus de réaliser l'éveil du temps de son vivant, contrairement au bouddhisme originel.
Les troubles qui accompagnent la décadence de l'époque Fujiwara au XIIe siècle favorisent, à la période de Kamakura, l'installation de nouvelles sectes aristocratiques comme le Zen, venant du Chan chinois, correspondant aux guerriers de l'aristocratie : les sectes du jodo-shin-shu ou de Nichiren.
Ce sont des moines chinois qui importent le Chan (Zen) par le biais d'Eisei, lequel fonde la secte Rinzaï en 1191. Le moine Dogen, quant à lui, fonde la secte Soto une trentaine d'années plus tard. Cette doctrine connaît un grand succès chez les intellectuels et les guerriers.
Elle n'est fondée sur aucun texte et fait référence à l'essence des choses, à la méditation et l'étude des paradoxes. Le Zen a une influence considérable dans le monde des arts, que ce soit l'architecture, la sculpture, la peinture, l'art des jardins, le théâtre, l'arrangement floral ou la cérémonie du thé. Son enseignement utilise le paradoxe didactique. Ainsi, le disciple doit répondre à une énigme (koan) qu'il ne pourra résoudre que par l'illumination, ou satori.
Quant à Nichiren, on l'associe généralement au sutra du lotus. Nichiren professe la doctrine par tous les moyens, y compris par la force. Opposé de manière violente à la secte Jodo, il est condamné à mort et envoyé en exil dans l'île de Sado. Il peut revenir quelques années plus tard à Kamakura, mais meurt en 1282 à Ikegami sans convaincre les Hojo de la justesse de ses idées.
Actuellement, la secte Soka Gakkai se réclame de sa doctrine et de son enseignement. Cette secte laïque, fondée en 1937, devient après la guerre une secte puissante à l'origine du parti Komeito. La Soka Gakkaï prétend compter 7 à 8 millions de fidèles au Japon.
-Nouvelles religions :
Si la secte Soka Gakkaï repose sur la doctrine de Nichiren, elle condamne les autres religions tout en accomplissant un travail de racolage à la hauteur de sa prodigieuse richesse. Cette secte finance le Komeito, parti de coalition majoritaire avec le Parti libéral démocrate.
Il semblerait qu'il existe plus de 80 000 sectes au Japon, dont on a entendu parler surtout après la tragique attaque au gaz sarin perpétrée par la secte Aum dans le métro de Tokyo en 1995.
-Chrétienté :
Les activités missionnaires catholiques au Japon débutèrent en 1549, lancées par les Jésuites soutenus par le Portugal, avant que les Ordres mendiants soutenus par les Espagnols n'accèdent à leur tour au Japon. Les Jésuites tentèrent dans un premier temps d'influencer les hommes de pouvoir pour ensuite diffuser la religion au reste de la population. Certains historiens japonais estiment que la conversion des Japonais au christianisme a été forcée, même si les chrétiens prétendent que cette conversion visait uniquement à reproduire le comportement exemplaire de leurs seigneurs. Les chrétiens du Japon de cette époque sont appelés kirishitan. La grande majorité d'entre eux abandonnèrent leur foi après les persécutions, suite à l'interdiction du christianisme par le shogunat Tokugawa en 1614, et ce ne fut que dans le Japon moderne que les Chrétiens purent à nouveau pratiquer leur foi. On compte aujourd'hui un peu plus de 3 millions de Chrétiens, soit 2 % de la population, dont une grande majorité se trouve sur l'île de Kyushu et plus précisément dans les préfectures de Saga et Nagasaki.

Schéma d'un Katana de Samouraï.
Sabres Japonais.
L’appellation " sabre japonais " se dit " nihonto " en langue nippone.
Le sabre japonais est composé de trois parties : la poignée ou le manche (tsuka en japonais), la garde (nommée tsuba) et enfin la lame (burêdo en langue nippone).
La lame, lorsqu’elle ne sert pas, est protégée par un fourreau nommé saya.
Contrairement aux épées occidentales, les lames japonaises sont souvent dotées d’un seul tranchant.
Il existe plusieurs types de sabres japonais, variant les uns des autres par leurs tailles, leurs usages… Par ordre alphabétique nous avons :
1. Le dotanuki qui se distingue du katana de par son poids, il pèse systématiquement plus de 1000 grammes et cela sans inclure le poids du fourreau, et sa lame épaisse non stratifiée. Ce sabre antérieur au Katana a été conçu afin de trancher sa cible en un seul et unique coup.
2. Le célèbre katana qui est la figure de proue des « sabres japonais », sa renommée n’est plus à faire au même titre que la qualité de sa lame dont sa longueur excède systématiquement les 60cm, il pèse généralement entre 800 et 1300 grammes, il peut se manier à une ou deux mains selon la technique des utilisateurs. Le Katana était l’apanage des samouraïs, qui le portaient à la ceinture.
3. Le kodachi qui est l’aïeul du wakizachi avec lequel il est souvent confondu. En effet c’est une arme de petite taille comparée à ses congénères : elle n’excède pas les 65cm. Sa lame est incurvée et en général, on s’en sert par paire.
4. Le nagamaki ou nagamaki naochi. Il s’agit d’un très grand sabre ancestral (la lame pouvant atteindre 90 cm et le manche 120cm) Malgré son impressionnante taille, ce sabre souvent assimilé à une lance est bien une arme de poing destinée aux combats rapprochés.
5. Le naginata est un très vieux sabre japonais, assez atypique. En effet, il se compose – comme tous ses congénères – d’un manche, d’une garde et d’une lame à la différence près que, et à l’instar des nagamaki, le manche se révèle être beaucoup plus long que la lame de constitution, courte et épaisse. Cette arme très prisée sur les champs de bataille servait, notamment, à couper les jarrets des chevaux.
6. Le nodachi qui est un très Grand sabre japonais (lame de plus de 100 cm de long) dont l’utilisation requiert les deux mains. Forger un nodachi est extrêmement coûteux à cause de sa taille. Son utilisation sur les champs de batailles a été délaissée au fil du temps au profit du katana, le transformant ainsi en arme d’apparat. Contrairement aux autres sabres qui se portent à la ceinture, lui, se porte à l’épaule.
7. Le tachi, c’est l’ancêtre du katana, sa lame incurvée mesure environ 70 cm. C’était une arme particulièrement adaptée aux soldats montés à cheval.
8. Le tanto qui est souvent assimilé à une dague ou un poignard de par sa taille. En effet, il ne mesure jamais plus de 30 cm. Néanmoins, il reste un membre de la grande famille des sabres car il en possède les caractéristiques que sont le tsuba, le saya et la lame forgée selon les techniques propres aux sabres japonais.
9. L’ushigatana est un sabre très incurvé à la base de la lame. Sa taille varie le plus souvent entre 60 cm et 90 cm. Il était très peu estimé à cause de la qualité médiocre de sa lame. Pour cette raison il était réservé aux simples soldats.
10. Le wakizashi qui de tous les sabres japonais, est celui qui se rapproche le plus du katana avec lequel il forme, par ailleurs, le « daisho », les armes du samouraï. En effet sa morphologie en fait un « petit katana » : sa taille est comprise entre 30 et 60 cm.
11. Le yari est une sorte de grande lance japonaise dont la taille varie entre 200 cm et 400 cm et dont les lames sont droites ou en forme de croix.
Quand partir au Japon?
C'est une question cruciale que tout voyageur du "Soleil Levant" se pose.
Va-t-il faire trop chaud ? Trop froid ?
Il faut savoir que le Japon connaît les 4 mêmes saisons qu'en France : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, chacune avec ses avantages et ses inconvénients.
1. Le printemps au japon :
C'est la saison préférée de la majorité des touristes, car le temps y est doux, les cerisiers sont en fleur et offrent un spectacle sans pareil.
Partir au Japon au printemps permet donc de réaliser de magnifiques promenades, de déjeuner dans des parcs fleuris, mais c'est aussi l'occasion d'assister à de nombreux festivals en l'honneur du renouveau des saisons.
1A. Avantages :
-De nombreuses fêtes et festivals, comme le hanami pendant la floraison des cerisiers ;
-Un climat propice aux promenades et visites ;
-Des paysages fleuris, en ville comme à la campagne.
2A. Inconvénients :
-Les touristes sont nombreux, aussi bien Japonais qu'étrangers ;
-Les tarifs sont élevés.
Astuce : La seconde quinzaine de mai (du 15 au 30 mai) est idéale car les Japonais ne sont pas en vacances en cette période, le temps est agréable, et les moussons n'arrivent que plus tard.
2. L'été au Japon :
L'été au Japon est connu pour ses extrêmes : il y fait chaud et très humide.
Si les températures ne vous effraient pas, le Japon en été a de nombreuses choses à vous offrir : somptueux feux d'artifice au bord de l'eau, festivals enivrants, chant des cigales... Sans oublier une gastronomie bien particulière à base de glaces pilées, pastèques et autres nouilles froides.
2A. Avantages :
-La chaleur est au rendez-vous, quelle que soit votre destination ;
-L'occasion de découvrir d'autres mets traditionnels adaptés aux fortes chaleurs ;
-Les congés d'été permettent généralement de rester plus longtemps.
2B. Inconvénients :
-La chaleur et l'humidité peuvent être étouffantes ;
-Les moustiques sont légion en cette saison ;
-Les typhons après le 15 août peuvent être violents.
3. L'automne au japon :
De septembre à novembre, températures agréables et coloration des feuillages caractérisent bien l'automne au Japon. C'est, après le printemps, la région de prédilection des amoureux de la nature qui peuvent alors apprécier les couleurs chatoyantes rouge et or que prennent les feuilles des arbres, enflammant des collines entières, les parcs, les temples...
A l'instar du printemps, c'est une période tout à fait adaptée à la promenade, aussi bien en ville qu'à l'extérieur. Rien de tel qu'une balade en forêt ou une escapade en montagne pour vous plonger dans une ambiance empreinte du Japon d'autrefois, naturel et sauvage.
3A. Avantages :
-Des paysages aux couleurs uniques;
-Un climat doux et propice aux promenades et visites ;
-Moins de touristes qu'au printemps.
3B. Inconvénients :
-Possibles pluies d'automne ou fin des typhons en début septembre ;
-Des tarifs parfois élevés du fait d'une saison de plus en plus populaire.
Astuce : La première quinzaine d'octobre (du 1er au 15 octobre) est idéale car les Japonais n'ont pas de congés particuliers ni de vacances scolaires durant cette période, il n'y a plus de typhons donc le temps est sec, et les touristes sont encore peu nombreux.
4. L'hiver au japon :
A la question « Quand partir au Japon », rares sont les réponses où l'hiver est mentionné. Et pourtant, l'hiver au Japon revêt plusieurs qualités qui méritent d'être soulignées.
Si cette saison est naturellement la plus froide, l'air y est plus sec qu'en France et le ciel généralement clair et ensoleillé. Le nombre réduit de touristes permet d'aller et venir librement dans de nombreux lieux.
Par ailleurs, le Japon propose une grande diversité de paysages hivernaux du fait de microclimats.
Enfin, choisir l'hiver pour votre voyage vous offre une chance de voir Kyoto sous la neige, un tableau splendide et inoubliable.
4A. Avantages :
-Des prix très attractifs aussi bien au niveau de l'hébergement que des vols ;
-Des paysages très diversifiés ;
-Moins de touristes que le reste de l'année.
4B. Inconvénients :
-Les faibles températures ;
-Les éventuelles fortes chutes de neige.
Quand partir au Japon n'a finalement pas de réponse unique, cela dépend avant tout de l'expérience que vous souhaitez vivre.
la santé au Japon.
Le niveau d'hygiène est dans l'ensemble bien meilleur au Japon qu'en Europe. Si depuis 2008, il n'est plus possible de fumer dans les taxis, les cigarettes peuvent être allumées dans les restaurants. En ville, il vaut mieux fumer dans les espaces ou enseignes réservés à cet effet. Lors de balades hors de la ville, notamment sur les monts, il est souvent interdit de fumer.
La pollution et la chaleur l'été sont à prendre en compte pour les personnes fragiles.
Il n'y a pas de paludisme au Japon, et aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer dans le pays. Les vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite (à moins d'être à jour) et l'hépatite A (à moins d'être immunisé) sont recommandés. Les plus prudents et les plus aventureux devront y rajouter l'hépatite B. Les vaccinations sont à planifier trois semaines avant le départ (pour laisser à l'immunité le temps d'apparaître), et prévoir deux mois pour l'hépatite B.
Il est conseillé de se vacciner contre l'encéphalite japonaise en cas de séjour en milieu rural, d'une durée de plus d'un mois, pendant la période de transmission.
Enfin, il faut savoir que le pays dispose d'une structure hospitalière remarquable (mais il faut vérifier avant le départ que l'assurance couvrira les frais médicaux, élevés dans ce pays). Avant toute souscription d'assurance maladie, vérifiez tout de même si votre carte de crédit vous donne droit à une quelconque couverture. Vous pourriez ainsi éviter des frais inutiles.
Les ambassades ont également leurs propres médecins attachés.
N'oubliez pas non plus vos éventuels traitements en cours. Amenez les ordonnances nécessaires et les médicaments dont vous avez besoin (vous risquez en effet d'avoir des difficultés à trouver les bonnes références sur place).
Sécurité au Japon.
Le Japon est l'un des pays les plus sûrs du monde.
Les vols à la tire sont ici quasiment inconnus et les agressions ne sont généralement pas à craindre.
Séismes.
Au Japon les séismes sont très nombreux, plus de 5 000 secousses sismiques enregistrées par an.
On ne peut pas encore les prévoir, même si le Japon a développé des technologies avancées dans ce domaine.
Les séismes sont fréquents et peuvent devenir redoutables, notamment dans les plaines du versant pacifique qui sont les plus peuplées (le séisme de Kobe a fait plus de 6 000 morts en 1995). Ils peuvent provoquer de terribles tsunamis lorsqu'ils se produisent au large. Les derniers séismes meurtriers se sont produits les 14 et 16 avril 2016 sur l'île de Kyushu, dans la région de Kumamoto, qui a subi deux tremblements de terre de magnitude 6,5 et 7,3, causant la mort de 64 personnes et endommageant des milliers de bâtiments, dont le magnifique Kumamoto-jo qui restera fermé pour de très nombreuses années.

Sumo Spot Publicitaire.
Sports Traditionnels.
1. Sumo :
Le sumo, sport individuel est une lutte rituelle d'origine shinto dont 48 prises sont bien codifiées. L'arène est circulaire et son diamètre est d'environ 4,50 mètres. Elle symbolise le ciel. Elle est délimitée par une corde de paille qui définit un rond sacré représentant la terre. La lutte consiste à pousser son adversaire en dehors du cercle ou à le renverser sur le sol. Les lutteurs professionnels mesurent pour la plupart deux mètres et pèsent entre 130 kg et 150 kg. La lutte des sumotori, ou rikishi, remonte vraisemblablement aux premiers siècles de notre ère et symboliserait le combat entre deux clans opposés. Le carré (dohyo) mesure 7 mètres de côté et soutient l'arène en terre battue située à environ 50 centimètres du sol. Deux lignes distantes de 1,20 mètre sont tracées au centre du cercle et représentent les limites des deux lutteurs. Un toit (yakata) reproduisant celui d'un sanctuaire shinto est suspendu au-dessus de l'arène. Aux angles de cette toiture sont accrochés des fusa qui symbolisent les quatre saisons. Aucune femme n'est autorisée à monter sur l'aire de combat, quelle que soit la circonstance mais il semble qu'une fédération féminine soit en devenir.
Le rôle du superviseur (yodibashi) consiste non seulement à appeler les lutteurs et à vérifier le bon usage des règles de combat, mais aussi à contrôler la construction du dohyo et à veiller à son entretien. C'est lui qui donne le signal du début du combat. Les lutteurs, une fois appelés, se font face. Ils montent sur le dohyo et s'adonnent aux rites constitutifs du sumo. Chaque lutteur se lave les mains et la bouche, s'essuie avec un morceau de papier et lance du sel pour se purifier et se mettre en phase avec kami. Lorsque le rituel est accompli, les deux sumotori se font à nouveau face et étendent les bras afin de montrer leur loyauté et leur absence d'arme. Le shikiri peut alors commencer. Ils s'accroupissent sur leurs poings et essaient de percevoir comment ils peuvent prendre position dans le ma, l'intervalle d'espace et de temps qu'ils ont en face d'eux sous la forme de leur adversaire. Ils se relèvent, rejettent du sel, purifient à nouveau l'espace. Ils sont obligés d'engager le combat au troisième rituel, mais autrefois ce rituel pouvait être répété autant de fois qu'il le fallait. Le combat pouvait aussi ne pas avoir lieu, l'un ou l'autre des sumotori reconnaissant dans le rituel que le ma était occupé par son adversaire et qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, la rencontre se fait obligatoirement. L'engagement est d'une extrême rapidité en comparaison du temps de préparation rituelle. Les sumotoris obéissent à un code très strict selon lequel ils ne doivent utiliser que 48 prises (kimarite) dûment répertoriées. L'arbitre (gyoji) lève son éventail de couleur afin de désigner le vainqueur. Celui-ci restera à côté de l'arène afin d'offrir l'eau qui permet de vaincre (eau de la force ou chikaramizu) aux prochains combattants.
Actuellement il y a environ 60 équipes, 600 lutteurs, plusieurs divisions et tous exercent leur art dans la même catégorie de poids. Le nombre de victoires d'un Sumo lui donne une position hiérarchique.
Toute l'organisation du sumo est basée sur le principe du rang du lutteur. Ce rang est affecté en fonction des résultats de chaque combat du rikishi : chaque victoire fait monter dans la hiérarchie, mais chaque défaite peut faire redescendre. A part le rang supérieur des Yokozuna, chaque rikishi peut ainsi monter très haut dans la hiérarchie puis redescendre un jour...
Seul le rang de Yokozuna n'autorise pas à déchoir de cette distinction et amène si nécessaire à une retraite anticipée !
Des tournois de sumo, professionnels et universitaires, sont régulièrement organisés à Tokyo, et si on est intéressé, encore faut-il que leurs dates correspondent à celle du séjour prévu. Les rencontres sont répertoriées sur un site Internet : www.sumo.or.jp/eng/index.html
Un combat est dirigé et jugé par un arbitre sur le ring et plusieurs autres au sol hors de l'arène. Si le rituel est assez long, le combat en lui même est très court, de 10 à 20 secondes parfois un peu plus !
2. Arts martiaux :
Les arts martiaux se sont développés au Japon pendant la période Heian, alors que le pouvoir impérial laisse peu à peu l'espace politique s'effilocher au profit des grandes familles aristocratiques. C'est à cette époque que surgit le samouraï et que le bushido impose un mode de vie du guerrier, tout comme une façon particulière de créer le mouvement. Les jutsu, c'est-à-dire les techniques, prirent alors une place prépondérante : le sabre (ken-jutsu), le tir à l'arc (kyu-jutsu) ou le Ju-jutsu, la technique du yawara et la souplesse. Les termes de do (ou voie) sont beaucoup plus récents et impliquent la référence à un aspect spirituel. Initialement, les arts martiaux sont des jutsu, la partie spirituelle, utilisation de l'énergie etc., étant des « conditions préalables » acquises.
2A. Judo :
"Voie de la souplesse ", ce sport fut créé par Jigoro Kano en 1882. La technique repose sur les mouvements de base du ju-jutsu, les lois du mouvement et leur utilisation, mais également sur les principes moraux pratiqués par les bushi (en japonais on dit plutôt bushi que samouraï). Un certain nombre de mouvements s'enroule dans une suite afin d'utiliser la force de l'adversaire à son propre avantage. Déséquilibrer et immobiliser (kuzushi) demandent donc une pratique, c'est-à-dire des exercices (randori) sur les tatamis du dojo. Cette pratique est sanctionnée par des degrés (kyu) symbolisés par les ceintures (de la blanche à la noire), puis par des maîtrises (dan) de la seconde à la dixième.
Le Judo a été introduit en France en 1908 par Leprieur. Il est devenu une discipline olympique en 1964 et comporte sept catégories de poids.
2B. Karaté :
Karaté signifie « mains vides ou mains nues ». Il vient des îles Ryukyu où il fut pendant des siècles une synthèse entre l'art martial de défense d'Okinawa et le kempo chinois. Le karaté signifie également « main chinoise », lorsqu'un autre kanji lui est appliqué. Les nombreux exercices consistent à pratiquer des kata (séquences de mouvements type). L'art du karaté consiste à n'avoir aucun contact avec l'adversaire mais, au contraire, à simuler le combat en arrêtant le coup exactement avant qu'il ne soit porté. C'est la précision des kata qui permettront cette maîtrise. Les différents mouvements furent codifiés par Gichin Funakoshi, qui en fit une discipline sportive. À partir du canevas d'origine, différentes écoles ont fleuri, comme l'école Shotokan ou Goju-ryu.
2C. Kyudo :
Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc est devenu un classique dans la littérature des arts martiaux. Au Japon, le tir à l'arc s'apprend à l'école. La voie do est venue se substituer à la technique jutsu pendant la période Edo. La technique consistait en une maîtrise guerrière du tir, surtout sur des cibles en mouvement, le tireur étant lui aussi en mouvement. Le samouraï devait faire preuve d'une grande habileté pour tirer à l'arc sur son cheval. Le kyu-jutsu fut la première des disciplines dans les dix-huit techniques guerrières (kakuto-bugei) transmises par les grands maîtres. La longueur de l'arc, la difficulté à le tendre ont beaucoup influencé les techniques. Puis l'arc perdit de son importance au profit des armes à feu. Il est ainsi devenu davantage une discipline mentale qu'un art de précision. Il s'agit à présent de mettre en harmonie les différentes techniques de position et le contrôle de soi afin d'obtenir le wa (état d'harmonie). L'arc est fait de bois et de bambou et mesure plus de deux mètres. Il connaît un grand succès auprès des jeunes filles. Des représentations ont lieu de temps à autre à Tokyo.
2D. Kendo :
C'est la voie du sabre, mais le sabre a été remplacé par un sabre de bambou, le shinaï. Le ken-jutsu (technique du sabre) fut interdit sous l'ère Meiji afin de désarmer les samouraïs qui n'approuvaient pas la nouvelle politique de restauration. Il se transforma alors en un sport de combat sous l'influence de Kenkichi Sakakibara, et cet art prit le nom de kendo en 1900. Le combattant porte un certain nombre de vêtements et de protections : le masque, ou men, une chemise croisée (keidogi) et un pantalon-jupe, l'hakama. La protection du torse (do) et des parties génitales est assurée par le tare. L'espace où se déroule le combat mesure neuf mètres sur onze. Cet art demande énergie et maîtrise de soi, patience et extrême rapidité. Comme le judo, il comporte six phases d'apprentissage et dix niveaux de maîtrise (dan).
2E. Aïkido :
Le aï, c'est l'harmonie (kanji de « rencontre »), le ki (difficilement traduisible : souffle vital, énergie vitale), et enfin le do c'est la voie. Ainsi, aïkido pourrait être traduit par « voie de l'harmonie avec l'énergie ».
Cet art martial fait partie des derniers élus, puisqu'il a été créé à Tokyo en 1931 par Morihei Ueshiba. Ce sport de combat est fondé sur plus de 500 kata et mouvements, exécutés selon une technique différente, un mouvement de déplacement en apparence circulaire qui s'appelle le taïsabaki. Il s'agit de retourner en miroir la force de l'adversaire contre lui-même. C'est également un art martial à mains nues. Il doit allier le hara (ventre), centre de gravité et de stabilité, et le ki, l'énergie intérieure. La maîtrise de toute chose ne peut être atteinte que lorsqu'on a saisi l'harmonie entre les choses. L'aïkido se pratique dans un dojo, dans le shimoza qui fait face au kamiza réservé aux maîtres.

WC Tableau Commandes.
Toilettes.
Prononcer : toïlé ou o-téalaille.
Dans la plupart des lieux publics et chez les particuliers, des chaussons sont laissés à l'entrée des toilettes. Il convient de les enfiler en entrant aux toilettes et de ne pas oublier de les retirer en sortant.
Il y a des toilettes publiques dans pratiquement toutes les gares et les kombini au Japon, gratuites et extrêmement propres. Le papier toilette n'est pas toujours fourni, mais des distributeurs en dispensent parfois. Sinon, pensez à conserver les paquets de mouchoirs qui sont distribués à la sortie des métros ou dans les quartiers animés et passants, et qui servent de publicité pour les tere-kura (clubs de rencontres téléphoniques, notamment avec des collégiennes).
Auparavant, les toilettes à la japonaise ressemblaient un peu à celles dites à la turque. Mais pratiquement partout, il existe des toilettes à l'occidentale, qui sont parfois équipées d'un véritable tableau de bord, grâce auquel un jet d'eau tiède peut vous laver le postérieur, un autre jet est plus spécifique aux dames et avantage non négligeable surtout en hiver, le siège est toujours chaud près à vous accueillir !
Vous trouverez souvent, à côté des toilettes des femmes, une machine rectangulaire sur laquelle est collée une photo de cascade. Si vous appuyez sur le bouton, vous entendrez alors un bruit de cascade, de chant d'oiseau ou de chasse d'eau... qui évite pudiquement que l'on ne vous entende.
Dans les métros et les galeries commerciales, les toilettes publiques pour femmes s'apparentent à un salon de beauté. C'est un vrai spectacle que de voir les Japonaises pressées se remaquiller avec art, se vernir les ongles, se recourber les cils, tout en téléphonant...
On peut ajouter que le tableau de commande des WC possède un marquage en braille (très utile sans lumière !).
Téléphonie au Japon.
Si vous souhaitez appeler vos proches, pensez à souscrire une offre adaptée auprès de votre opérateur.
Ne négligez pas non plus votre connexion Internet si vous comptez faire des recherches sur votre téléphone, l'utiliser comme GPS ou autre.
Des solutions comme Pocket Wifi, qui vous permettent de bénéficier d'une connexion Wifi partout où vous allez, pourraient également être utiles.

Japonaise en Kimono devant une boutique.
Traditions et Coutumes.
L'attrait du Japon se situe, par exemple, bien sûr dans les terres sauvages d'Hokkaido, les plages d'Okinawa, les temples de Shikoku, dans la vitesse et le design du Shinkansen, dans la taille des mégalopoles de Tokyo, Osaka, Yokohama et leurs bouillonnements, dans la quiétude des petits villages.
Certains occidentaux seront touchés par la variété des paysages, la recherche esthétique dans l'arrangement floral ikebana, l'architecture traditionnelle, les rencontres de sumo, les arts martiaux, la cuisine, les mangas et le cinéma japonais, les cerisiers en fleurs au mois d'avril, le théâtre kabuki ou le nombre d'inventions record déposées chaque année au Patent Office...
La maison japonaise traditionnelle est en bois et la charpente est assemblée sans un seul clou ou pièce métallique. Le tout repose sur des piliers ce qui lui assure une bonne résistance flexible aux multiples séismes.
Le contact corporel est important. Les jeunes époux dorment avec les petits dans le même futon et les Japonaises ont les enfants attachés traditionnellement sur le dos. Cette coutume s'est estompée avec l'arrivée des poussettes pliables.
Le lien avec les ancêtres est important et un petit autel dans la maison rappelle ceux-ci et l'on se recueille tous les ans sur le tombeau de famille. La relation oya bun ko bun (traduisible par « les anciens pour les nouveaux ») est présente dans toute la société japonaise.
Les vêtements traditionnels sont très présents et il n'est pas rare de rencontrer une japonaise en Kimono faisant ses courses.
Le kimono est formé de rectangles de tissus pliés et cousus, mais jamais recoupés. Il est rectiligne, tombant jusqu'aux pieds ou chevilles, suivant l'usage et la personne qui le porte.
Le kimono se porte toujours côté gauche sur côté droit, car d'une part cela permettait de cacher une arme courte (tanto), et d'autre part, les morts sont habillés en croisant dans le sens inverse.
Ce kimono est tenu en place par une large ceinture nommée "obi" qui distingue certains groupes dans la société. Cette ceinture est nouée dans le dos, sauf pour les prostituées où le noeud est devant. Celle des hommes a une largeur d'environ 8 cm alors que celle des femmes varie de 12 à 30 cm.
En traditionnel, les tissus sont très variés, comme le lin, la soie, la ramie, la fibre de murier, le chanvre.
Les modes de tissage sont très nombreux comme taffetas, serge, satin, satin damassé, crèpe ou gaze.
Le choix des tissus et le fait qu'ils soient superposés ou ouatés permet de produire des vêtements adaptés aux saisons.
Les kimonos anciens sont décorés par des motifs traditionnels (pin, bambou, tortue, libellule, roue, cerisiers, pivoines, iris, rochers, eau courante, vagues, paysages) mais aussi de motifs géométriques (Cercles, quadrilatères, losanges) ou encore de noeuds.
Quelques noms de kimono pour s'y retrouver : Keikogi pour les arts martiaux, Judogi, la tenue de judo, Kesa, robe des moines et moniales bouddhistes.
Pour la terminologie des chaussure, il y a "Zori" qui est une sandale couverte de tissu, de cuir, ou de paille tissée. "Geta" est une sandale de bois portée en été. "Waraji" est une sandale de paille tissée Portée par les moines.
Autres vêtements et accessoires : "Tabi" chaussettes qui montent jusqu'aux chevilles avec le gros orteil séparé des autres. (portées avec les sandales traditionnelles). "Hakama" est un vêtement couvrant le bas du corps, très ample, porté traditionnellement par les hommes, les femmes le réservant à certaines cérémonies (ou, anciennement, aux voyages à cheval). Le hakama peut prendre deux formes, celle d'un pantalon ou celui d'une jupe. Il est porté par-dessus un kimono. "Haori" est une veste qui tombe aux hanches ou jusqu'aux genoux, et les femmes la porte plus longue que les hommes.
Tous ces éléments participent à l'intérêt que le visiteur éprouve envers le Japon et ses habitants.
Gare aux Typhons.
À travers le monde, on utilise différentes dénominations pour parler de cyclones tropicaux. Dans la région Atlantique Nord, on parle le plus souvent d'ouragans. En Asie, c'est le terme typhon que l'on utilise. En japonais, on prononce taifû.
Les typhons peuvent tout détruire sur leur passage et il est donc important de se renseigner à leur sujet avant d'organiser votre voyage au Japon.
La saison des typhons :
L'été correspond à la saison des pluies. À partir du mois d'août, ces précipitations abondantes peuvent s'accompagner de vents très violents. Quand ceux-ci dépassent 117 kilomètres par heure, on parle alors de typhons. Ces tempêtes tropicales sont généralement les plus fortes la dernière semaine d'août et les premiers jours de septembre. Les typhons cessent complètement à partir du mois d'octobre.

Onsen et Macaques Japonais en duo au bain chaud.

Kamakura Grand Bouddha Assis Bronze de 12m et 122 Tonnes.

Calligraphie Modele Mont Koya.

Calligraphie Atelier au Monastère du Mont Koya.

Tokyo méga carrefour de Shibuya.

Tokyo Foule sur le méga carrefour de Shibuya.

Tokyo méga carrefour de Shibuya et son Marquage.

Tokyo méga carrefour de Shibuya et les Parapluies.

Chat Statue de Bienvenue de Toba.

Estampe Mont Fuji une Barque sur la Riviere.
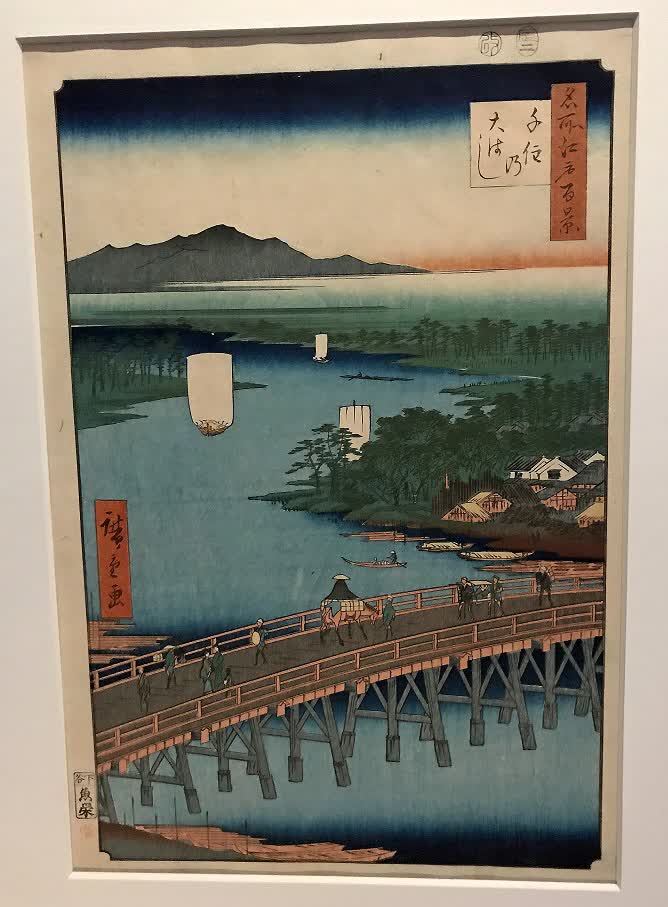
Estampe Paysage Japonais Pont et Riviere.

Geisha dans le quartier Gion de Kyoto.

Deux Grues en marche.

Deux Grues en face à face.

Mont Fuji 3776m et lac Ashinoko Hakone.

Mont Fuji 3776m Mosaïque.

Himeji Chateau.

Jardin Zen de Ryoanji.

Japonaise en Kimono Blanc avec Ceinture Sombre.

Japonaise en Kimono Blanc Motif Floral Rose.

Maison Typique des Alpes Japonaises.

Mariage Traditionnel à Tokyo.

Matsumoto Château Le Corbeau Noir.

Matsumoto Château Le Corbeau Noir vu le soir.

Plan du Metro de Tokyo.

Metro et Quai à Tokyo.

Metro Jaune de Tokyo.

Moine et Aumone au Japon.

Panorama du Palais Imperial de Tokyo.

Plan du Palais Imperial de Tokyo.
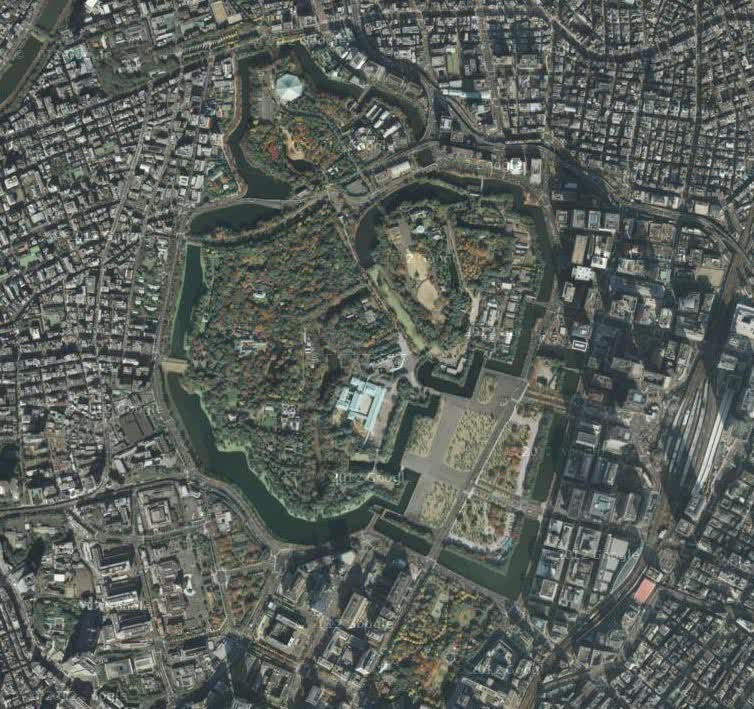
Vue Satellite du Palais Imperial de Tokyo.

Parapluie Etanche Test de Toba.

Tenue de Samouraï au Château de Matsumoto.

Sumo Ring Reproduction.

Tokyo Akihabara Quartier Geek.

Tokyo Pont Rouge sur la Rivière Sumida Secteur Asakusa.

Tokyo Rivière avec Illumination d'un Pont.

Tokyo Tour Skytree 634m.

Tokyo Tower 333m Construite en 1958.

Tokyo Tower en Bleu et Blanc 333m Vue en 2018.

Notre Groupe Auberge Okuyumoto - Ryokan de Hakone.
Le nom du Japon, qui se dit Nihon ou Nippon (? ?) signifie littéralement l' « origine du soleil ». On peut donc donner comme signification à ce nom « le pays du soleil levant », et c'est cette traduction qui est la plus souvent retenue. C'est d'ailleurs lors des premiers échanges commerciaux avec la Chine que cette appellation fut introduite, alors que les Japonais de l'époque désignaient leur pays sous le nom de Yamato.
Géographie du Japon.
Le Japon forme une chaîne d'îles montagneuses disposées en arc sur la face orientale de l'Asie. L'archipel, d'une superficie de 377 873 km², est composé de quatre îles principales (Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu) et d'une multitude d'îlots, 6 852 qui s'étirent sur plus de 3 000 kilomètres.
Ces îles s'étendent du 27° au 46° de latitude N et du 146° au 129° de longitude E.
Le Japon se caractérise par son relief accidenté dû à la rencontre, il y a quelques millions d'années, entre la croûte pacifique et la plaque asiatique. Les pentes supérieures à 15 % forment les trois quarts du pays. Le mont Fuji culmine à 3 776 mètres. Dans la chaîne des Alpes japonaises, une trentaine de sommets dépassent 3 000 mètres. La jeunesse du relief se traduit par la forme aiguë des hauteurs, les nombreux séismes (5 000 secousses sismiques enregistrées par an) et un volcanisme actif. Sur 265 volcans, une vingtaine s'est manifestée depuis le début du XXe siècle. Les plaines occupent 16 % du territoire et sont constituées par des alluvions. Les plus grandes plaines sont celles de Niigata, de Toyama et d'Ishikawa sur la mer du Japon. Les plaines de Sendaï, du Kanto, de Nobi (Nagoya) et enfin d'Osaka donnent sur le Pacifique.
Les vallées dégagées par les axes montagneux ont vu se réunir des fleuves irréguliers que des terrasses recouvertes de cendres et de limons volcaniques ceinturent. Le Japon compte 28 000 km de côtes, ce qui est considérable. Les côtes de la mer du Japon sont basses et parfois marécageuses.
Celles du Pacifique sont très découpées et bordées de falaises, avec des baies très profondes. La lutte contre les tsunamis (raz de marée) a largement contribué au bétonnage du littoral.
Le tsunami de 2011 :
Le 11 mars 2011, en début d'après-midi, un puissant tremblement de terre au large de la côte orientale du Japon provoqua un tsunami d'une rare violence, qui détruisit plusieurs préfectures, et fit des dizaines de milliers de victimes. Malgré une organisation exemplaire et louée dans le monde entier (même si les dirigeants politiques japonais furent montrés du doigt par la population), cette catastrophe naturelle de grande ampleur révéla les déficiences de l'archipel, en particulier dans le domaine nucléaire, les deux centrales de Fukushima étant sévèrement endommagées suite au tremblement de terre.
Il y a, au Japon, un avant et un après 11 mars 2011.
Situé dans l'hémisphère Nord, le Japon connaît les mêmes saisons qu'en Europe. Toutefois, la superficie du Japon, qui part des contrées sibériennes pour descendre presque jusqu'aux tropiques, et sa double exposition vers le Pacifique et la mer du Japon ont créé des climats variés et parfois paradoxaux.
Deux courants, l'un froid (oyashio) et l'autre chaud (kuroshio), se rencontrent à la fois dans la mer du Japon et dans le Pacifique. Le courant froid descend de la Sibérie et l'autre remonte de l'équateur. On peut penser que la rencontre de ces deux courants a fait beaucoup pour l'éclosion de la faune et de la flore marines. Mais si ceux-ci jouent un rôle dans le développement de la vie, l'influence de la masse continentale asiatique demeure primordiale.
A Tokyo, les vents froids d'hiver viennent du nord-ouest et se chargent d'eau en passant au-dessus de la mer du Japon pour finir en neige sur le versant ouest. En été, les vents tropicaux remontent sur les deux versants et se manifestent par d'abondantes chutes de pluie en juin et septembre, tandis que les mois de juillet et août peuvent devenir très chauds et humides. Mais dans son ensemble, l'archipel est dominé par une très grande variation de températures : on peut passer de -30 °C à Hokkaido (la mer qui borde Hokkaido, la mer d'Okhotsk, gèle l'hiver jusqu'à avril) à 40 °C dans le Kyushu ou à Okinawa. Si l'hiver est sec et froid à Tokyo, ce qui constitue un climat assez agréable, de l'autre côté, sur la mer du Japon, le temps reste couvert et le ciel zébré de longues bourrasques neigeuses.
Violence du milieu naturel :
-Eruptions volcaniques :
On peut désormais les prévoir, ce qui supprime les risques de pertes humaines. Néanmoins, les Japonais se méfient plutôt des conséquences immédiates, c'est-à-dire des glissements de terrain et des fleuves de boue.
-Séismes :
On ne peut pas encore les prévoir, même si le Japon a développé des technologies avancées dans ce domaine. Les séismes sont fréquents et peuvent devenir redoutables, notamment dans les plaines du versant pacifique qui sont les plus peuplées (le séisme de Kobe a fait plus de 6 000 morts en 1995). Ils peuvent provoquer de terribles tsunamis lorsqu'ils se produisent au large. Les derniers séismes meurtriers se sont produits les 14 et 16 avril 2016 sur l'île de Kyushu, dans la région de Kumamoto, qui a subi deux tremblements de terre de magnitude 6,5 et 7,3, causant la mort de 64 personnes et endommageant des milliers de bâtiments, dont le magnifique Kumamoto-jo qui restera fermé pour de très nombreuses années.
-Typhons :
Ils ont lieu entre juin et septembre selon la latitude et sont particulièrement forts entre la fin août et le mois de septembre. Plus de vingt typhons se manifestent chaque année, et selon les années plusieurs d'entre eux touchent l'archipel. Ils s'accompagnent souvent d'inondations et de vents dévastateurs pour les récoltes.
Histoire du Japon.
Origines :
L'analyse d'ADN de mitochondries a révélé que le Japon a commencé à être habité par l'Homme il y a de cela 50 000 ans et que l'Homo japonicus moderne serait un mélange des peuples de l'époque Jomon (peuplades venues du continent Eurasie orientale et même Europe dans l'antiquité et occupant le Japon à l'origine) et Yayoi (peuplades venues de Chine et de Corée).
L'époque de Jomon est considérée par les Japonais comme la forme fondamentale de leur civilisation, le terme de « Jomon » désigne les motifs appliqués (-mon) de cordes (Jo) que l'on trouve fréquemment sur les poteries de cette époque. Les archéologues saccordent à dire que les plus vieilles poteries du monde se trouvent au Japon.
Jomon primitif : les Hommes sont sédentaires et vivent à proximité des côtes, principalement de pêche et de cueillette.
Jomon moyen : civilisation du bois et du végétal. Les Hommes commencent à travailler les fibres végétales. Apparition de la hache à lame verticale, des arcs et des flèches, ainsi que des figurines en terre.
Jomon tardif : apparition de l'agriculture.
Depuis quelque temps, les Japonais regardent l'époque de Jomon avec une certaine nostalgie. Durant 10 0000 ans, le Japon a vécu paisiblement sans guerre ni conflit, et avait un mode de vie équilibré et un niveau culturel très avancé. Par exemple, les poteries de cette période sont beaucoup plus belles et plus variées que celles venues du continent à la période suivante, l'époque Yayoi. Les poteries trouvées dans les vestiges Jomon portent encore des restes d'algues laminaria (varech).
On suppose que ces algues étaient utilisées pour donner un fond, un assaisonnement aux plats bouillis ou cuits. Bref, il y a quelque 12 000 ans de cela, les Japonais ne mangeaient pas cru. Ils ne faisaient pas simplement cuire la viande, le poisson ou les plantes pour se nourrir. Ils savaient déjà donner du goût aux aliments, c'est-à-dire qu'ils possédaient une culture culinaire.
Dans les fouilles du vestige de Sannai Maruyama (département d'Aomori), une « pochette Jomon » (soit un petit sac réalisé par maillage de fibres végétales apparentées au riz et finies à la laque) a été retrouvée, ainsi qu'une route de 15 mètres de large menant à la mer, impliquant une technologie de génie civil assez élaborée. Pour se rendre compte du niveau de culture antique du Japon, et renverser le préjugé selon lequel le Japon serait une culture jeune qui doit tout à la Chine, il est intéressant de faire un (long) détour jusqu'aux vestiges de Sannai Maruyama.
Période Yayoi :
Elle tient son nom de l'important site archéologique de Yayoi-Cho. Les populations du Jomon tardif furent refoulées dans les montagnes et dans le nord du Honshu et de Hokkaido par des vagues migratoires venues du continent. Cette époque se caractérise par l'introduction de nouvelles techniques comme la riziculture, la métallurgie du fer et du bronze, le tour du potier et la pierre finement polie. C'est de cette époque que datent les premières tensions sociales : différences de richesses, de position sociale des individus et tensions entre les villages. Le regroupement de ces communautés donne naissance à la première forme de ce qu'on peut appeler un pays.
Cette époque a été marquée par l'apparition de quatre pays (koku), en l'occurrence le Yamai-koku, le Bunshin-koku, le Daikan-koku et le Fuso-koku (énumérés du sud au nord). Les habitants du Fuso-koku avaient coutume de se désigner eux-mêmes par l'appellation Hinomoto (traduit par « soleil levant » du fait des caractères chinois qui leur sont attribués, mais ayant aussi le sens de « lié à l'origine des choses ». Tel est le véritable message que les Japonais portent sur leur identité). Une large influence coréenne culturelle et, selon certains historiens, politique, se fait sentir. Elle se traduit notamment par la construction dimmenses sépultures (ou kofun) en forme de « trou de serrure » pour ensevelir les chefs. Autour des kofun sont disposées des figurines appelées Haniwa. Le plus ancien et le plus grand kofun japonais est celui de l'empereur Nintoku, connu pour avoir exempté le peuple de toute taxe pendant trois ans. Ce tumulus est la plus grande tombe connue au monde (plus grande que les pyramides). Il fait 480 mètres de long et 305 mètres de large. Si l'on transpose en camions de 5 tonnes la quantité de terre amoncelée, cela fait plus de 560 000 camions, ou en travail manuel quatre années de travail pour 1 000 personnes. Au Ve siècle, émerge la puissante cour du Yamato (au nord-est d'Osaka). Cette dynastie centralisatrice fédère d'abord les clans guerriers de la région avant de contrôler presque tout le pays, à l'exception du Nord où vivent les Ainu.
Epoque Asuka :
Elle voit l'émergence du Japon, c'est-à-dire du regroupement des quatre pays autour d'un État fédérateur et militairement puissant, le Fuso-koku, et d'une capitale, la ville d'Asuka.
Le prince Shotoku Taishi est nommé régent. Il décrète le bouddhisme comme religion nationale et édicte une constitution en 17 articles en l'an 604. On lui attribue également une réglementation des fonctionnaires d'Etat, le premier registre foncier du pays et le premier système fiscal. C'est de cette époque que date la séparation entre pouvoir et dignité (accréditation) du pouvoir, en l'occurrence la personne de l'empereur.
À la mort de ce régent dont la légende rapporte qu'il pouvait écouter simultanément quatre personnes à la fois et leur répondre ( !), le pays plonge dans une période de grande instabilité et d'intrigues politiques. En 645, le clan Nakatomi, aussi connu sous le nom de Fujiwara, fait un coup d'Etat et lance les grandes réformes de Taika (centralisation à la chinoise).
La particularité de l'époque Asuka doit être attribuée au prince Shotoku Taishi. Ce régent éclairé a maintenu une double position par rapport à la Chine. Il importa le bouddhisme (durant l'époque Asuka, de nombreux émissaires sont partis en Chine pour étudier et rapporter de précieux textes bouddhistes), tout en affirmant clairement l'identité culturelle du Japon.
À ce titre, Shotoku Taishi envoya au monarque chinois de l'époque une lettre dont le titre est bien connu : Lettre de l'Ambassadeur céleste du pays du Soleil Levant à l'Ambassadeur céleste du pays du Soleil Couchant. Dans son contenu, cette lettre montre clairement une attitude de souveraineté que seul le Japon eut en Asie.
On se doute que l'accueil réservé à ce message fut peu enthousiaste, bien qu'il ne contienne pas de provocation. Le prince d'un petit pays comme le Japon se qualifie d'envoyé céleste sur un pied d'égalité, et qui plus est, qualifie la Chine de pays du soleil couchant ! La colère chinoise devant cette attitude reste en toile de fond des relations sino-japonaises. Elle explique les efforts que la Chine a faits par la suite pour annexer le Japon à son Empire (deux attaques en 1274 et en 1281), mais aussi le reste de l'histoire entre les deux pays.
Alors que l'Antiquité est marquée par le développement de nombreux petits pays, l'époque d'Asuka (552-710) marque une étape significative dans l'unification du pays, sous le nom de Fuso-koku. A l'époque suivante, la centralisation étatique se renforce peu à peu, sur le modèle chinois. La capitale, Heijokyo, dont l'actuelle Nara n'est que le faubourg oriental, est tracée selon le plan en damier de la capitale des Tang. Les échanges culturels et commerciaux entre le Japon et la Chine se développent. Cette période est considérée comme le premier âge d'or de l'art japonais. Afin d'éviter l'influence du clergé bouddhique de Nara, l'empereur Kammu choisit un nouveau site pour établir la capitale, à 50 km au nord : Heian-Kyo qui n'est autre que l'actuelle Kyoto. Elle restera résidence impériale pour plus de mille ans (794-1868).
Les grands propriétaires terriens du clan Fujiwara détiennent le pouvoir réel, notamment en mariant leurs filles aux empereurs. En 1068, l'empereur Go-Sanj tente de reprendre le pouvoir en écartant les Fujiwara et en créant le gouvernement retiré (Insei). Deux clans opposés vont alors se battre, les Taira et les Minamoto. Ces derniers emportent une bataille décisive en 1185 à Dan no Ura et installent le siège de leur autorité à Kamakura, tandis que la cour demeure à Heian, impuissante mais officiellement respectée.
Epoque de Heian :
C'est un grand âge d'or du bouddhisme. Deux moines, Saicho et Kukaï, font le voyage en Chine et reviennent fonder les sectes Tendaï et Shingon. Selon les écrits officiels, Kukaï ramène avec lui un nouveau syllabaire qui permettra aux femmes de la cour, qui n'écrivent pas avec les idéogrammes chinois, de créer une nouvelle littérature japonaise. Les arts (peinture, sculpture, architecture) s'épanouissent. Mais le raffinement de la vie de cour entraîne la corruption.
Après s'être débarrassé de son demi-frère Yoshitsune, Yoritomo Minamoto décide de quitter la capitale et d'installer son gouvernement militaire (bakufu) à Kamakura, en 1192. L'empereur lui donne le titre de Sei-i-Tai-Shogun (généralissime pour la soumission des barbares). Éloigné de la capitale, Yoritomo n'a de cesse de faire entériner ses décisions par l'empereur. Pourquoi Yoritomo Minamoto a-t-il installé un Bakufu à Kamakura ? A cette époque, la politique du pays était entre les mains des nobles, mais il était devenu clair pour Minamoto que le Japon ne pourrait plus être géré par cette classe.
Le Bakufu de Minamoto a été créé avec des guerriers issus du monde paysan, c'est-à-dire des paysans qui étaient gardiens ou gardes du corps des maisons de nobles. Mais le Japon contenait encore beaucoup de familles de nobles possédant leurs propres armées ici et là.
Pour les contrôler, Yoritomo a donné le titre de shugo (protecteurs) à des guerriers de son clan. Ils étaient chargés de contrôler administrativement les provinces. Il créa un autre corps de fonctionnaires, les jito (chefs terroirs) amenés à prélever une taxe sur les terres.
Cette administration devient la colonne vertébrale de la nouvelle féodalité. A la mort de Yoritomo en 1199, le pouvoir revient à la famille Hojo, qui apportera à Kamakura un nombre considérable de terres de la région du Kansaï (Osaka).
Les Mongols, devenus maîtres de la Chine et de la Corée, attaquent le Japon par deux fois, en 1274 et 1281. Le concours providentiel d'un typhon (kamikaze ou vent kami « vent divin » -) sauve les Japonais. Mais les Hojo vainqueurs ne peuvent récompenser ceux qui se sont battus pour eux et perdent ainsi le soutien des familles de guerriers.
Période Kamakura :
Elle se caractérise par une esthétique sobre, des thèmes s'inspirant des moeurs guerrières de l'époque et par l'introduction de la doctrine bouddhiste Zen. Fondé sur la maîtrise de soi et la quête personnelle du salut, le Zen compte de nombreux adeptes au sein des familles de guerriers.
Les arts se développent sous l'influence du Zen : le No, l'art des jardins, l'architecture, la peinture, la sculpture, l'Ikebana et la cérémonie du thé. Le Japon s'ouvre à nouveau sur l'extérieur et multiplie les échanges commerciaux avec l'Asie continentale. Alors que la vie culturelle est brillante et que le commerce prospère, le pays sombre dans l'anarchie.
Le nouvel empereur Go-Daigo s'appuie sur Takauji Ashikaga pour évincer le bakufu de Kamakura. Takauji Ashikaga installe son bakufu à Kyoto, dans le quartier de Muromachi, et se fait nommer shogun. Il décide de gouverner à la place de l'empereur. Cette décision entraîne la création d'une double cour impériale : celle du Nord, contrôlée par Ashikaga, et celle du Sud, contrôlée par les légitimistes qui veulent restituer le pouvoir à l'empereur Go-Daigo.
Après de nouvelles révoltes paysannes et l'assassinat du shogun en 1489, une « guerre de cent ans » éclate. Elle se terminera en 1576. Pendant cette période d'anarchie, on assiste à une lutte entre les seigneurs et à l'émergence d'une nouvelle classe sociale, les daimyos, qui règnent sur leurs terres en suzerains et prennent le contrôle de régions entières.
Nobunaga Oda, originaire de la région de Nagoya, défait un à un les seigneurs sur son passage et aspire à devenir shogun dans la cité impériale, Kyoto. Pour pacifier le Japon, il est aidé par deux généraux, Hideyoshi Toyotomi et Ieyasu Tokugawa, mais trahi par l'un de ses vassaux, il est contraint au suicide en 1582. Hideyoshi continue l'entreprise pacificatrice de Nobunaga Oda en conquérant le Kyushu, puis la plaine d'Edo (où se trouvera plus tard Tokyo), et enfin le Tohoku. En 1590, le pays est sous sa tutelle.
La ville d'Edo est fondée en 1453 par Dokan Ota, guerrier vassal des Uesugi, apparentés aux Fujiwara. Il y édifie un château. En 1600, Ieyasu Tokugawa, un des lieutenants de Hideyoshi, s'assure une victoire définitive sur les grands féodaux à la bataille de Sekigahara, et en 1603, installe son bakufu à Edo (ancien nom de Tokyo). Il en fait une citadelle où s'édifie le Joka-machi, la Cité sous le château. Cette organisation permet alors de contrôler socialement le développement démographique qu'entraîne la résidence du shogun à Edo.
Le nouveau shogun veut que le système gouvernemental lui survive. Aussi transmet-il sa charge de shogun à son fils et massacre-t-il les Toyotomi, les proches de Hideyoshi, en 1615. Le shogun constitue l'autorité suprême. Les daimyos qui doivent administrer les régions soumises sont étroitement surveillés : leurs alliances et mariages sont contrôlés. Ils doivent vivre un an sur deux à Edo, tandis que leur famille y est assignée à résidence. Le shogun met en place un véritable réseau d'espions à l'intérieur du Japon. Les chrétiens (600 000 environ) sont traqués, puis expulsés en 1615. Le Japon se ferme à toute influence étrangère dès 1635. À l'intérieur, la même année, le sankin-kotaï, ou l'obligation faite aux vassaux de résider au moins une année sur deux à Edo, est mis en place. Il attire une foule d'artisans et toutes sortes de métiers. Les daimyos et les samouraïs occupent la cité autour du palais impérial ou sur les pentes des collines de la ville haute de Yamate, c'est-à-dire « main de la montagne », tandis que les artisans et marchands (shonin) s'installent dans la ville basse, Shitamachi.
Alors que plus de la moitié de la population ne peut investir que 15 % du territoire de la ville, on gagne du terrain en asséchant la plaine des roseaux, Yoshiwara, qui deviendra le quartier des plaisirs, dans le Taito-ku (arrondissement de Taito). Ainsi, la ville est divisée en deux : ville basse au contact de la mer, établie autour du port, et ville haute où s'installent les résidences des nantis.
Après une révolte de paysans, appuyée par les chrétiens en 1637, le shogun interdit à tout Japonais de se rendre à l'étranger sous peine de mort. Seuls les Hollandais ont le droit de commercer dans l'île de Dejima, à Nagasaki.
Pour faciliter le commerce intérieur, le shogunat trace de grandes routes et lève les barrières d'octroi. Les grandes voies sont défendues par des châteaux forts. Les villes se développent et la classe des shonin (marchands et citadins) émerge. Une nouvelle culture voit le jour : Edo devient la capitale du « monde flottant » (ukiyo), des plaisirs et de l'éphémère, avec le kabuki, l'art des estampes (Ukiyo-e), l'art des geishas, le théâtre de marionnettes bunraku...
Ville codifiée :
La cité sous le château organise alors une ville qui devient peu à peu le réseau urbain extrêmement codé de la vie sociale. En haut se trouve la noblesse qui dispense le pouvoir, puis viennent les daimyos et leurs samouraïs, les fermiers et enfin les marchands et artisans. Les échanges entre classes sociales sont prohibés, les quartiers dûment séparés, les langages et les marques de politesse codifiés.
Les shonin constituèrent une véritable classe sociale à partir du XVIe siècle et l'on peut dire qu'elle correspond au développement urbain. Au départ, les marchands et artisans (shokunin) ne ravitaillaient que les seigneurs et les guerriers. Peu à peu, s'ajoutèrent paysans et serviteurs. Paysans et guerriers (bushis) ne pouvaient exercer d'activité commerciale selon les lois shogounales sous peine d'être rétrogradés. Les bushis obéissaient à une hiérarchie très stricte : daimyo, hatamoto, gokenin, hanshi, etc.
Les Tokugawa contrôlent les daimyos afin de décourager toute tentative de sédition ou de rébellion. Les mariages entre familles de daimyos sont surveillés et une catégorie spéciale de fonctionnaires, les metsuke, ont pour rôle de dénoncer ceux qui échappent aux servitudes de l'État : il s'agit donc d'une véritable police politique. Dès 1635, la pratique du sankin-kotai (le système de résidence alternative) oblige les daimyos à laisser femme et enfants en otage au shogun. Une surveillance des entrées et sorties de la cité s'exerce sur les routes afin d'empêcher la fuite des familles détenues. De même, cette surveillance s'exerce sur les entrées de la ville par où pourraient pénétrer des armes à feu. Cette politique encourageait les daimyos à constituer d'incessantes processions qui devinrent une réalité quotidienne sur les grandes routes comme le Tokaïdo.
Exclusion sociale et évolution des marchands :
En fait, les Tokugawa vont appliquer les théories sociales du confucianisme qui distingue quatre niveaux dans la hiérarchie : les guerriers administrateurs, les paysans, les artisans et enfin les marchands. Les bushis portent deux sabres, l'un court et l'autre long, et n'ont pas le droit de se mêler aux autres organisations sociales. Pour faire face aux charges de leur mission, les daimyos s'efforcèrent d'augmenter la production de riz et de toutes les activités agricoles.
Peu à peu, alors que la noblesse comptait encore en termes de terre et de rendement en koku de riz (unité de mesure correspondant à plus de 180 litres, soit la quantité nécessaire pour nourrir une personne pendant un an), la ville d'Edo avait déjà jeté les bases d'une économie de marché. Une économie monétaire commença à se développer dans l'archipel. Et bientôt, ceux-là mêmes qui constituaient la classe la plus basse dans la hiérarchie allaient contrôler la vie économique. L'endettement des daimyos dû à la politique trop rigide du shogun les contraignit bientôt à emprunter de l'argent aux marchands. L'enrichissement de ces derniers allait donner naissance à une culture populaire, dans les quartiers de Shitamachi où parfois samouraïs et daimyos venaient à présent s'encanailler, loin du mépris de l'aristocratie.
Le monde flottant :
Le quartier du monde flottant (ukiyo) allait devenir la source de nouvelles formes d'art, de la littérature au théâtre et de la céramique aux estampes. C'est autour de Yoshiwara que vont se développer le kabuki et le bunraku et c'est également dans le quartier des plaisirs que s'épanouissent les geishas. On voit apparaître une défiance à l'égard du pouvoir et de l'aristocratie, en même temps que du mépris et de l'ironie. Les marchands prirent assez rapidement conscience de leur identité de bourgeois dans la mesure où ils étaient avant tout une catégorie de gens vivant et consommant en ville.
On commença à voir s'établir des fortunes comme celle des Mitsui, vendeurs de saké, ou des Shimomura, qui exerçaient un monopole sur les transactions financières mais surtout sur le prêt et l'usure. A la fin du XVIIIe siècle, la culture de la ville se définit tout particulièrement par la recherche de l'iki (le chic) et du tsu (le connaisseur).
De même, le théâtre va jouer un rôle important dans l'affranchissement de la culture populaire. C'est maintenant dans la ville que se jouent les théâtres de marionnettes. Et c'est également sur scène que sera interdit le kabuki car les actrices et acteurs se livraient joyeusement à la prostitution.
Celle-ci d'ailleurs s'était largement répandue dans le quartier ad hoc (Kuruwa). Le terme de kuruwa signifie ce qui entoure, murs, remparts ou palissades. Le quartier chaud était effectivement entouré d'une palissade, d'où son nom. Le quartier des plaisirs, déplacé depuis 1657 non loin d'Asakusa, devint une source inépuisable pour le théâtre, la littérature et les arts. C'est également à cette période qu'apparaissent des sharebon, qui deviendront au fil du temps non seulement des « livres plaisants » mais encore des sortes de guides.
C'est dans ce monde flottant, où évoluent les dandys et les courtisanes, qu'allaient apparaître le spectre de l'effondrement du shogunat et l'arrivée fracassante de la modernité.
La conscience de son infériorité en matière de flotte de guerre oblige le shogun à accepter assez rapidement ce que l'empereur et la cour refusent, à savoir la concession d'accès à deux ports pour les Américains en 1853 et la présence d'un consul à Shimoda. En 1858, il signe de nouveau, sans l'aval de l'empereur, un contrat avec les Américains, suivi bientôt par d'autres avec la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Ces contrats, qui interviennent après une période d'isolationnisme s'étendant de 1639 à 1853 (sakoku-rei), entraînent des manifestations de xénophobie. Ces diverses réactions sont à l'origine d'une guerre civile.
Trois clans du Sud du Japon :
Les clans de Satsuma, Choshu et Tosa, se révoltent contre la volonté du bakufu de s'ouvrir à l'étranger et créent avec le soutien de l'empereur le mouvement Sonno joi (respect de l'empereur, élimination des étrangers). Fait paradoxal, alors que ces partisans de la restauration de l'empereur et de la fermeture du pays battent les troupes du bakufu shogunal en 1864, petit à petit, ils constatent d'eux-mêmes la supériorité militaire des étrangers et comprennent l'intérêt d'ouvrir le Japon au monde occidental de peur de se faire massacrer. Simplement, ils considèrent qu'un gouvernement comme celui des Tokugawa, c'est-à-dire uniquement militaire, n'est pas apte à contrôler le pays pour l'époque qui s'annonce. Ils pensent que la société japonaise doit être revue complètement. À ce titre, la restauration de Meiji qui suit, peut être qualifiée de « révolution de Meiji » car la structure même de la société changera complètement. Un détail, c'est à cette époque que le fameux sanctuaire Yasukuni est créé pour que les soldats japonais morts dans cette guerre civile puissent reposer en paix. Les daimyos et samouraïs ambitieux fomentent un coup d'État en janvier 1868 afin de rétablir la puissance impériale après que 2 000 loyalistes ont tenté d'empêcher l'armée impériale de rétablir l'ordre. Ce fut la bataille d'Ueno. L'empereur Mutsuhito s'installe en 1868 à Edo nommée Tokyo, la capitale de l'est.
Une véritable course contre la montre s'engage pour que le Japon se donne les moyens d'entrer décemment dans le manège, notamment colonial, de l'époque. En 1871, on réforme le système monétaire en imposant le yen. En 1872, on crée le premier chemin de fer entre Tokyo et Yokohama. Une série de réformes radicales met le Japon dans le sillage des grandes puissances. Il faut réorganiser à la fois l'État depuis Tokyo, le commerce intérieur et le commerce extérieur. La première Constitution japonaise est promulguée en 1889. L'empereur garde le pouvoir suprême et commande les armées. Le Parlement est constitué de deux chambres : la chambre des représentants (élus au suffrage censitaire), et la chambre des pairs (nommés par l'empereur). Tandis que les transports et l'électricité se développent, le Japon exporte de la soie. Sur le plan intérieur, les terres sont redistribuées et les biens des religieux deviennent propriétés d'État.
Quelques années plus tard, les zaibatsu (conglomérats financiers et industriels), nés de la volonté de l'empereur de concentrer la puissance financière, se développent, au point de concurrencer, les grands pays européens et les États-Unis. Pendant ce temps, militaires et libéraux s'opposent pour le pouvoir intérieur. C'est dans ce contexte que l'empereur décède en 1912.
Pendant la révolution de Meiji, la modernisation de la société génère de nombreux mouvements de rejet de l'Occident et de ses valeurs, qui plaident en faveur d'un retour aux traditions. À cela s'oppose une tentative de copier les puissances occidentales, non par admiration, mais pour éviter de tomber sous leur joug, comme la Chine à la même époque. Le slogan japonais nationaliste de l'ère Meiji trouve son origine dans un bref essai de Yukichi Fukuzawa publié en 1885, intitulé Quitter l'Asie, qui traduit la détermination d'en finir avec un monde centré sur la Chine, sa politique et son idéologie confucéenne. L'auteur propose de rejoindre l'Europe, c'est-à-dire faire du Japon un État-nation sur le modèle européen. Cet essai et le slogan « Quitter l'Asie, rejoindre l'Europe » qui l'accompagne ont un impact considérable sur la modernisation du Japon, qui se découvre par la même occasion des prétentions à l'extérieur, comparables aux empires coloniaux européens. Dans les années qui suivent, les changements très visibles du Japon voient apparaître des mouvements plus nostalgiques. Le célèbre roman de Nastume Soseki, Botchan, publié en 1905, témoigne des difficultés à accepter une transformation de la société et l'abandon de traditions ancestrales.
Histoire contemporaine :
De Meiji jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, décrit le Japon comme un pays agresseur et colonisateur. Certains historiens et écrivains japonais et étrangers voient les choses d'un autre oeil.
La guerre sino-japonaise éclate en 1894, se soldant par une défaite pour les Chinois. Très peu de temps après, en 1904, le Japon affronte la Russie. Vu du côté japonais, ces conflits sont deux guerres d'autodéfense contre la pression d'une Chine dominée par une administration corrompue et manoeuvrée par les intérêts colonisateurs britanniques et allemands d'une part, et contre le retardataire tsariste qui cherche à s'approprier l'Asie d'autre part.
Sur les territoires alors conquis, que ce soit pour la Corée, Taïwan, ou la Mandchourie, le Japon ne met pas ces pays dans un collimateur de prédation, contrairement au colonialisme classique. Il y développe des infrastructures, construit des routes, des chemins de fer et des adductions d'eau. Ces zones sont traitées avec les mêmes égards que le territoire japonais lui-même. Elles font partie intégrante du pays.
Au début de la Première Guerre mondiale, le Japon entre en guerre conformément à la demande de l'Angleterre. Le Japon occupe Chingtao et Port Arthur. Rapidement, de nombreux soldats allemands sont faits prisonniers. Ils sont acheminés au Japon dans un camp, à Tokushima où ils ont très bien été traités. Les échanges culturels entre les prisonniers et la population japonaise locale restent dans les mémoires.
En 1915, le ministre japonais des Affaires étrangères envoie un ultimatum à la Chine. Il se présente sous la forme de vingt et une demandes, qui exigent la présence de conseillers militaires et économiques japonais sur le territoire. Le concert des puissances de l'époque s'oppose à cet ultimatum, tout comme la Chine.En 1918, éclatent à Tokyo et dans de nombreux endroits, les émeutes du riz causées par une forte augmentation du prix de la céréale et par la volonté d'intervenir militairement en Sibérie, comme les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Italie, afin de s'opposer au bolchevisme naissant.
Les années vingt sont marquées par un malaise social et des difficultés économiques. La culture de masse de type occidental, la diffusion du marxisme et le syndicalisme apparaissent. Le parti communiste est créé en 1922 et les grèves se succèdent. C'est dans un climat survolté que le tremblement de terre du 1er septembre 1923 détruit Tokyo et Yokohama, causant plus de 150 000 morts. La loi martiale est décrétée. Les anticommunistes et anticoréens se déchaînent et des émeutes font plusieurs milliers de morts. Le tremblement de terre provoque de nombreuses faillites et, malgré le suffrage universel appliqué en 1925 et l'arrivée au pouvoir des libéraux, les nationalistes vont peu à peu s'imposer.
Hiro-Hito succède à son père défunt en 1926 et nomme son règne Showa (ère de la paix éclairée). Les difficultés économiques et sociales que connaît le Japon sont accrues par la crise de 1929. Les industriels et les militaires se montrent de plus en plus sensibles aux discours ultranationalistes et militaristes, selon lesquels la conquête de territoires permettrait de s'approvisionner en matières premières, de relancer la production japonaise et de résoudre le problème de la surpopulation par l'émigration.
Ces idées ne sont pas entièrement fausses, mais restent réductrices. Il suffit de regarder une carte de l'Asie dans la première moitié du XXe siècle pour se rendre compte qu'à part le Japon, il n'y a plus aucun État indépendant dans cette zone, à l'exception de la Thaïlande. Tous les autres pays sont colonisés par les pays occidentaux, ou étaient sous le contrôle de gouvernements fantoches. Dans ce contexte, le Japon fait le constat suivant : la seule voie de survie est de se doter d'une structure autonome pour rester indépendant.
Plusieurs années plus tard, le Général Mac Arthur, général en chef des forces d'occupation américaines, reconnaîtra devant le Sénat américain que « le Japon n'est pas entré en guerre dans le but d'agresser les États et de les envahir ».
Il faut reconnaître que le Japon, seul État asiatique à s'ouvrir vers l'Occident (sous sa pression) est le seul à vouloir prendre la forme d'un État moderne dès 1868.
L'incident du Pont Marco Polo en 1937 est utilisé comme prétexte à une invasion de la Chine continentale au départ de la Mandchourie. Cette énième machination de Tokyo déclenche une offensive de grande ampleur, avec des résultats catastrophiques sur le plan humain. Pour de nombreux historiens, la Seconde Guerre mondiale a débuté en Asie, avec l'invasion de la Chine par les troupes impériales japonaises. Cette invasion sera la plus meurtrière de l'histoire, la Chine comptant un total de près de 20 millions de victimes, frappées directement ou non par la guerre. Le massacre de la capitale chinoise, Nankin, est le symbole de cette barbarie qui encore aujourd'hui perturbe les relations diplomatiques entre les deux pays.
En 1938, le gouvernement japonais Konoe déclare la construction d'un « Nouvel ordre en Asie orientale », l'ordre Nichi-man-ka (Nichi : Japon, Man : Mandchourie, Ka : Chine). Dans la ligne de cette déclaration, le Japon présente en 1940 un nouveau concept qui inclut l'Asie du Sud-Est : « remplacer le contrôle colonial du concert des puissances occidentales par un nouvel ordre de coexistence et de co-prospérité en Asie ».
Cette explication permet déjà de nuancer un peu les intentions d'agresseur qui sont prêtées au Japon depuis Meiji. Après s'être retiré de la SDN en 1933, le Japon est conscient qu'il est désormais en opposition avec les États-Unis sur la Chine et sur l'ordre des choses en Asie. Pour cette raison, il cherche à éviter la guerre avec les Américains. Pour sortir de son impasse de cavalier seul, le Japon choisit la voie de l'Axe, l'Alliance trilatérale nippo-germano-italienne en 1940 sous l'action de son ministre des Affaires étrangères, Yosuke Matsuoka. Il signe un pacte de non-agression avec l'Union soviétique en 1941. Malheureusement, cela se retournera contre lui. Ces efforts n'ont pas pour effet d'endiguer l'opposition des États-Unis envers le Japon, mais de la rendre plus profonde. Washington décrète l'embargo du pétrole sur le Japon.
Sur le conseil de Winston Churchill, le secrétaire d'Etat américain Cordell Hull envoie au Japon une lettre d'ultimatum, la fameuse « lettre de Hull » qui explique quelles sont les conditions demandées par les États-Unis pour éviter la guerre. « Le Japon doit retirer de Chine et d'Indonésie toutes les forces militaires et policières dont il dispose ». Le Japon considère alors qu'il n'a plus d'autre choix que d'entrer en guerre.
Le fondement des hostilités japonaises était de s'opposer au contrôle colonisateur des pays occidentaux, sous l'étendard d'un principe : « unis sur toute l'Asie », principe qui défend l'idée que tous les Hommes font partie d'une même famille et qu'il n'y a pas de différence à faire. Sur la base de ce principe, le Japon propose d'établir une « zone de co-prospérité asiatique ». C'est le fondement moral défendu par près de cent millions de Japonais en 1940.
Deux éléments ont, de façon décisive, renforcé le nationalisme japonais s'appuyant sur le rejet des occidentaux. D'abord, la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui se solde par la première victoire d'une puissance asiatique sur un empire européen, conforte un nationalisme fondé sur l'idée que le Japon est parvenu au même niveau que les « barbares » occidentaux admirés depuis cinquante ans pour leur supériorité technique et militaire. Cette victoire marque l'entrée officielle du Japon dans le cercle des grandes puissances et des empires coloniaux, là où les accords passés avec la Chine quelques années plus tôt sur le contrôle de Taïwan n'avaient pas eu le même écho. A partir de 1905, le Japon est une puissance coloniale, avec des possessions sur Taïwan et la péninsule coréenne (depuis le traité de Shimonoseki en 1895), et en Mandchourie (après le traité de paix de Portsmouth en 1905). Ces possessions sont le résultat de victoires militaires japonaises face à ses voisins, la Chine et la Russie.
Ensuite, les conséquences de la Première Guerre mondiale exacerbent les mouvements nationalistes japonais, frustrés de voir les puissances occidentales s'obstiner à refuser de les traiter d'égal à égal. Ce sentiment d'injustice monte en puissance dans les années 1920, et l'hostilité à l'égard de l'Occident se centre rapidement sur les États-Unis qui refusent, de concert avec le Royaume-Uni, l'adoption demandée par le Japon d'une clause garantissant « l'égalité raciale entre nations » à l'occasion du Traité de Versailles. Les lois restreignant l'immigration japonaise aux États-Unis dans les années 1920 renforcent un sentiment antiaméricain qui permet aux mouvements nationalistes de trouver un écho de plus en plus favorable dans la société japonaise. En France, les milieux d'intellectuels japonais attirent dès cette époque l'attention sur les rivalités entre Tokyo et Washington dans des textes parfois prophétiques. L'impérialisme japonais est rapidement considéré comme une menace pour les territoires américains dans la région, comme les Philippines. La possibilité de voir les desseins expansionnistes japonais se porter vers la côte ouest des États-Unis est même un des éléments par lesquels Washington prend au sérieux la menace japonaise. Dans ces conditions, les études publiées avant le début de la guerre s'avèrent utiles pour comprendre les rivalités entre puissances, et les enjeux susceptibles de dégénérer en conflits ouverts, et replacent ainsi la guerre du Pacifique, officielle à partir de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et la déclaration de guerre du Japon aux États-Unis qui suit, dans son contexte. Cette attaque surprise permet aux Japonais de conquérir toute l'Asie du Sud-Est. De décembre 1941 à mars 1942, le Japon envahit Singapour, Hong Kong, Manille et l'Indonésie. En mai, toute l'Asie du Sud-Est est contrôlée. A partir de septembre 1942, les Américains parviennent à reprendre les îles du Pacifique pour accoster aux Mariannes, les Philippines et débarquer à Okinawa.
Durant les deux années 1944-1945, les bombardements sur toutes les grandes villes japonaises, excepté Kyoto, grâce à l'intervention d'un professeur français de Harvard, vont affaiblir le Japon et le conduire à la défaite. Tokyo est particulièrement visée par les bombardements en 1945. Deux tiers de la ville sont rasés.
Le 6 août 1945, les Américains larguent la bombe atomique « Little boy » sur Hiroshima, qui fera 200 000 morts (dont 70 000 immédiate). Le 8 août, l'URSS déclare la guerre au Japon et, le lendemain, les Américains larguent une seconde bombe atomique sur Nagasaki (120 000 morts dont 40 000 immédiates). Le 15 août, l'empereur s'adresse pour la première fois de l'histoire japonaise à son peuple à la radio en lui demandant « d'accepter l'inacceptable et d'endurer l'inendurable », ce qui veut dire « accepter la défaite ». L'empire du Soleil levant a payé très cher ses ambitions internationales et un expansionnisme agressif dont les conquêtes antérieures à la guerre du Pacifique ne furent que le dramatique aboutissement.
Occupation américaine et reconstruction. Le Japon est exsangue et, pour la première fois de son histoire, occupé par une puissance étrangère. Les États-Unis vont s'appliquer à créer de nouvelles institutions et surtout à ancrer le pays dans une étroite collaboration, afin de juguler les effets de la guerre froide. Ils créent le SCAP (Supreme Command for the Allied Powers) et montent aussi le War Guilt Information Program (WGIP) en plus du tribunal chargé de juger les criminels de guerre. Le WGIP est destiné à éduquer le peuple japonais à la logique suivante : le régime militaire japonais a été coupable de massacres cruels durant la guerre. Il fallait donc l'écraser. C'est le peuple japonais qui en a souffert, mais les États-Unis ont libéré le Japon de cette souffrance. Le général McArthur fait élaborer une nouvelle Constitution en 1946. Un gigantesque programme de refonte de l'administration et de l'économie est mis sur pied. Le 8 septembre 1951, la paix est signée à San Francisco et le Japon redevient une nation libre.
Les premières années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale sont cependant difficiles, toutes les infrastructures du pays étant détruites. Les villes sont, dans leur quasi-intégralité, des immenses champs de ruines, et la défaite engendre une période de doutes sur la capacité du pays à se relever. Avant de penser à la reconstruction, les Japonais doivent commencer par survivre. La ration alimentaire officielle est de 1 200 calories par jour, moins que la moyenne nécessaire à une personne de taille moyenne. Le chômage est de son côté pratiquement généralisé. Les premiers signes de la reprise sont rapides, mais la société reste dans une situation très précaire dans les années qui suivent la fin des hostilités.
De 1951 à 1993, date à laquelle le parti libéral démocrate perd les élections, le Japon a bénéficié d'une grande stabilité politique et réussi une remarquable ascension économique, en grande partie grâce au niveau extrêmement bas des dépenses en armement (le Japon étant sous le parapluie américain), permettant d'affecter les budgets en priorité à la reconstruction des infrastructures détruites par la guerre. Alors que l'économie redémarre avec le soutien américain, la guerre de Corée éclate. Ce sera une aubaine pour une industrie meurtrie par la guerre. Pendant quatorze années, les milieux industriels et les grandes maisons de commerce (Mitsubishi Trading, Mitsui Bussan, Sumitomo Trading...) vont s'attacher à réorganiser la production avec le concours du Miti (ministère du Commerce extérieur et de l'Industrie, créé en 1949). En 1964, le Japon peut organiser les jeux Olympiques à Tokyo et présenter l'état d'avancement du pays. Le PLD (parti libéral démocrate), au pouvoir depuis les années cinquante, garantit une certaine stabilité politique malgré l'agitation sociale qu'entretiennent les associations et partis d'extrême gauche (Zengakuren).
Info Time Tours.
1. Votre guide :
Nicolas Takashi Lune Eichi Dotorei.
Tel : +81 80 4880 7092
2. VOTRE CORRESPONDANT SUR PLACE :
ALTERNATIVES VOYAGES.
Bureau (de 10h00 à 18h00) : +81 (0)3-5796-5431.
Numéro d'urgence : Mr KITANO Yuki, +81 (0)80-1176-3322.
3. Time Tours :
249 rue de Crimée, 75019 Paris.
Tel : 01 40 32 47 00
Fax : 01 42 00 24 33
Email : voyages@timetours.fr
voyages@timetours.fr
4. Procédure de perte ou retard d'une livraison d'un bagage :
Contrat n° 4639.
Dès que le participant constate que son et/ou ses bagages ne lui ont pas été remis, il doit se présenter à la compagnie aérienne et demander un Constat d'avarie bagage.
Suite à cela, la compagnie délivre au participant un document qu'il faut absolument conserver pour l'envoyer à l'assurance.
Il devra également joindre la copie des billets électroniques et le reçu d'étiquette bagage avec le code-barres délivré en même temps que le ticket d'embarquement, lors de l'enregistrement.
Ces 3 documents fournis permettront l'ouverture du dossier.
-Cas n° 1 : S'il y a un retard de livraison uniquement :
Il faut attendre 24 h après avoir fait la déclaration pour pouvoir prétendre à un quelconque remboursement par lassurance.
Si le participant lésé n'est toujours pas livré après ces 24 heures, mais que le ou les bagages sont retrouvés pendant le séjour, un forfait maximum de 230E est remboursé par l'Assurance. Ceci comprend les objets de première nécessité (dentifrice, pantalon, chaussures, chemise, sous-vêtements).
Il est important de bien conserver les factures de chaque achat pour les délivrer à l'assurance .
-Cas n° 2 : Si le ou les bagages sont définitivement perdus :
Un forfait maximum de 750E est alors remboursé, dont 325E maximum pour les objets dits précieux : bijoux, appareils numériques, ordinateur portable, éléments de son et d'image, fourrure, fusil de chasse.
Il est important de bien conserver les factures de chaque achat pour les délivrer à l'assurance.
IMPORTANT :
Une franchise est toutefois appliquée à hauteur de 45E par dossier ou vert.
Attention, numéros téléphoniques et tarifs sous réserve de modification.
Auteur Remarques
L'auteur décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission !
Ce livret n'a pas été conçu dans un but commercial et donc ne peut être vendu sous aucun prétexte !
Il n'a pour but que d'informer les amis qui participent au voyage :
Japon, Mélange de traditions et de modernité.
en Septembre 2018.
Et pour conclure, place aux proverbes Japonais!
les proverbes et dictons, fruits du bon sens et de la sagesse populaire, offrent un angle subtil à qui veut comprendre un pays et son peuple.
" Le brouillard ne peut se dissiper avec un éventail. "
et
" Le jour idéal pour réaliser une chose, c'est le jour où on a décidé de la faire. "
Serge DANIEL vous souhaite un excellent voyage.
Retour Accueil Japon
Retour Accueil Site
Retour au Sommaire
Retour Haut de Page